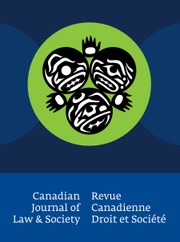Le 14 mars 2012, soit à la toute fin du mandat de Nicolas Sarkozy, le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé la création d’une nouvelle section disciplinaire au sein du Conseil National des Universités. Cette nouvelle section est sobrement intitulée « criminologie ». Si l’on aurait pu se réjouir de la reconnaissance institutionnelle d’un espace de recherche aussi riche qu’hétérogène, les porteurs de ce projet de sa création représentent en réalité ce que la criminologie compte de plus conservateur. La création de cette section a alors suscité une mobilisation critique des chercheurs spécialisés dans les sciences sociales consacrées à la police, à la délinquance, ou aux questions de sécurité, mais aussi de l’ensemble du monde universitaire français. En vain, dans un premier temps, puisque la section a été créée et qu’elle ne semblait guère encline à faire une place aux travaux de criminologies critiques ou alternatives ; mais dans un deuxième temps, avec une issue heureuse : le nombre de titulaires s’étant finalement présentés pour constituer la section s’est finalement avéré trop faible, sa création devrait être purement et simplement annulée. Il faut y lire ici une défaite de la dogmatique réactionnaire qui s’était accaparée de la criminologie en France.
Dès lors, la lecture de Droits et voix offre une véritable bouffée d’air pur dans un climat qui, en France, pourrait conduire à condamner la criminologie de manière trop générale. Ce livre collectif, qui célèbre les quarante années d’existence du département de criminologie de l’Université d’Ottawa, rappelle en effet que la criminologie n’est pas nécessairement une théorie de la réduction du crime à l’acte, mais qu’il y a, en amont et en aval de sa commission, des logiques politiques, économiques, sociales, techniques, et psychologiques dont l’investigation doit pouvoir être menée. Le livre présente ainsi des travaux majoritairement issus de la criminologie critiques ou correctionnalistes dialoguant depuis tant d’années avec les police studies. Tantôt en français, tantôt en anglais, les treize contributions aux sujets, enjeux, et plumes très divers convergent néanmoins autour des thèmes qui offrent au livre son titre sans équivoque : les droits et les voix. Certaines contributions se concentrent sur l’une ou l’autre de ces questions tandis que d’autres font le lien entre droits et voix, rappelant ainsi que la criminologie peut s’intéresser à la manière dont les acteurs donnent de la voix pour faire valoir leurs droits, y compris dans des situations ordinaires. Le livre se partage aussi entre les textes qui dressent un bilan (de l’activité du département de criminologie par Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme, de l’impact de la notion de gouvernementalité sur la criminologie avec le texte de Christine Gervais) et ceux qui s’appuient sur un cas empirique pour le disséquer et en tirer des conclusions cumulables en vue d’enrichir cet espace de recherche (on pense, par exemple, au travail sur la danse en prison de Sylvie Frigon et Claire Jenny, ou à la réintégration des femmes âgées dans leur communauté après un séjour en prison par Laura Schantz). Les chapitres peuvent aussi chercher à embrasser des transformations globales, que ce soit celles de la souveraineté de l’État au regard de l’évolution du droit international du traitement des personnes incarcérées (Sandra Lehalle) ou celles induites par des changements de paradigmes sociotechniques, avec le très novateur article de Martin Dufresne, Dominique Robert, Alain Lachapelle, et Marie-Lyne Vachon qui cherche de manière très heureuse à faire travailler les outils de la théorie de l’acteur-réseau, forgés autour de Bruno Latour, sur les technologies d’identification génétique au Canada.
Si Max Weber n’est pas particulièrement cité, son empreinte est notable, en particulier dans les chapitres qui saisissent le ou les droits comme des rationalités et dans ceux qui s’intéressent à leurs usages. La dette semble être grande aussi à l’égard du courant de recherche connu sous le nom « Law & Society » et peut-être plus particulièrement à l’égard d’un de ses prolongements—tout autant qu’une redéfinition : les Legal Consciousness Studies, en particulier dans le cas des chapitres se concentrant sur la capacité des acteurs à parler de la loi, de leur expérience de leur confrontation avec le système pénal et carcéral, et leur capacité à formuler des revendications à son encontre. Il faudrait aussi mentionner le patronage—ponctuel mais incontestable—d’Erving Goffman, voire de l’ethnométhodologie. Mais c’est bien l’influence de Michel Foucault qui se fait le plus clairement ressentir dans ce livre, à la fois en tant qu’il a permis d’aborder de manière renouvelée la question du corps dans les relations de pouvoir, mais aussi parce que la notion de dispositif telle qu’il l’a travaillée permet de saisir de manière originale les relations fortes qui existent entre les identités sociales, les logiques spatiales, les rapports politiques, et les enjeux technologiques. Cela se traduit par une présence plus ou moins spectrale, mais constante, du néolibéralisme comme cadre dans lequel les acteurs se meuvent, et de sa critique, en ce qu’elle est rendue possible par l’approche criminologique. En cela, et à l’heure où la criminologie en France se présente à nous comme une discipline fondamentalement conservatrice, cet ouvrage canadien qui invite « à penser autrement » et « à sortir du cadre » (10), résonne comme un espoir, à l’image de la phrase conclusive de l’introduction du livre qui affirme que la criminologie peut aussi « plaide[r] pour plus de justice sociale et parle[r] pour les marginalisés, les sans-voix et les sans-pouvoirs » (12).