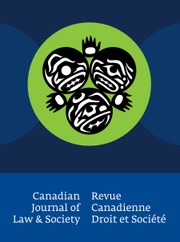1. Introduction
L’administrationFootnote 1 de la sphère judiciaire est indissociable de ses activités juridiques.Footnote 2 En effet, les modes de gestion de la justice en tant qu’organisationFootnote 3 influencent inévitablement le travail des différents acteurs du tribunal,Footnote 4 et in fine les qualités de la justice. Il est donc essentiel d’étudier l’introduction de logiques et d’instruments managériaux au sein du troisième pouvoir, marqué par une forte présence de professionnels (juges, juristes plus généralement) qui ne sont pas forcément ouverts à ces méthodes.Footnote 5 De plus, les techniques managériales ont tendance à « déspécifier » la justice, la faisant passer d’une institution dont le fonctionnement était « distancié », « à part »Footnote 6 à une organisation qui est censée tenir des délaisFootnote 7 ou encore être prévisible,Footnote 8 avec comme corollaire un impact profond sur les attentes auxquelles le pouvoir judiciaire doit faire face de la part de ses différentes parties prenantes (citoyens, justiciables, avocats, médias, etc.). S’il est vrai que la célérité et les délais constituent une préoccupation judiciaire depuis le début de la modernité,Footnote 9 il y a aujourd’hui une volonté d’accélérer le temps par des procédures plus rapides et plus simplesFootnote 10 suite au nombre croissant d’affaires que doit traiter l’institution. En outre, on observe une emprise managériale grandissante sur le troisième pouvoir, l’attention portée à la gestion ainsi que la légitimité qui en découle ayant énormément cru ces dernières années. Ce mouvement de fond risque de fortement transformer la cultureFootnote 11 du pouvoir judiciaire, jusqu’ici peu étudiéeFootnote 12 et d’entrainer une complexification des valeurs de ce dernier. De plus, l’hyper-bureaucratisation du droit et l’exacerbation de sa « rationalité formelle » au sens de Weber pourrait compromettre le respect de certaines valeurs fondamentales pour le droit moderne.
La nouvelle manière de penser en termes de coûts, performance et résultats a même fait dire à Peter KnoepfelFootnote 13 en 1995—soit au début de l’introduction de la Nouvelle Gestion Publique (NGP) en Suisse—que la tradition démocratique helvétiqueFootnote 14 serait ébranlée si la NGP était introduite dans tous les secteurs de l’administration. Au sein du pouvoir judiciaire, où les magistrats sont en règle générale élus par le parlement cantonal ou par le peuple, on peut raisonnablement penser que ces derniers adapteront leurs comportements afin de mieux répondre aux attentes de ceux qui les élisent, tout en défendant leurs valeurs professionnelles.
La situation semble similaire en Europe où les professionnels de la justice sont confrontés à l’introduction de nouvelles valeurs organisationnelles suite à l’arrivée de la NGP, et où les politiciens sont prêts à soutenir prioritairement les tribunaux qui contribuent à une efficacité accrue de leurs investissements.Footnote 15
Si ces nouvelles valeurs et modalités de gestion n’ont pas pour vocation de changer les finalités de la justice, elles peuvent influencer les fondements de sa légitimité et les qualités attendues d’une « bonne justice », en déplaçant par exemple le centre de l’attention (des professionnels) vers des notions telles que l’efficacité et l’efficience jusqu’ici peu usuelles dans les tribunaux. Tout un pan de la littérature disserte d’ailleurs sur le trade off entre les valeurs constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité d’une part, et leur obligation d’ « accountability »Footnote 16 et d’efficienceFootnote 17 d’autre part. D’autres auteurs soulignent le risque de déplacement des buts d’une organisation, lorsque des outils (par exemple informatiques) permettant d’implémenter les principes de la NGP sont introduits.Footnote 18 Des juges estiment même que la pression liée à la productivité serait incompatible avec la fonction de juger une affaire complexe et parlent de « sous-justice à la chaîne »Footnote 19 en évoquant certaines pratiques pénales simplifiées.
Avant d’analyser l’étendue des phénomènes ci-dessus au sein de la justice suisse par l’entremise de la notion de « bonne justice »,Footnote 20 il convient de définir succinctement la NGP et la place que celle-ci occupe au sein du pouvoir judiciaire helvétique.
Depuis le début des années 1990, le courant de la NGP a beaucoup influencé les pratiques de management au sein de l’administration, au niveau international. Les idées essentielles caractérisant ce mouvement, largement importées du monde commercial, et destinées à améliorer l’efficience et l’efficacité des administrations publiques, comprennent entre autres : les contrats de prestations, l’orientation client et les systèmes qualité, ainsi qu’une gestion des ressources humaines tournée vers la performance et le développement des compétences. Cette déferlante a également fini par atteindre les organisations judiciaires helvétiquesFootnote 21 (ainsi qu’au Canada d’ailleurs),Footnote 22 avec un retard d’une décennie environ par rapport aux premières expérimentations menées dans les autres services de l’Etat.Footnote 23 Le point de départ des récentes réformes de la justice date de la modification de la Constitution de 1999. Le but était alors d’unifier les procédures civile et pénale, et de par l’obligation faite aux cantons d’instituer des autorités de recours, d’alléger la charge du Tribunal Fédéral (TF), ultime instance de recours. L’Arrêté fédéral du 8 octobre 1999Footnote 24 prévoit par exemple de limiter la possibilité de faire appel au TF à une valeur litigieuse minimale ainsi qu’ « une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés ». Des mesures ont également été prises dans le but de diminuer les dépenses des cantons liées à la justice, comme la possibilité d’instituer des autorités judiciaires communes,Footnote 25 tout en laissant à ces derniers le soin d’organiser et d’administrer la justice comme ils l’entendent. Jusqu’à présent, les principes de la nouvelle gestion publique ont été testés dans les tribunaux bernois mais il s’agit plus d’une exception, la grande majorité des législateurs cantonaux ayant décidé de ne pas appliquer de tels préceptes,Footnote 26 indiquant une première résistance à cette approche.
A bien des égards, la NGP s’est développée comme une critique des principes de l’administration bureaucratique.Footnote 27 Elle propose des instruments et techniques qui véhiculent des nouvelles valeurs et peuvent engendrer un véritable chamboulement culturel : si l’on suit sa logique, les tribunaux devraient adopter une culture plus commerciale, axée sur le leadership, la prise de risque, l’orientation vers les résultats et la concurrence comme sources d’innovations organisationnelles.Footnote 28 A priori, ces nouvelles tendances ne correspondent pas vraiment au fonctionnement des tribunaux, posant la question fondamentale de leur cohabitation avec les principes et valeurs qui sont les fondements du pouvoir judiciaire et des professionnels qui y œuvrent, la NGP cherchant à «susciter l’adhésion des professionnels aux cultures internes des organisations ».Footnote 29 Ceci d’autant plus que la résistance au changement de la part des magistrats se renforce lorsque les réformes sont orientées vers des questions managériales qui leurs échappent.Footnote 30
Néanmoins, ce ne sont pas uniquement les juges qui sont affectés par les méthodes managériales mais bien l’ensemble des acteurs du pouvoir judiciaire.
Ainsi, le but de cet article est d’identifier les qualités d’une bonne justice en Suisse, telles que définies par les différents acteurs qui forment le tribunal au sens large (juges, gestionnaires de tribunaux, avocats, journalistes, politiciens) et de vérifier si ces qualités peuvent coexister avec les valeurs véhiculées par le monde managérial (NGP), le cas échéant d’évaluer la manière dont elles cohabitent (hybridation, dominance des unes sur les autres, etc.). Ce questionnement se justifie d’autant plus que les politiques qui tentent d’implanter des réformes liées aux doctrines et philosophies de la NGP font l’objet de contestations et de mobilisations collectives dans de nombreux secteurs dont la justice.Footnote 31 Pour ce faire, nous avons défini trois questions de recherche :
• Quelles sont les attentes principales auxquelles se réfèrent différents groupes d’acteurs lorsqu’ils évoquent ce que représente pour eux une bonne justice ?
• Les juges avec responsabilité managérialeFootnote 32 ont-ils les mêmes attentes envers une bonne justice que leurs collègues exempts de tâches de gestion ?
• A quels univers valoriels ces juges font-ils appel lorsqu’ils décrivent la notion de bonne justice?
Tout d’abord nous abordons les relations entre justice et société, avant de nous concentrer sur le rapport entre justice et management. Nous présentons ensuite les arguments évoqués par les acteurs de la justice suisse lors d’un programme d’interviews réalisés au cours de l’année 2013, afin d’en extraire les attentes principales pouvant être associées à la notion de bonne justice ainsi que leur compatibilité éventuelle avec un management « moderne » des tribunaux.
2. Revue de littérature
2.1 Société et attentes vis-à-vis de la justice
Le droit est inextricablement lié à la société dans laquelle il évolue puisqu’il découle du politique et confère une légitimité « aux aspirations et aux valeurs de la société ».Footnote 33 De plus, les jugements sont l’un des moyens qu’un système gouvernemental, et par extension la société dans laquelle il évolue, possèdent pour affirmer leurs valeurs centrales.Footnote 34 Ce lien entre droit et société impacte certainement le fonctionnement de la justice. Il est donc utile de s’intéresser aux différentes conceptions sociétales de la qualité d’une bonne justice même s’il paraît extrêmement difficile d’arriver à un consensus concernant les objectifs assignés au système judiciaire ou les facteurs qui déterminent sa performance.Footnote 35
Bien que l’importance croissante du juridique soit vue comme « un des événements marquants de la vie de toutes les sociétés démocratiques ces dernières années »,Footnote 36 un manque de recherche se fait sentir en Suisse, mais aussi à l’étranger, au sujet de l’interaction entre le fonctionnement du système judiciaire et la société. Ce vide n’est pas anodin car la légitimité du management de la justice est mise en doute puisque celui-ci ne se préoccupe pas des principes fondamentaux des ordres juridiques tels que la liberté, l’égalité et la solidarité et prolifère sans contrôle démocratique.Footnote 37 De nouvelles approches basées sur des évaluations qualitatives ou systémiques apparaissent donc pour éviter les excès de la rationalité managériale.Footnote 38
De nos jours, les citoyens estiment avoir droit non seulement à une bonne justice mais également à son bon fonctionnement,Footnote 39 la bonne justice étant associée autant à sa finalité stricto-sensu qu’à son bon fonctionnement. La justice doit dorénavant conquérir une certaine légitimitéFootnote 40 car l’opinion publique ne considère plus l’autorité et les institutions judiciaires traditionnelles comme allant de soi.Footnote 41 L’accentuation de l’attention médiatique portée à la justiceFootnote 42 a par exemple rendu le juge publiquement responsable de son travail, ce dernier devant parfois justifier son éthique et sa performance.Footnote 43 Une « bonne » justice semble ainsi devoir montrer un certain nombre de qualités. Des travaux de recherche de la première moitié du vingtième siècle font déjà ressortir une tendance à propos des préoccupations concernant la justice suisse qui semble assez proche de celle que nous connaissons aujourd’hui, particulièrement au sujet de son activité juridique.Footnote 44
Ainsi, en 1907, Lucien ChessexFootnote 45 parle d’un « état désastreux » du système judiciaire et du désir de réforme de certains, car une bonne organisation de la justice est « pour un pays un élément essentiel de vitalité ». En termes de compétences, il ne réclame pas de capacités managériales mais demande que l’on rende obligatoires les « connaissances juridiques »Footnote 46 pour tous les juges. Il parle aussi du pouvoir d’appréciation dont les tribunaux ne devraient pas abuser car « un Code doit poser des règles fixes, afin que les justiciables y trouvent les renseignements désirés et que les Tribunaux ne soient pas tentés de dépasser leurs compétences ».Footnote 47 L’auteur dit plus loin que, suite au développement du canton (de Vaud), les moyens à disposition pour régler les différends ne suffisent plus car « vu la complexité des faits, la variété des procès, les juges et les parties demandent à être mieux renseignés ».Footnote 48 Un autre exemple nous est fourni en 1943 par Pierre Hofmann qui affirme, en parlant du système de recours « qu’il convient d’une part d’assurer aux justiciables un maximum de garanties contre les erreurs et les irrégularités du juge » mais aussi qu’il est « pratiquement nécessaire d’autre part, de ne pas surcharger de travail les tribunaux de seconde instance ».Footnote 49
La différence majeure avec les demandes faites de nos jours au système judiciaire est l’absence de référence directe à l’efficienceFootnote 50 et à une justice orientée vers les résultats ou les clients alors que ces principes sont aujourd’hui à la base de la légitimité de l’Etat et doivent même être «ancrés expressément au niveau constitutionnel ».Footnote 51
Mais qu’en est-il de la réaction des juges face à cette évolution ? De manière générale, les magistrats suisses estiment que leur liberté s’est vue renforcée ces dernières années grâce à une plus grande autonomie dans la gestion administrative des tribunaux,Footnote 52 alors que normalement la tradition suisse accorde une souveraineté minimale au pouvoir judiciaire dans l’administration de la justice.Footnote 53 Cependant, la récession économique a transféré l’attention vers l’efficience de la justice, la simplification des procédures en est un exemple criant.Footnote 54 Dans cette optique, les organisations du pouvoir judiciaire introduisent un peu partout différents systèmes de management, en partant de l’idée qu’elles sont des fournisseurs de service.Footnote 55 Toutefois, le travail des juges n’est pour l’instant évalué que de manière informelle en Suisse.Footnote 56
2.2 Le management peut-il être au service de la justice ?
Le management pourrait contribuer à la légitimité des juges, et par extension à celle de la justice. Il est même considéré par certains comme un des éléments les plus prometteurs parmi les efforts entrepris pour donner une nouvelle orientation de la justice envers la société,Footnote 57 les bons jugements n’étant plus suffisants à légitimer le système judiciaire.Footnote 58 Pour autant, il ne doit pas être appliqué uniquement pour répondre à des impératifs financiers.Footnote 59 On observe malgré tout une importance croissante des chiffres dans la justice. Les tribunaux publient régulièrement des résultats de performance car ils se doivent d’être des organisations « ouvertes », orientées vers l’extérieurFootnote 60 et totalement transparentes envers les médias.Footnote 61 À Genève par exemple, le Procureur Général, qui est également le président de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, rend compte chaque année de la situation de ce dernier à la presse en articulant, entre autres, des chiffres concernant l’évolution des charges de fonctionnement, les revenus et le nombre d’affaires traitées.Footnote 62 Ceci fait dire à Alain Marti qu’ « avec une mentalité commerciale, le pouvoir judiciaire se sent obligé de démontrer qu’il ne coûte rien au contribuable, mais qu’il rapporte à la collectivité autant qu’il coûte ».Footnote 63
Poussé à son paroxysme, le managérialisme consiste à introduire des outils de management « pour eux-mêmes en en perdant précisément le sens »,Footnote 64 alors que le but de la managérialisation des organisations publiques devrait être, au contraire, de re-légitimer ces dernières.Footnote 65 Le résultat de la maximisation de l’efficience, qui tente de satisfaire le justiciable-utilisateur, en focalisant trop sur la manière d’atteindre les résultats au dépend de l’efficacité, serait une perte de crédibilité vis-à-vis des citoyens pour qui la « caractéristique fondamentale de l’action publique (est) la défense de l’intérêt public ».Footnote 66 Il faudrait donc se concentrer sur l’efficacité, soit satisfaire les besoins du citoyen en termes d’accès aux tribunaux par exemple, au lieu de se centrer sur l’efficience, ce qui apporterait une légitimité supplémentaire à la justice.Footnote 67
Actuellement, il semble que la tendance soit à l’inverseFootnote 68 dans la justice,Footnote 69 l’efficacité étant trop difficile à mesurer, ce qui entraîne une « perte de pouvoir des professionnels vis-à-vis de l’administration ».Footnote 70 Aux États-Unis par exemple, le juge est évalué tant sur la qualité de sa décision que sur les modalités avec lesquelles il conduit l’affaire.Footnote 71 Au Pays-Bas, la pression des résultats serait à la base du phénomène qui voit des magistrats négliger la formation continue.Footnote 72 Alexandre Piraux et Benoît BernardFootnote 73 pensent même que des dérives sont inévitables, certains juges essayant de « plaire » aux gestionnaires d’une manière ou d’une autre,Footnote 74 leur travail étant souvent évalué sur des critères quantitatifs uniquement.
La légitimité de la justice ne dépend donc plus de critères purement juridiques mais bien d’un arbitrage permanent entre ces derniers et un souci d’efficacité.Footnote 75 La nouvelle gestion des tribunaux n’a d’ailleurs plus seulement comme ambition d’améliorer le rendement mais aussi la qualité des services et prestations fournis. Le management dans la justice va donc au-delà d’une simple technique, c’est une nouvelle logiqueFootnote 76 qui véhicule une culture portée par de nouvelles valeurs et attentes, voire de nouvelles sphères de légitimation au sens de Luc Boltanski et Laurent ThévenotFootnote 77 comme nous le verrons plus loin. On en veut pour preuve la fréquente substitution du terme justiciable par celui de client.Footnote 78
Toutefois, si l’on décide d’administrer la justice par les normes et les indicateurs, cela risque de modifier le rapport homme-travail, voire l’éthique même du travail juridique.Footnote 79 Il y aurait une dichotomie entre une manière d’évaluer la justice en fonction de sa mission de service public (accessibilité,Footnote 80 impartialité, célérité, égalité des armes) et en fonction de logiques managériales issues de la NGP qui la considère comme un processus de production (où on mesurera les coûts, les moyens, l’activité, la performance).Footnote 81 Dans le premier cas, on prend en compte principalement le « processus » juridique, alors que dans le second c’est plutôt le travail des magistrats qui est analysé. Le problème est qu’il est impossible d’estimer correctement la qualité d’un processus de production sans évaluer son résultat en fonction de son but premier : en l’occurrence la mission de service public. Ces deux logiques sont donc indissociables l’une de l’autre, mais sont-elles vraiment compatibles ?
Certains auteurs parlent d’ « aspects fondamentaux » lorsqu’ils évoquent des valeurs civiques comme l’indépendance de la justice, alors qu’ils relèguent les aspects managériaux des cours, comme l’efficience dans le traitement des affaires, au titre d’ « aspects secondaires ».Footnote 82 En effet, des paramètres tels que la productivité, l’efficience et le retour sur investissement ne sont pas courants dans la logique judiciaire. Il sera donc pertinent de vérifier si la rencontre de ces aspects provoquera un choc culturel comme ce fut le cas dans d’autres services publics,Footnote 83 et/ou la transformation de l’éthos des professionnels de la justice.Footnote 84 Certains parlent même d’antagonisme entre efficience et justice, arguant que la vie judiciaire est maintenant plus centrée sur l’efficience que sur la manière dont les organisations et les relations sociales en son sein fonctionnent.Footnote 85
Les résistances culturelles à la managérialisation des tribunaux risquent en effet de créer des tensions, particulièrement si les changements sont imposés de l’extérieur en faisant peu de cas des valeurs de l’institution, ce qui pourrait créer des dilemmes moraux et augmenter le stress professionnel.Footnote 86 Afin d’évaluer cela, il faut se demander si les qualités recherchées d’une bonne justice peuvent cohabiter avec les approches managériales décrites plus haut. Nous allons analyser ce phénomène à l’exemple du pouvoir judiciaire suisse.
3. Méthode
La présente étude fait partie d’un plus large projet sur le management de la justice helvétiqueFootnote 87 conduit au niveau national depuis 2012. Pour cet article, nous avons analysé une série d’entretiens (56) semi-structurés menés dans des tribunaux de première et seconde instance dans des cours civiles, administratives et criminelles de neuf cantons,Footnote 88 dans les trois régions linguistiques du pays. Nous nous sommes entretenus tant avec des acteurs internes au tribunal (39) (juges (30) et managers (9)), qu’avec leurs pendants externes (17) (politiciens (7), avocats (5), journalistes (5)).Footnote 89 L’échantillonFootnote 90 comprend un nombre identique de juges avec et sans responsabilité managériale.
Les interviews, d’une durée d’environ une heure chacun, ont été conduits selon la méthodologie inductiveFootnote 91 dans le but de découvrir les principales attentes d’une bonne justice, jusqu’à saturation des arguments.Footnote 92 L’objectif était de laisser s’exprimer nos interlocuteurs sur l’idée qu’ils se font de la bonne justice afin de faire émerger les arguments qui sous-tendent selon eux cette notion.
Les enregistrements des interviews ont été retranscrits et codés à l’aide du logiciel NVivo 10. Nous avons classé des passages d’entretiens dans vingt-six nœuds différents,Footnote 93 chacun correspondant à un argument défini comme important pour une bonne justice par les répondants. Certaines attentes émises par le même participant peuvent être complémentaires ou contradictoires, car chacun a d’abord dû décrire ce qu’était une bonne justice pour soi, avant d’expliquer ce que cela signifiait, selon lui, pour les autres parties prenantes. Un interviewé pouvait mentionner divers arguments, mais un argument répété à plusieurs reprises par la même personne n’a été comptabilisé qu’une seule fois. Par contre, certains paragraphes qui expriment des idées diverses peuvent être codés dans plusieurs nœuds. Nous avons ensuite classé les différents nœuds selon la fréquence avec laquelle ils étaient signalés par les participants (plus un nœud est cité par un groupe d’acteurs, plus il obtient de + proportionnellement au nombre d’acteurs présents dans le groupe, voir tableau 1). Nous utilisons donc la récurrence des arguments comme proxy de leur importance pour les groupes d’acteurs. Etant donné le nombre de répondants (56), il semble qu’une classification en cinq différents groupesFootnote 94 soit adéquate. Le terme choisi pour chaque nœud n’a pas forcément été cité verbatim par les interviewés, l’exercice consistant à coder les idées similaires dans le même nœud selon la méthode de l’analyse de contenu.Footnote 95 Nous avons ensuite élaboré une définition de chaque nœud, en nous inspirant des citations des participants.Footnote 96 Nous savons que certaines attentes se recoupent, mais nous avons préféré les aborder individuellement pour pouvoir analyser les discours de la meilleure manière qui soit. Dans une étape ultérieure de la recherche, nous utiliserons l’analyse factorielle pour identifier les valeurs similaires ou contradictoires.
Tableau 1 Attentes d’une bonne justice en Suisse de différents acteurs

++++ : Thème mentionné extrêmement fréquemment (par au moins deux tiers des interviewés)
+++ : Thème mentionné fréquemment (par au moins la moitié des interviewés)
++ : Thème mentionné quelques fois (par au moins un quart des interviewés)
+ : Thème mentionné au moins une fois
/ : Thème non mentionné par ce groupe d’acteurs
Nous avons choisi d’analyser des discours et basons donc nos observations sur ce qui est dit et non sur ce qui est passé sous silence. Il est cependant possible que certains arguments trop évidents pour être énoncés ne soient pas mentionnés par les participants et que ces éléments appartiennent principalement au registre civique (voir définition ci-après). Les arguments commerciaux étant les plus récents et controversés apparaitraient donc comme surreprésentés dans nos réponses. Pour éviter cela, nous n’avons pas précisé à nos interlocuteurs que nous étudiions le management de la justice en particulier. De plus, les résultats nous montrent que les arguments les plus évoqués restent ceux du monde civique, ce qui rend peu probable la possibilité d’une trop forte représentation des éléments commerciaux. Finalement, nous n’avons comptabilisé qu’une seule fois chaque argument dans le tableau 2 qui nous permet de définir à quels mondes les acteurs de la justice suisse font le plus souvent appel quand ils évoquent la bonne justice.
Tableau 2 Attentes d’une bonne justice (évoquées par les acteurs du tableau 1) classées selon la méthodologie de Boltanski & Thévenot (1991)

Pour appréhender les valeurs sous-jacentes à ces attentes, nous avons utilisé la typologie des mondes développée par Boltanski et Thévenot,Footnote 97 laquelle consiste en des univers idéal-typiques de référenceFootnote 98 auxquels font appel les acteurs lorsqu’ils justifient leurs agissements dans un contexte collectif. Nous avons retenus ici quatre mondes qui nous semblent pertinents afin de classer nos résultats :
1) Le monde industriel est basé sur les notions d’efficacité, de rendement et de performance. Il s’agit de l’univers des manufactures, centré sur la bonne organisation, le professionnalisme et l’optimisation des ressources. Ici, tout ou presque est mesurable, y compris l’homme. On se situe dans un monde scientifique, rationnel et modélisable. Pour ce qui est de la justice en particulier on se réfèrera principalement aux notions qualitatives que l’on tente de mesurer par des indicateurs (rapidité, efficience et efficacité, etc.).
2) Le monde civique est celui de l’union de tous dans la formation de la volonté générale. Les organes collectifs et représentatifs (syndicats, partis politiques, collectivité publique) sont placés au centre. C’est le monde de l’expression de l’action démocratique, justifié par la législation et fondé sur la figure emblématique du citoyen. Ici, les êtres s’équivalent, la volonté générale surmonte ce qui est particulier et lie les êtres dans une action collective. C’est le monde « classique » de la justice car la volonté collective doit s’exprimer dans des formes officielles (arrêtés, décrets, ordonnances, dispositions, jugements, etc.) afin d’assurer sa validité et sa stabilité. C’est aussi le monde où la justice est subordonnée au citoyen et se doit de lui rendre des comptes, d’être à son service et de lui garantir les prérogatives traditionnelles de la justice (impartialité, égalité de traitement, prévisibilité, etc.).
3) Le monde commercial est celui du marché, de la rivalité entre les personnes physiques ou morales, du bien (produit), de l’argent et de la concurrence entourant les clients potentiels. Les valeurs centrales sont la valeur marchande, la possession, le profit et la rétribution. C’est l’univers sur lequel se fonde la théorie économique libérale où les personnes agissent de manière égoïste afin de satisfaire un besoin ou un désir. Ici le justiciable est un « client » que la justice se doit de satisfaire dans une relation d’ « affaire ». Elle doit non seulement proposer un service de qualité à ses clients (proximité, simplicité, personnalisation, etc.) mais elle doit aussi assouvir certains désirs (avoir raison, résoudre un conflit) et ce à un prix attractif.
4) L’univers domestique est le monde des relations personnelles, inspiré par la famille et centré sur les relations bienveillantes qui animent une entité collective, un milieu. Les valeurs centrales sont ici la hiérarchie et la tradition. On rejette l’égoïsme et adoube les notions d’autorité, de responsabilité, de supériorité et de subordination. En ce qui concerne la justice, nous apparentons la notion de bienveillance à la justice humaine et à la recherche de conciliation alors que la sévérité et la confiance trouvent leur place dans la relation entre la justice (le supérieur) qui juge le justiciable (subordonné).
Les réformes qui font écho à la NGP ont été analysées par plusieurs scientifiques utilisant cette approche comme une confrontation directe entre le monde civique (monde bureaucratique wébérien) et le monde commercial, ce dernier étant le reflet d’une logique managériale.Footnote 99 Il est cependant possible de concilier ces deux mondes grâce au processus que les auteurs appellent le « compromis » selon lequel les acteurs se mettent d’accord pour « composer…en recherchant l’intérêt général, c’est-à-dire non seulement l’intérêt des parties prenantes mais aussi l’intérêt de ceux qui ne sont pas directement touchés par l’accord ».Footnote 100 Le compromis se réalise grâce à un « principe de rang supérieur » capable de rapprocher des mondes qui paraissent en opposition.
L’équipe de recherche a longuement débattu et passé en revue les travaux comparables dans la littérature actuelle et étudié les caractéristiques des univers proposés afin d’attribuer les attentes révélées par les entretiens aux différents mondes.Footnote 101 Cette classification nous aidera à déterminer si les sphères de légitimation auxquelles les participants se réfèrent lorsqu’ils définissent une bonne justice varient en fonction de leur rôle et si les valeurs associées à cette bonne justice empruntent à l’univers managérial.
4. Résultats et discussion
4.1 Résultats globaux
Le tableau 1 présente la fréquence avec laquelle les différents acteurs (juges, gestionnaires de tribunaux, politiciens, avocats et journalistes) mentionnent les vingt-six attentes qui sont selon eux les plus importantes concernant une « bonne justice ». En général, on remarque une assez forte congruence entre les attentes des divers acteurs interrogés, comme le montrent les deux notions (rapide et communicative) citées le plus fréquemment (++++) par tous les types d’acteurs, sans exception :Footnote 102 « la décision doit tout d’abord être rapide, et le plus juste possible » (juge 8, canton 5). Néanmoins, certains tribunaux ont encore du retard dans ces domaines comme l’explique un magistrat (no. 2, canton 1): « on a des carences à tous les niveaux de la communication, tant interne qu’externe » ou encore « on travaille sur des recours d’il y a 2 ans, c’est insupportable pour le justiciable » (juge 1, canton 1).
De plus, on observe que les neuf attentes les plus citées par les juges sont aussi mentionnées par tous les autres types de répondants. Au total, ce ne sont pas moins de treize attentes (50 %) qui sont évoquées par l’ensemble des acteurs. En ce qui concerne les différences, il n’est pas surprenant que les gestionnaires des tribunaux soient ceux qui attachent le plus d’importance à l’orientation client :Footnote 103 « C’est clair que ça doit aller vite en première instance mais on ne veut pas attendre non plus des lustres pour obtenir le résultat de notre recours, ça doit aller vite partout. Le client veut savoir s’il a gagné ou pas » (gestionnaire de tribunal 1, canton 3) mais ne mentionnent que très rarement une caractéristique fondamentale pour les juges : l’indépendance.
Sans surprise, les avocats plaident pour une justice simple et pragmatique,Footnote 104 particulièrement lorsqu’il s’agit de la procédure. Ces derniers, tout comme les politiciens et les journalistes mentionnent aussi des items tels que la transparence ou une justice humaine et proche des gens, plus fréquemment que ceux qui officient au sein des tribunaux : « Il faudrait une justice plus humaine, qu’elle soit moins intransigeante sur le côté “à la lettre” de la procédure » (politique 1, canton 6). La notion de justice efficace et efficiente est citée plus souvent par des acteurs externes comme les avocats et les journalistes, ce qui peut surprendre car elle est une source de légitimité pour les magistrats.Footnote 105 « Soit on se dote d’une justice qui est capable d’être efficace à tous les niveaux soit on traite les affaires prioritaires et les autres, on dit : vous vous faîtes justice vous-même » (avocat 2, canton 3).
Les journalistes se font le relais de l’opinion publique en mentionnant plus fréquemment que les autres des attentes telles que la sévérité : « Ah, oui, la population à mon avis, elle est beaucoup plus dure que la justice, de loin » (journaliste 1, canton 3), ou la légitimité d’une justice rendue par des non-professionnels.
4.2 Les juges qui exercent des responsabilités de gestion ont-ils des attentes différentes des autres ?
Si l’on ne considère pas la fréquence, on constate qu’environ 70 % des attentes (18/26) sont mentionnées par les deux groupes de juges, démontrant une forte congruence des attentes entre ces deux classes de magistrats. Cela semble indiquer que les juges avec responsabilité de gestion n’ont pas d’attentes fondamentalement différentes de leurs collègues qui dédient l’entièreté de leur activité professionnelle au droit, même si certaines divergences ont été relevées. Nous pensons que cela pourrait être dû à la notion de surdétermination de la culture professionnelleFootnote 106 sur la culture managériale ; les juges étant des spécialistes particulièrement attachés à leur fonction, celle-ci prendrait le pas sur l’exercice ou non d’une activité de gestion.
Nous nous intéressons maintenant aux univers de référence auxquels font appel les magistrats, respectivement sans et avec, responsabilité managériale, lorsqu’ils évoquent la notion de bonne justice. Pour ce faire, nous utilisons la grille d’analyse des mondes communs développées par Boltanski et Thévenot.Footnote 107 Nous discutons d’abord les attentes invoquées par tous les juges avant de nous concentrer sur celles qui ne sont mentionnées que par un groupe de juges alors que l’autre ne les cite jamais, afin de déterminer si la présence d’une activité managériale dans le cahier des charges des magistrats a une influence sur les mondes auxquels ils se réfèrent.
Parmi les onze attentes les plus citées par l’ensemble des juges, la majorité d’entre elles (5) appartient au monde civique, traditionnellement le monde de l’administration publique dont le citoyen est l’acteur principal, suivi des mondes commercial (4), industriel (1) et domestique (1). Ces résultats confirment la première partie de l’enquête où les deux mondes les plus représentés chez les managers de tribunaux et les juges étaient justement ceux-ci.Footnote 108 Cela renforce aussi l’idée que la culture hybride post-bureaucratiqueFootnote 109 est bien présente chez les juges de première et seconde instance en Suisse, mais contredit des recherches similaires menées dans d’autres services publicsFootnote 110 helvétiques où les mondes les plus cités étaient les mondes industriel et civique.
Les attentes mentionnées uniquement par les juges sans expérience de gestionFootnote 111 sont personnalisée, impartiale, donne raison, non-corrompue, prévisible : un mélange d’éléments se rapportant aux mondes civique (impartiale, non-corrompue, prévisible) et commercial (personnalisée, donne raison Footnote 112) avec une prédominance pour le premier.
A l’inverse, trois attentes (sévère, égalité de traitement, inspire confiance) ont été signalées seulement par des juges ayant une activité managériale. Le monde domestiqueFootnote 113 (sévère, inspire confiance) est ici mieux représenté que le monde civique (égalité de traitement). Nous en concluons que les juges avec expérience managériale ne font pas plus souvent appel au monde commercial lorsqu’ils définissent une bonne justice que leurs homologues sans responsabilité de gestion, contrairement à ce qui avait été observé dans une première partie de l’étude entre ces derniers et les secrétaires généraux.
Si l’on excepte l’attente liée à l’indépendance de la justice, nous remarquons, dans le tableau 1, que les six attentes auxquelles les juges font le plus fréquemment référence lorsqu’ils évoquent l’idée de bonne justice (rapide, communicative, indépendante, accessible, simple et pragmatique, transparente) sont compatibles avec les principes de la NGPFootnote 114 et sous-tendent l’existence d’une culture judiciaire qui n’est pas incompatible avec l’idée d’une gestion moderne de la justice. Un magistrat (no. 2, canton 1) nous affirmait par exemple: « On est vraiment au service du client, du justiciable. On doit répondre à des attentes, on ne doit pas rendre la justice pour la gloire…».
Toutefois, le monde le plus fréquemment cité par l’ensemble des personnes interviewées lors de la présente étude reste le monde civique (13 attentes) qui est le monde wébérien « classique » dans lequel la « promotion et la défense du bien public priment »,Footnote 115 suivi par le monde commercial (7 attentes).Footnote 116
Les acteurs de la justice helvétique que nous avons rencontrés semblent apparemment plus proches des modèles de l’administration publique canadienne (Québec)Footnote 117 ou belge qui évoquent, eux aussi, les mondes marchand et civique en premier lieu,Footnote 118 que des autres services de l’administration publique suisse. Même si des recherches plus approfondies sont nécessaires avant de pouvoir conclure que le monde juridique est vraiment distinct des autres services publics du pays, force est de constater que ses membres recourent majoritairement aux mondes civique et commercial lorsqu’ils évoquent l’image qu’ils se font d’une bonne justice. Ce constat ne remet évidemment pas en question l’hypothèse selon laquelle « une hybridation entre des valeurs bureaucratiques et fonctionnelles et des valeurs démocratiques »,Footnote 119 serait une particularité suisse mais pose la question de la spécificité de la justice. Cette nouvelle forme de légitimité hybride associée au service au client se doit d’être rapide, mais aussi humaine à l’image de l’artisan ou de l’entreprise qui place la satisfaction de ses clients au centre de sa stratégie commerciale. Certains parlent d’ailleurs de l’importance de délivrer des décisions « rapides, motivées, de manière claire (…) » (juge 4, canton 3) et qu’il « il faudrait se demander si ce que l’on écrit aux gens est compréhensible » (juge 3, canton 2).
5. Conclusion
Il existe une volonté claire de répondre au mieux aux attentes des justiciables, qui se reflète dans l’importance donnée au monde commercial par les différents acteurs interrogés. Cependant, réduire ces derniers à de simples consommateurs-utilisateurs dans un contexte où celui qui procure le service ne contrôle pas ce qu’il offre et où le bénéficiaire ne peut généralement pas choisir son fournisseur, lorsqu’il n’est pas carrément contraint de participer à une procédure, serait trop simpliste ; le citoyen faisant face aux obligations imposées par l’administration est clairement distinct du client en position de force par rapport à un Etat qui se doit de lui fournir un service.Footnote 120 Afin de dépasser ces oppositions, Boltanski et Thévenot font référence à la notion d’ « usager », intégrant à la fois le concept de « client » et celui de « citoyen »Footnote 121 par exemple.
Il ne faut pas minimiser les efforts qui seront nécessaires pour faire cohabiter les valeurs des univers civique et commercial, particulièrement dans une justice qui se « détraditionnalise »,Footnote 122 et où l’éthos professionnel de ses acteurs est de plus en plus chamboulé. Une hybridation de ces mondes via des conventions au sens de Henri Amblard et al.Footnote 123 et l’apparition subséquente d’une culture judiciaire hybride, relevée dans d’autres services publics occidentaux,Footnote 124 ne paraît guère incongrue. Cela paraît plausible dans la mesure où le rythme des réformes managériales en Suisse n’est pas effréné et les divergences fondamentales entre les différents groupes interrogés au regard de leur idée de bonne justice, notamment les juges avec ou sans responsabilité de gestion, sont peu nombreuses. Le chemin entrepris semble donc celui d’une gestionnarisation douce et incrémentaleFootnote 125 dans la tradition des réformes helvétiques.
L’importance du management de la justice va grandissante et impacte fortement sa légitimité et sa réputation.Footnote 126 Il est donc crucial que la collaboration entre les présidents de cour et les gestionnaires des tribunaux soit optimisée, particulièrement dans la zone d’intersection où leurs activités s’interpénètrent.Footnote 127 Etant donné l’effacement des frontières entre ces dernières,Footnote 128 une « colonisation » des nouveaux instruments gestionnairesFootnote 129 par les juges est envisageable. Il n’est également pas exclu que les valeurs du monde commercial colonisent celles du monde civique à l’avenir, celles-ci étant considérées par certains comme quelque peu dépassées à l’heure actuelle.Footnote 130 Mais pour produire quelle justice ?
Annexe 1 : Lexique des attentes
1) Rapide : La justice doit résoudre les problèmes aussi rapidement que possible pour éviter les conséquences néfastes que la lenteur peut faire peser sur les parties.
2) Communicative : La justice doit expliquer ce qu’elle fait de manière compréhensible au public via les médias et/ou améliorer sa communication externe et/ou interne.
3) Indépendante : La justice doit être indépendante de toute sorte de pressions, particulièrement politique.
4) Accessible (financièrement et géographiquement) : Les tribunaux doivent être situés à proximité des citoyens qui en ont besoin et être abordables financièrement.
5) Simple, pragmatique, pas trop formaliste : La justice ne doit pas être trop à cheval sur les règles. Elle doit être intelligente et adapter ses procédures si nécessaire.
6) Transparente : La justice doit être transparente à propos de son fonctionnement. Cacher des choses aux citoyens n’est pas concevable.
7) Humaine, proche des gens : La justice n’est pas simplement synonyme d’application stricte de la loi. Elle doit réaliser que sa matière première est l’être humain et qu’elle peut avoir des répercussions profondes sur l’existence de celui-ci. Elle est donc tenue de prendre en considération ce que vit l’homme de la rue et de jouer son rôle social.
8) Orientée client : La justice est un service public orienté client dont l’objectif doit être de servir le justiciable.
9) À l’écoute : La justice doit être à l’écoute des justiciables, il ne suffit pas de les entendre, de les considérer comme des numéros.
10) Juste : La justice doit être équitable et la décision rendue correcte.
11) Service public : La justice est considérée comme un service public.
12) Efficace et efficiente : La justice doit utiliser ses ressources avec parcimonie et en retirer le plus grand bénéfice possible.
13) Recherche la conciliation : La justice doit tenter de réconcilier les parties et non favoriser systématiquement l’ouverture d’un procès.
14) Doit rendre des comptes : Une justice dans sa tour d’ivoire n’est plus acceptée. Elle doit s’expliquer tant au sujet de son travail judiciaire que de la façon dont elle dépense/gère l’argent public.
15) Légitime, crédible : Pour gagner/conserver la confiance des justiciables, la justice doit être crédible et légitime.
16) Les non-juristes doivent aussi participer : Même le citoyen lambda doit pouvoir rendre la justice car il personnifie la volonté du peuple autant que les juristes.
17) Personnalisée : La justice doit tenir compte, autant que possible, des spécificités de chaque cas/situation. Elle ne peut pas appliquer les règles aveuglement de la même manière à tout un chacun.
18) Respecte les procédures : Les procédures doivent être scrupuleusement respectées dans toutes les affaires pour une question d’uniformité de la justice.
19) Sévère : Il y a souvent un écart entre le jugement populaire et celui des tribunaux. Le public veut une justice plus sévère que ce qu’elle n’est.
20) Egalité de traitement : Dans la mesure du possible, la justice doit traiter tous les citoyens de la même manière.
21) Impartiale : La justice ne doit subir aucune pression des parties. Elle doit pouvoir juger chaque justiciable selon les mêmes critères objectifs.
22) Résout tous les cas/conflits : La justice doit résoudre toutes les sortes de conflits, elle doit donner une réponse claire dans toutes les situations.
23) Inspire confiance : L’institution judiciaire doit inspirer confiance, elle doit être perçue comme fiable par les citoyens et les parties.
24) Donne raison : Les justiciables veulent que la justice leur donne raison, peu importe ce qu’ils demandent.
25) Non-corrompue : La corruption doit être bannie du monde judiciaire.
26) Prévisible : Les procédures doivent être connues et clairement expliquées aux justiciables. Ils ont le droit de savoir en avance ce qu’il va leur arriver.