Amorcée en 2013 par une série de manifestations et de grèves, la campagne pour l'augmentation du salaire minimum à 15$ aux États-Unis a entraîné un débat politique animé entre le Parti démocrate et le Parti républicain (Luckerson, Reference Luckerson2015; Wilson, Reference Wilson2017). La politisation du salaire minimum n'est cependant pas unique aux États-Unis. En Allemagne, l'adoption d'un salaire minimum constituait en 2013 une condition du parti social-démocrate pour participer à un gouvernement de coalition (Mabbett, Reference Mabbett2016). Au CanadaFootnote 1, en Corée du Sud (Min-ho, Reference Min-ho2017), au Portugal (Bugge, Reference Bugge2017) et au Royaume-Uni (Rodionova, Reference Rodionova2017), d'importantes augmentations du salaire minimum ont eu lieu ou ont été annoncées au cours des dernières années pour faire suite à des promesses électorales. Cette politisation n'est guère surprenante puisque l'enjeu du salaire minimum est lié à des débats plus généraux concernant la redistribution et la régulation de l’économie, qui sont utilisées pour distinguer la gauche de la droite (Budge, Reference Budge2013).
À ce jour, peu d’études ont toutefois abordé le lien entre la politique partisane et le salaire minimum, la littérature scientifique sur le salaire minimum ayant principalement porté sur l'impact du salaire minimum sur l'emploi et sur la pauvreté (Card et Krueger, Reference Card and Krueger.1994; Card et Krueger, Reference Card and Kruger.1995; Dolado et coll., Reference Dolado, Kramarz, Machin, Manning, Margolis, Teulings, Saint-Paul and Keen.1996; Leonard et coll., Reference Leonard, Stanley and Doucouliagos.2013; Neumark et coll., Reference Neumark, Ian Salas and Wascher.2013). Pourtant, la littérature sur l'influence de la politique partisane sur le développement de l’État-providence abonde, notamment grâce à l'apport des travaux liés à la théorie des ressources du pouvoir. Cette dernière démontre que la force des partis de gauche, de même que leur capacité à former des alliances avec d'autres partis, contribue au développement d’États-providence qui redistribuent davantage (Stephens, Reference Stephens1979; Korpi, Reference Korpi1983; Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1985).
Quelques études américaines ont trouvé un lien entre l'affiliation partisane des législateurs (Kau et Rubin, Reference Kau and Rubin1978; Krehbiel et Rivers, Reference Krehbiel and Rivers.1988) et le vote en faveur d'une hausse du salaire minimum. Au Canada, trois études (Blais et coll., Reference Blais, Cousineau and McRoberts.1989; Dickson et Myatt, Reference Dickson and Myatt.2002; Green et Harrison, Reference Green, Harrison. and Harrison2006) ont démontré que l'idéologie des gouvernements provinciaux influençait le niveau du salaire minimum. Toutefois, à notre connaissance, une seule étude quantitative porte sur l'influence de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum dans un cadre international (Rueda, Reference Rueda2008). Elle confirme l'impact de l'idéologie des gouvernements sur la fluctuation du salaire minimum, mais seulement lorsque le degré de corporatisme est faible. En contrepartie, un fort degré de corporatisme n'inciterait pas les partis politiques à adopter ou à augmenter le salaire minimum. L’étude de Rueda (Reference Rueda2008) ne se penche cependant que sur le cas de six pays qui disposent d'un salaire minimum. De plus, cette étude comparative inclut des pays sans salaire minimum national. La conclusion de l’étude, selon laquelle un degré de corporatisme élevé diminue l'effet partisan, est donc fortement influencée par le fait que plusieurs de ces pays très corporatistes n'ont aucune variation de leur salaire minimum, peu importe le parti au pouvoir.
Dans cet article, nous examinons l'impact de l'idéologie des gouvernements sur la variation du salaire minimum dans 17 pays entre 1960 et 2014. L'utilisation de données panels permet de mesurer l'impact de l'idéologie du parti au pouvoir sur l’évolution du salaire minimum dans chaque pays dans le temps et de prendre en compte différents facteurs institutionnels. Conformément à la théorie des ressources du pouvoir, nous faisons l'hypothèse que le salaire minimum devrait augmenter davantage lorsque le gouvernement est formé de partis politiques se présentant comme de gauche, puisque ces partis ont tendance à promouvoir une plus grande redistribution et une plus grande régulation du marché du travail. Comme indiqué par Rueda (Reference Rueda2008), le degré de corporatisme devrait cependant limiter l'impact de l'idéologie des partis politiques sur l’évolution du salaire minimum, puisque les négociations corporatistes permettent de fixer des revenus planchers qui limitent le travail faiblement rémunéré. Nos données confirment que le salaire minimum tend à augmenter lorsque l'idéologie des gouvernements tend vers la gauche et à diminuer lorsque l'idéologie des gouvernements tend vers la droite. De plus, nos données démontrent que la relation entre l'idéologie des gouvernements et l'évolution du salaire minimum n'est pas significative lorsque le corporatisme est fort.
L’État-providence et la théorie des ressources du pouvoir
Les théories qui utilisent l'idéologie des partis politiques pour expliquer la variation dans les politiques publiques postulent que les partis politiques proposent des politiques publiques qui correspondent aux intérêts et aux préférences de leur électorat (Hibbs, Reference Hibbs1992; Schmidt, Reference Schmidt1996). Dans l’étude des politiques sociales et de l’État-providence, cette hypothèse a principalement été défendue par les tenants de la théorie des ressources du pouvoir (Stephens, Reference Stephens1979; Korpi, Reference Korpi1983; Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1985). Cette théorie explique les différences dans l'expansion des États-providences et dans l’étendue de la régulation des marchés du travail entre les pays industrialisés par le degré de mobilisation et d'organisation de la classe ouvrière, de même que par sa capacité à former des coalitions avec d'autres groupes. L'organisation de la classe ouvrière permet de modifier le rapport de force avec les organisations qui défendent les employeurs et les classes sociales plus aisées comme les partis de droite et les entreprises privées. Le degré de syndicalisation et la fréquence des gouvernements sociaux-démocrates permettraient ainsi d'expliquer le degré de démarchandisation des États-providences, c'est-à-dire le degré d'indépendance des travailleurs par rapport au marché en cas de chômage, d'invalidité ou de vieillesse (Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1990).
Selon plusieurs chercheurs, les transformations économiques des trente dernières années ont par contre réduit l'influence de l'idéologie des gouvernements sur le développement de l’État-providence (Huber et Stephens, Reference Huber and Stephens.2001; Swank, Reference Swank2002). Selon Paul Pierson (Reference Pierson2001), l'augmentation du chômage, l'augmentation du nombre de travailleurs dans les services et les plus faibles niveaux de croissance économique depuis les années quatre-vingt ont limité la capacité des partis de gauche à étendre la couverture des programmes sociaux, tandis que la popularité de ces programmes auprès de la population a diminué la capacité des partis de droite de couper dans les programmes sociaux. De plus, la transition d'une société industrielle à une société postindustrielle a transformé le rapport entre les partis politiques et leur électorat, les nouvelles classes moyennes composées de professionnels des milieux socioculturels étant de plus en plus portées vers les partis de gauche, alors que le vote des travailleurs manufacturiers leur est de moins en moins acquis. En effet, le lien entre les classes sociales et le vote s'est considérablement affaibli avec le temps, remettant ainsi en question les prémisses de la théorie des ressources du pouvoir (Häusermann et coll., Reference Häusermann, Picot and Geering.2013). La littérature récente sur la partisanerie et l’État-providence indique que l'effet des partis politiques de gauche a en effet diminué depuis la période d'après-guerre, mais que ces partis politiques ont encore une influence significative sur le développement des politiques sociales (Schmidt Reference Schmidt, Castles, Leibfried, Lewis, Obinger and Pierson2010 ; Swank Reference Swank and Armingeon2013 ; Bandau Reference Bandau2017).
Selon la littérature, l'effet des partis politiques varie aussi en fonction des politiques publiques analysées. La littérature sur l’État-providence distingue les programmes sociaux, qui protègent des risques sociaux liés aux cycles de vie comme les soins de santé et les pensions de vieillesse, des programmes qui protègent des risques sociaux associés au marché du travail comme l'assurance-chômage (Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1999). Selon Jensen (Reference Jensen2012), l'effet de l'idéologie des partis politiques sur les programmes liés aux cycles de la vie est faible, puisque la majorité des électeurs sont exposés à ce type de risque social. À l'opposé, l'effet des partis politiques est significatif pour les programmes liés au marché du travail, puisque les électeurs des partis de gauche sont plus exposés à ces risques et en faveur d'une plus grande redistribution. L'hypothèse que les partis de gauche ont un effet significatif sur les politiques liées au marché du travail a cependant seulement été démontrée avec le programme d'assurance-chômage (Jensen, Reference Jensen2012; Bandau, Reference Bandau2017).
L'idéologie des gouvernements et le salaire minimum
Nous croyons que le salaire minimum représente également une politique sur laquelle les partis politiques pourraient avoir une influence significative. Tout d'abord, la théorie des ressources du pouvoir postule que les partis de gauche cherchent à renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs par rapport aux employeurs (Korpi, Reference Korpi1983; Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1985). Le salaire minimum permet ainsi aux partis de gauche de limiter la capacité des employeurs d'imposer de bas salaires lorsque les syndicats sont faibles (Meyer, Reference Meyer2016). De plus, les bas salaires constituent un risque social associé au marché du travail et la mobilité sociale des travailleurs faiblement rémunérés est faible (Schnabel, Reference Schmitt2016). Selon la théorie de Jensen (Reference Jensen2012), ce type de programme devrait davantage opposer les partis de droite et de gauche, puisque l’électorat de droite est moins exposé à ce type de risque social. L'idéologie des partis de gauche, ainsi que leur base électorale, devraient inciter les partis de gauche à proposer des augmentations du salaire minimum plus importantes que les partis de droite.
Au niveau empirique, de récentes études qualitatives portant sur les cas du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont démontré que la présence de partis de gauche au gouvernement avait eu une influence sur l'adoption d'un salaire minimum national dans ces pays (Mabbett, Reference Mabbett2016; Meyer, Reference Meyer2016; Wilson Reference Wilson2017). Les études quantitatives portant sur les déterminants politiques de l’évolution du salaire minimum ont également identifié un lien entre l'idéologie et l'augmentation du salaire minimum. Aux États-Unis, par exemple, les législateurs démocrates votent en plus grand nombre pour l'augmentation du salaire minimum que les législateurs républicains (Kau et Rubin, Reference Kau and Rubin1978; Krehbiel et Rivers, Reference Krehbiel and Rivers.1988). De plus, le salaire minimum augmente davantage lorsque le président et le Congrès sont démocrates (Bartels, Reference Bartels2008) ou que l'idéologie dominante de l’État est libérale (Waltman et Pittman, Reference Waltman and Pittman.2002). Au Canada, les gouvernements conservateurs provinciaux sont associés à des augmentations moins importantes du salaire minimum (Blais et coll., Reference Blais, Cousineau and McRoberts.1989; Dickson et Myatt, Reference Dickson and Myatt.2002; Green et Harrison, Reference Green, Harrison. and Harrison2006). Finalement, une étude quantitative comparée a identifié une relation entre les gouvernements de gauche et l'augmentation du salaire minimum dans les pays où le degré de corporatisme est faible (Rueda, Reference Rueda2008). Ces résultats nous amènent donc à proposer l'hypothèse suivante:
Hypothèse 1 :
Les gouvernements idéologiquement plus à gauche augmentent davantage le salaire minimum que les gouvernements idéologiquement plus à droite.
Le rôle des partis politiques dans le développement des politiques sociales, et ainsi du salaire minimum, devrait par contre varier d'un pays à l'autre en fonction des caractéristiques institutionnelles. Plus particulièrement, nous croyons que le corporatisme devrait conditionner de façon importante l'effet des partis de gauche sur l'augmentation du salaire minimum. Dans les pays où le corporatisme est fortFootnote 2, les associations d'entreprises et les syndicats sont en effet généralement impliqués dans l’élaboration des politiques publiques qui concernent le marché de l'emploi. Selon David Rueda (Reference Rueda2008), lorsque le corporatisme est fort, les partis de gauche auront tendance à se fier aux syndicats et au processus de négociation collective pour réduire les inégalités au bas de la distribution des salaires entre travailleurs. Par exemple, les partis de gauche tendent à avoir un impact sur les inégalités seulement dans les économies de marché libérales (Rueda et Pontusson, Reference Rueda and Pontusson.2000) ou dans les pays où le processus de négociation collective est décentralisé (Rueda, Pontusson et Way, Reference Pontusson, Rueda and Way.2002).
Le salaire minimum devrait être particulièrement influencé par le corporatisme, puisque la négociation est centralisée entre partenaires sociaux. Le corporatisme permet dans plusieurs pays d’établir des revenus planchers sans avoir recours à l'intervention directe des gouvernements (Meyer, Reference Meyer2016). Les syndicats, lorsqu'ils sont forts et couvrent une portion significative de la population, préfèrent ainsi éviter l'intervention directe des gouvernements dans la fixation des salaires. Ils souhaitent maintenir leur rôle dans la fixation des salaires, puisqu'un salaire minimum décidé par le gouvernement pourrait décourager les salariés faiblement rémunérés de joindre un syndicat pour négocier leurs conditions de travail (Meyer, Reference Meyer2016). À l'opposé, lorsqu'ils sont faibles et couvrent une faible part des travailleurs faiblement rémunérés, les syndicats sont favorables à l'intervention du gouvernement afin de limiter la concurrence des travailleurs faiblement rémunérés.
De plus, les procédures utilisées pour modifier le salaire minimum varient en fonction du degré de corporatisme. Ainsi dans plusieurs pays où le degré de corporatisme est élevé, les gouvernements consultent les partenaires sociaux avant d’établir le salaire minimum. À l'opposé, dans plusieurs pays avec un faible degré de corporatisme, le gouvernement tend plutôt à modifier le salaire minimum sans consultation formelle (voir le tableau 2 à l'annexe 1). Les gouvernements qui n'ont pas à négocier avec les partenaires sociaux et à respecter des règles fixes devraient donc avoir une plus grande marge de manœuvre pour fixer le salaire minimum en fonction de leur idéologie.
L'effet du degré de corporatisme devrait surtout se situer au niveau transversal puisque le degré de corporatisme varie davantage entre les pays que dans le temps dans un même pays. Ainsi nous proposons l'effet d'interaction suivant quant à l'effet de l'idéologie des gouvernements et du degré de corporatisme sur le salaire minimum :
Hypothèse 2 :
L'effet des gouvernements idéologiquement plus à gauche sur le salaire minimum est positif lorsque le degré de corporatisme est faible et nul lorsque le degré de corporatisme est fort.
Les deux hypothèses retenues sont similaires à celles testées par Rueda (Reference Rueda2008). La contribution de cette analyse est donc principalement empirique. L’étude de Rueda est composée de 6 pays avec un salaire minimum et de 9 pays sans salaire minimum entre les années 1970 et 1990. Selon Rueda, les résultats de l’étude démontrent une relation entre les gouvernements de gauche et l'augmentation du salaire minimum, mais seulement dans les pays où le degré de corporatisme est faible. Selon nous, les résultats de Rueda ne permettent toutefois pas de conclure que le corporatisme limite l'influence de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum et particulièrement sur l'augmentation du salaire minimum. Une limite importante de l'analyse de Rueda est que plusieurs des pays qui ont un degré de corporatisme élevé n'ont pas de salaire minimum en vigueur. Il n'est donc pas possible de mesurer l'effet des partis de gauche sur le salaire minimum dans ces pays corporatistes n'ayant au préalable pas de salaire minimum. Ainsi, afin de vérifier si le corporatisme conditionne l'effet de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum, il est nécessaire d’étudier des pays ayant adopté le salaire minimum et présentant des degrés de corporatisme différents. Il existe pourtant plusieurs pays qui ont à la fois un salaire minimum fixé par le gouvernement et un degré de corporatisme élevé qui facilite la régulation du marché de l'emploi par les accords entre partenaires sociaux. Par conséquent, notre étude propose un test empirique plus exhaustif en intégrant 17 pays qui ont un salaire minimum et qui ont des degrés de corporatisme divers sur la période 1960–2014. Cette augmentation du nombre de pays est tout d'abord due à l'intégration de pays d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est qui se sont démocratisés dans les cinquante dernières années. De plus, plusieurs pays qui n'avaient pas de salaire minimum national durant la période de l’étude de Rueda ont aujourd'hui un salaire minimum, comme l'Australie, l'Irlande et le Royaume-Uni.
Méthode
Données et variables
L'OCDE publie différentes données sur le salaire minimum de ses pays membres. L'indicateur le plus pertinent pour une étude comparative est le ratio du salaire minimum sur le salaire médian des travailleurs à temps plein. La plupart des études sur le salaire minimum utilisent le ratio du salaire minimum sur le salaire moyen afin de contrôler pour la croissance des salaires dans le temps (Blais, Reference Blais, Cousineau and McRoberts.1989 ; Myatt et Dickson, Reference Dickson and Myatt.2002; Rueda, Reference Rueda2008). L'OCDE recommande toutefois d'utiliser le ratio par rapport au salaire médian puisqu'il reflète davantage le niveau de salaire des travailleurs au milieu de la distribution des revenus (OCDE, 2017)Footnote 3.
L'analyse inclut les pays suivants : Australie (1997–2014), Belgique (1975–2013), Espagne (1979–2013), États-Unis (1960–2014), France (1960–2013), Grèce (1976–2013), Hongrie (1994–2013), Irlande (2000–2014), Japon (1975–2014), Luxembourg (1971–2012), Nouvelle-Zélande (1969–2014), Pays-Bas (1964–2013), Pologne (1991–2012), Portugal (1982–2012), République Tchèque (1993–2013), Royaume-Uni (1999–2014) et Slovaquie (1994–2013)Footnote 4. Le fait d'utiliser des données récentes nous permet d'intégrer un plus grand nombre de pays. Toutefois, l’étendue des années disponibles avec la base de données de l'OCDE varie de manière importante entre les pays. Certains pays ont des données disponibles depuis le début des années soixante. D'autres pays ont des données seulement à partir du milieu des années 1990. Par conséquent, nous avons effectué un test de robustesse qui démontre que les résultats sont similaires lorsque l'on sélectionne uniquement les pays qui ont des données depuis les années 1960–1970 (voir le tableau 4 à l'annexe 3).
Les études qui ont examiné l'impact de la composition des gouvernements sur le développement de l’État-providence utilisent généralement la proportion de partis de gauche au cabinet mesurée par année ou grâce à une moyenne cumulative (Esping-Andersen, Reference Esping-Andersen1990; Huber et Stephens, Reference Huber and Stephens.2001; Korpi et Palme, Reference Korpi and Palme.2003; Allan et Scruggs, Reference Allan and Scruggs.2004). En codifiant uniquement les partis de gauche, cet indicateur ne prend pas en compte la grande variation dans l'idéologie des partis politiques qui ne s'identifient pas à la gauche. À titre d'exemple, les partis chrétiens-démocrates favorables à l’État-providence sont comptabilisés de la même manière qu'un parti conservateur qui souhaite réduire la taille de l’État (Döring et Schwander, Reference Döring and Schwander2015). De plus, cet indicateur postule que les intérêts et positions des partis de gauche sont similaires à la fois entre les pays et dans le temps.
Une mesure qui prend à la fois en compte le changement de positions des partis politiques dans le temps et entre les pays représenterait une mesure plus adéquate de l'idéologie des gouvernements. Le « Comparative Manifesto Database » produit un tel indicateur de la position de chaque parti politique sur une échelle gauche-droite à partir d'une étude des programmes électoraux des partis à chaque élection. L'indicateur se situe entre -100, indiquant un parti très à gauche, et 100, indiquant un parti très à droite (Budge, Reference Budge2013). Cet indicateur est basé sur la quantification des thématiques liées à la division gauche-droite incluses dans les plates-formes électoralesFootnote 5. Cet indicateur mesure donc les orientations générales que les partis politiques présentent à l’électorat. Ainsi un parti qui mentionne à plusieurs reprises être en faveur de régulations économiques ou d’étendre les programmes sociaux sera considéré comme à gauche et aura un indicateur avec une valeur négativeFootnote 6.
La position de chaque gouvernement est mesurée en regroupant les scores des différents partis en fonction de la proportion des sièges que chaque parti occupe au cabinet (Seki et Williams, Reference Seki and Williams2014). Les données sont issues de la base de données « Seki-Williams Annual Government Partisanship » qui combine les données du Comparative Manifesto Project pour créer un indicateur de l'idéologie des gouvernements (Seki et Williams, Reference Seki and Williams2014). Afin de confirmer l'hypothèse 1, l'effet de l'idéologie du gouvernement sur le salaire minimum devrait être négatif, ce qui indiquerait que les gouvernements de gauche (valeurs négatives) sont associés à une augmentation du salaire minimum.
Le degré de corporatisme est mesuré à l'aide d'un indicateur de coordination dans la fixation des salaires de la base de données « Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts » (Visser, Reference Visser2016). Cet indicateur est une variable ordinale qui comprend 5 valeurs (1, 2, 3, 4, 5). Les valeurs 1, 2 et 3 désignent un système de négociation collective faiblement coordonnée principalement entre les firmes ou les secteurs d'activité avec au maximum des lignes directrices pour la négociation au niveau national, tandis que les valeurs 4 et 5 désignent un système de négociation collective qui mène à l'imposition des standards nationauxFootnote 7. Comme il existe peu de cas dans chaque catégorie, nous avons créé une variable dichotomique. Un degré de corporatisme faible regroupe les degrés 1, 2 et 3 de la mesure de coordination dans la fixation des salaires, tandis qu'un degré de corporatisme fort représente les degrés 4 et 5Footnote 8. Différentes mesures existent pour mesurer le degré du corporatisme. Elles mettent l'accent sur l'organisation des partenaires sociaux, la participation de ces groupes au processus de décision ou le degré de consensus (Kenworthy, Reference Kenworthy2003). Malheureusement, les bases de données qui combinent différentes variables pour composer un indice de corporatisme ont un nombre de pays ou d'années souvent limité. L'index de coordination dans la fixation des salaires a l'avantage d’être disponible pour un grand nombre d'années et de pays. De plus, elle analyse la coordination entre partenaires sociaux plutôt que la structure des regroupements de syndicats et d'entreprises séparément. Nous utiliserons cet indicateur dans le deuxième modèle dans un effet d'interaction avec l'idéologie gouvernementale. L'effet du degré de corporatisme devrait surtout se situer au niveau transversal.Footnote 9 Plus précisément, nous anticipons que les partis de gauche ont un plus grand impact sur l’évolution du salaire minimum dans les pays avec un faible degré de corporatisme que dans les pays avec un degré élevé de corporatisme.
Variables de contrôles
Les syndicats ont intérêt à maintenir un revenu minimum plancher élevé afin de limiter la compétition des travailleurs faiblement rémunérés et non syndiqués (Rueda, Reference Rueda2008; Meyer, Reference Meyer2016). La force des syndicats devrait donc avoir une relation positive avec la variation du salaire minimum. De plus, comme les syndicats sont à la fois liés aux partis de gauche et au corporatisme, il importe de distinguer la force des syndicats des deux variables principales de cette étude. La force des syndicats est généralement mesurée à l'aide de la densité syndicale, c'est-à-dire le pourcentage de travailleurs membres d'un syndicat dans un pays. Nous avons obtenu les données sur la densité syndicale grâce à la base de données de « Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts » (Visser, Reference Visser2016).
La majorité des discussions et des débats autour du salaire minimum portent sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi. Une variable contrôle pour le taux de chômage a donc été incluse dans le modèle afin de vérifier s'il influence l'effet de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum. En période de chômage élevé, les gouvernements, peu importe leur allégeance idéologique, pourraient être plus réticents à augmenter le salaire minimum compte tenu des risques potentiels sur l'emploi évoqués par plusieurs économistes (Blais et coll., Reference Blais, Cousineau and McRoberts.1989). Le taux de chômage est mesuré en pourcentage de la force de travail et est issu de la base de données de l’« Annual macro-economic database of the European Commission » (AMECO, 2017).
Modèle
Les données retenues pour l'analyse correspondent à des données de type Time-Series-Cross-Section (TSCS), puisqu'elles ont une dimension transversale avec un nombre de pays relativement petit (N = 17) et une dimension longitudinale où nous avons plusieurs observations par pays dans le temps (1960–2014), pour un total de 171 observations. La plupart des travaux sur l'effet des partis politiques utilisent des données pour chaque année-pays. L'utilisation de ce type de données peut cependant biaiser les résultats et réduire artificiellement l'effet des partis politiques, puisque l'idéologie des gouvernements ne change pas chaque année (Schmitt, Reference Schmitt2016). Nous calculons donc l'effet de l'idéologie des gouvernements sur la variation du salaire minimum entre le début et la fin d'un mandat gouvernementalFootnote 10. Notre hypothèse, basée sur l'effet de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum, est davantage compatible avec une analyse de la dimension longitudinale de l'effet de l'idéologie des gouvernements, puisque c'est l'idéologie des gouvernements qui devrait influencer la variation du salaire minimum dans le temps à l'intérieur de chaque pays.
Par conséquent, nous utilisons un modèle de régression des moindres carrés ordinaires avec des effets fixes au niveau des pays, ce qui permet de mesurer l'effet moyen de l'idéologie des gouvernements intra-pays (within-effect). De plus, les effets fixes au niveau des pays nous permettent de contrôler pour des variables omises du modèle au niveau du paysFootnote 11.
Différents tests de diagnostics nous ont indiqué la présence d'hétéroscédasticité interpanel et d'autocorrélation intrapanelFootnote 12. L'utilisation d'erreurs types robustes ajustées par cluster (Cluster-robust standard errors) entraînerait toutefois un biais compte tenu du faible nombre de « clusters ». Nous utilisons donc un modèle de régression linéaire avec des erreurs types robustes corrigées pour de petits échantillons développé par Pustejovsky et Tipton (Reference Pustejovsky and Tipton.2016).
Afin de tester les deux hypothèses, nous utiliserons deux modèles. Le premier modèle permettra de mesurer l'effet de l'idéologie des gouvernements. Le deuxième modèle permettra, quant à lui, de mesurer l'effet du corporatisme sur l'influence de l'idéologie des gouvernements sur le salaire minimum grâce à l'utilisation d'un effet d'interaction entre le degré de corporatisme et l'idéologie des gouvernements. Ainsi nous pourrons déterminer si les partis politiques ont une influence sur la variation du salaire minimum dans les pays où le degré de corporatisme est fort.
Résultats
Dans la première colonne du tableau 1, nous présentons les résultats du premier modèle, qui analyse l'effet de l'idéologie des gouvernements sur la variation du salaire minimum. L'hypothèse 1 postule que les gouvernements idéologiquement plus à gauche augmentent davantage le salaire minimum. Les résultats du tableau 1 indiquent que le coefficient pour la variation de l'idéologie des gouvernements est négatif et statistiquement significatif avec un intervalle de confiance à 95%. Ainsi, un gouvernement plus à gauche avec une idéologie de 10 points sur l’échelle de l'idéologie des gouvernements (-100 à 100) est associé à une augmentation de 0,8 du ratio du salaire minimum par rapport au salaire médian durant le mandatFootnote 13.
Tableau 1 : L'influence des partis politiques sur le salaire minimum

Erreurs types entre paranthesès. *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01.
L'effet du niveau de corporatisme
La deuxième hypothèse postule que l'effet de l'idéologie des gouvernements sur la variation du salaire minimum est positif lorsque le degré de corporatisme est faible, mais nul lorsque le degré de corporatisme est fort. Les résultats à la colonne 2 du tableau 1 confirment cette hypothèse. Comme prédit, l'effet de l'idéologie des gouvernements sur l’évolution du salaire minimum est négatif et statistiquement significatif lorsque le niveau de corporatisme est faible (voir le coefficient de corporatisme faible X idéologie, -0,12). Toutefois, lorsque le niveau de corporatisme est fort, l'effet de l'idéologie n'est pas statistiquement différent de zéro (voir coefficient de corporatisme fort X idéologie des gouvernements, 0.01). De plus, un test de Wald démontre que la différence des effets de corporatisme faible X idéologie et de corporatisme fort X idéologie est statistiquement significativeFootnote 14.
Discussion
Le rôle des partis politiques de gauche est central aux recherches sur l’État-providence et le développement des programmes sociaux. Alors que les études se sont concentrées sur l’évolution des pensions de vieillesse et de l'assurance-chômage, peu d’études ont examiné le salaire minimum. En se basant sur la théorie des ressources de pouvoir et l'argument de Rueda quant au rôle du corporatisme sur l'impact des partis politiques dans le développement des politiques sociales, nous avons émis l'hypothèse que les gouvernements idéologiquement plus à gauche sont associés à des augmentations plus importantes du salaire minimum et que le degré corporatisme diminue l'impact de l'idéologie des gouvernements sur l’évolution du salaire minimum.
En utilisant les données de l'OCDE et du « Comparative Manifesto Project » pour 17 pays entre 1960 et 2014, nos analyses confirment principalement le rôle des partis de gauche sur l’évolution du salaire minimum. Ainsi, si des partis politiques qui promettent davantage de régulation économique et une expansion de l’État-providence font partie du gouvernement, le salaire minimum aura davantage tendance à augmenter. À l'opposé, si des partis politiques de droite qui promettent une réduction des dépenses et une libéralisation du marché de l'emploi sont élus, le salaire minimum aura tendance à diminuer par rapport au salaire médian durant le mandat de ce gouvernement. Les résultats sont donc conformes aux attentes de la théorie des ressources du pouvoir, qui postule que les partis de gauche ont un effet sur l’évolution des programmes sociaux et particulièrement sur les programmes qui renforcent le pouvoir de négociation des travailleurs. Cette théorie est toutefois seulement valide pour expliquer l’évolution du salaire minimum lorsque le niveau de corporatisme est faible. Cette relation vient aussi supporter la théorie de Jensen (Reference Jensen2012) que la présence de partis de gauche au gouvernement a un impact significatif sur les programmes sociaux liés au marché du travail. Les politiques liées au marché du travail comme le salaire minimum et l'assurance-chômage redistribuent davantage la richesse entre différentes catégories de travailleurs. Selon cette théorie les partis de gauche ont donc principalement une influence sur les politiques de redistribution verticales.
La majorité des données utilisées dans cette analyse sont relativement récentes, 84% datant d'après 1980 et 66% d'après 1990. L'effet des partis politiques sur le salaire minimum est donc demeuré significatif, et ce, malgré le constat fait par de nombreux chercheurs que la marge de manœuvre des partis politiques a diminué à la suite des transformations économiques des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix (Huber et Stephens, Reference Huber and Stephens.2001 ; Pierson, Reference Pierson2001 ; Swank, Reference Swank2002) et que l’électorat des partis politiques a changé radicalement en raison de la transition vers une société postindustrielle (Häusermann et coll., Reference Häusermann, Picot and Geering.2013). Selon Shaun Wilson, ce sont ces transformations économiques qui ont contribué à politiser le salaire minimum ces dernières années. Les augmentations récentes du salaire minimum dans certains pays, comme la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, découleraient ainsi d'une volonté d'aider les travailleurs à faible revenu à la suite des réformes néolibérales qui ont affaibli les syndicats et réduit les dépenses sociales. Les stratégies de prédistribution comme l'augmentation du salaire minimum seraient particulièrement avantageuses pour les partis de gauche puisqu'ils permettent de satisfaire leur électorat sans augmenter les dépenses sociales et les taxes. Une meilleure compréhension du comportement électoral des travailleurs faiblement rémunérés est toutefois nécessaire afin de déterminer si l'effet des partis de gauche sur le salaire minimum découle d'une volonté de mobiliser un électorat qui leur est favorable.
Finalement, nos résultats confirment également le rôle du corporatisme sur la relation entre l'idéologie des gouvernements et l’évolution du salaire minimum. La relation statistique entre l'idéologie des gouvernements et l’évolution du salaire minimum n'est en effet pas significative lorsque le niveau de corporatisme est élevé. La théorie avancée par David Rueda (Reference Rueda2008) est que les gouvernements s'intéressent peu au salaire minimum lorsque le corporatisme est élevé, puisque les partenaires sociaux sont capables de fixer des revenus planchers. Historiquement, dans les pays qui disposent d'un salaire minimum national et ont un processus de négociation salariale relativement centralisé, le salaire minimum national avait tendance à être plus élevé que dans les pays où le processus de négociation collective est décentralisé et couvre une faible proportion des travailleurs (Grimshaw, Reference Grimshaw, Bosch. and Grimshaw2013 : 52–53). Ces dernières années, toutefois, les pays où la coordination entre les entreprises et les syndicats est relativement forte sont les seuls pays de l'OCDE à avoir connu une baisse importante du salaire minimum (Grimshaw, Reference Grimshaw, Bosch. and Grimshaw2013 : 76). Ainsi, aux Pays-Bas, le salaire minimum a diminué significativement passant de l’équivalent de 68% du revenu médian en 1967 à 45% en 2016. De plus, cette baisse du salaire minimum a été accompagnée d'un déclin des salaires minimums planchers au niveau sectoriel (de Beer, Been et Salverda, Reference De Beer, Been and Salverda2017). Pour le moment, la littérature sur le salaire minimum n'a pas développé de théorie permettant d'expliquer la variation du salaire minimum dans les pays avec un fort degré de corporatisme. Des études de cas permettraient de mieux comprendre les interactions politiques entre les gouvernements et partenaires sociaux qui ont mené au déclin du salaire minimum dans plusieurs pays avec un fort degré de corporatisme.
ANNEXE 1
Tableau 2 : Pays par degré de corporatisme et mode de fixation du salaire minimum (Visser, Reference Visser2016)Footnote 15
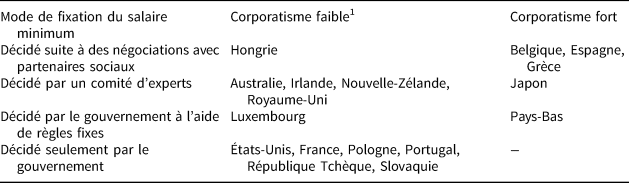
ANNEXE 2
Tableau 3 : Moyenne, minimum et maximum de l'indicateur de l'idéologie des gouvernements

ANNEXE 3
Tableau 4 : Tests de robustesse : L'influence des partis politiques sur le salaire minimum







