1. INTRODUCTION
Partant de l’hypothèse que la langue littéraire (Philippe et Piat, Reference Philippe and et Piat2009) se caractérise par la surreprésentation significative de phraséologismes (Siepmann, Reference Siepmann2015), nous proposons de montrer que les unités phraséologiques, extraites par des méthodes statistiques, permettent de contraster les corpus romanesques. Des études récentes ont révélé que les phénomènes phraséologiques permettent de distinguer le roman policier du roman sentimental (Gonon, Goossens et Novakova, Reference Gonon, Goossens, et Novakova, Buffard-Moret, Mejri and Meneses-Lerín2019 sous presse) ou le roman policier de la littérature blanche (Gonon, Goossens, Kraif, Novakova et Sorba, Reference Gonon, Goossens, Kraif, Novakova, et Sorba, Neveu, Harmegnies, Hriba and Prévost2018). Il est ainsi possible de contraster les sous-genres romanesques (Rastier, Reference Rastier2013 : 78) dits de la paralittérature (Boyer, Reference Boyer2008) et le roman dit de littérature blanche, relevant de la littérature générale, qui paraît dans des collections non spécialisées. Nous proposons d’explorer ici une nouvelle piste en contrastant les unités phraséologiques de l’interaction verbale spécifiques aux romans de littérature blanche (GEN) et aux romans historiques (HIST).
2. CADRE THÉORIQUE
Notre étude s’inspire des modèles fonctionnels et contextualistes (Sinclair, Reference Sinclair2004), qui explorent systématiquement quatre niveaux (lexical, sémantique, syntaxique et discursif) pour l’analyse des unités linguistiques. Ces analyses permettent de faire émerger des motifs que nous définissons, à la suite de Longrée et Mellet (Reference Longrée and et Mellet2013 : 66), comme « un “cadre collocationnel” accueillant un ensemble d’éléments fixes et variables susceptibles d’accompagner la structuration textuelle, et simultanément, de caractériser des textes de genres divers ». Les motifs peuvent être considérés comme des « unités multidimensionnelles », constituées à la fois d’associations lexicales et grammaticales, d’appariements entre forme et sens, entre forme et fonction grammaticale (Legallois, Reference Legallois2012 : 45). Les motifs sont donc des objets complexes pour l’identification desquels nous envisageons plusieurs critères de variations syntagmatique et paradigmatique, et une fonction discursive (FD), susceptible de varier selon les contextes. Nous proposons de les considérer non seulement comme « susceptibles d’accompagner la structuration textuelle » mais bien comme des schémas renseignant sur la structuration et l’interprétation du texte.
Des études récentes ont permis de mettre en évidence des motifs spécifiques à plusieurs sous-genres romanesques comme le roman sentimental (Legallois, Charnois et Poibeau, Reference Legallois, Charnois and et Poibeau2016) ou le roman policier (Novakova et Sorba, Reference Novakova and et Sorba2017). Ainsi, nous nous intéressons à la phraséologie, mais selon une conception étendue qui ne se limite plus aux seules associations de lexies : « La phraséologie intègre désormais des objets d’étude très variés, allant des collocations aux séquences discursives en passant par la parémiologie, ou encore, les schémas syntaxiques. » (Legallois et Tutin, Reference Legallois and et Tutin2013 : 3).
3. CORPUS Et MÉTHODOLOGIE
Notre corpusFootnote 1 est constitué de romans français postérieurs à 1950 (voir tableau 1) : romans historiques (HIST) et romans de littérature blanche ou générale (GEN).
Tableau 1. Présentation du corpus

Le corpus est interrogé au moyen de l’interface Lexicoscope (Kraif, Reference Kraif2016). Il a été annoté syntaxiquement au moyen de l’analyseur Xip (Aït Mokhtar, Chanod et Roux, Reference Aït Mokhtar, Chanod and et Roux2001), ce qui permet d’en extraire automatiquement des arbres lexico-syntaxiques récurrents (ALR, voir Tutin et Kraif, Reference Tutin and et Kraif2016 et figure 1) et de privilégier ainsi une approche essentiellement inductive (corpus-driven). Ces ALR, regroupant des unités lexicales reliées par des dépendances syntaxiques, sont construits à partir de séries de cooccurrences statistiquement significatives.
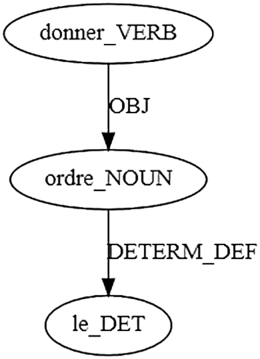
Figure 1. ALR donner l’ordre
Les ALR sont extraits des deux corpus à partir des pivots nominaux et verbaux dont la fréquence est supérieure à 5 ; puis leurs fréquences respectives sont comparées afin de mesurer leur spécificité dans chaque corpus. Suivant la méthode Keywords (Bertels et Speelmann, Reference Bertels and et Speelmann2013), le calcul du rapport de vraisemblance ou log-likelihood ratio (LLR, Dunning Reference Dunning1993) est utilisé pour déterminer si une répartition s’écarte (ou non) significativement d’une distribution aléatoire. De la sorte, sont mis en évidence les ALR dont la fréquence relative dans l’un des deux corpus est significativement supérieure à la fréquence dans l’autre. Les critères retenus pour sélectionner des ALR représentatifs sont (1) un critère statistique avec un LLR supérieur ou égal à 10,83, seuil à partir duquel la surreprésentation de l’ALR dans un corpus peut être considérée comme statistiquement significative ; (2) un critère morpho-syntaxique qui ne retient que les ALR contenant des verbes, ce qui permet d’exclure les expressions exclusivement référentielles (comme le Roi de France).
Une fois ces critères appliqués, nous obtenons 2,589 ALR spécifiques à HIST et 3,828 ALR spécifiques à GEN. Nous avons ensuite opéré un second filtrage avec un LLR supérieur à 20, un nombre d’occurrences supérieur à 100 en maintenant une dispersion couvrant au minimum 20% des auteurs dans chaque corpus. À l’issue de cette opération, demeurent, dans HIST, des ALR présentant des archaïsmes stylistiques propres au roman historique (par ex. : dire vrai, ne … point, avoir ouï) ainsi que des ALR au contenu plus référentiel traduisant une société hiérarchisée (par ex. : monter sur le trône, ils s’inclinent, baiser les mains, être le chef) et guerrière (par ex. : venir à bout, fait la guerre, se faire égorger). À côté de ces thématiques et traits stylistiques attendus, apparaissent des ALR a priori moins spécifiques de HIST dénotant une interaction verbale à voix haute entre deux personnages (par ex. : le roi dit, je dis monsieur, j’ai ouï, tu as raison, prend la parole, nous avons besoin, je vous assure). Dans le corpus GEN, les ALR relevant du domaine de l’interaction verbale se rencontrent également, mais celle-ci est nettement plus variée, et empiète sur le domaine de la cognition, l’interlocution étant plus souvent tournée vers l’intériorité (discours intérieur, discussion avec un interlocuteur tu intime de façon peu formelle, mais aussi avec soi-même) : par ex. j’ai envie, j’ai peur, disant que c’était, je voulais pas, je me rappelais, j’ai besoin, je lui dis, c’est moi, je crois que c’est, il dit que, je le savais. Ces ALR sont parmi les plus représentatifs statistiquement des corpus GEN et HIST lorsqu’ils sont comparés. Ainsi, ce sont l’émergence des données dans le cadre d’une linguistique corpus-driven et le critère sémantique (interaction verbale) qui ont guidé notre choix des expressions pour étudier la spécificité du roman et non pas celle des différentes séquences (récit, discours) le constituant.
Dans cet ensemble d’ALR de parole, nous choisissons de décrire, dans chaque corpus, quatre constructions lexico-syntaxiques (CLS) présentées dans le tableau 2 avec LLR et nombre d’occurrences entre parenthèses. Les critères de sélection des ALR sont les mêmes : les ALR ont tous un verbe et sont constitués de trois items, mais les constituants peuvent varier autour du pivot verbal (parfois avec expression du second actant, parfois avec expression d’un circonstant). Notre sélection de quatre CLS dans chaque corpus repose sur leur LLR élevé et permet de constituer un échantillon représentatif afin d’avoir plusieurs points de comparaison dans l’analyse des motifs.
Tableau 2. Les huit CLS retenues pour l’étude
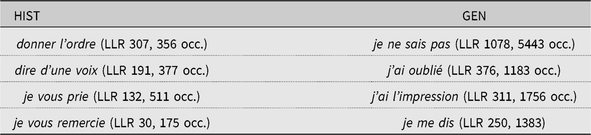
Dans le tableau 2, donner l’ordre et dire d’une voix (HIST) sont indiqués à l’infinitif car l’extraction n’a pas fourni de personne ni de temps spécifique contrairement aux autres CLS qui sont systématiquement associées à la première personne par exemple.
L’étude des CLS, qui représentent l’actualisation des ALR dans les textes, permet de conclure à l’existence ou non du motif correspondant. L’ALR fait remonter le prototype qui se réalise sous la forme d’une CLS : si celle-ci connaît des variations et a une FD, c’est un motif. L’analyse linguistique des variations paradigmatiques et syntagmatiques autour des noyaux de ces 8 CLS permettra d’identifier et d’analyser les motifs spécifiques à chaque sous-genre au sein desquels ces CLS se retrouvent. Sur le plan stylistique, nous étudierons les fonctions discursives (FD),Footnote 2 en tant qu’organisatrices du discours narratif (Legallois Reference Legallois2012 : 45). Nous entendons par FD, les fonctions textuelles des motifs, celles qui jouent un rôle dans la cohérence du discours romanesque (Martin, Reference Martin1983 : 15–16). Et dans le roman, les FD des motifs sont avant tout narrative ou descriptive (Adam, Reference Adam2011 : 267), mais nous verrons qu’elles ne se limitent pas à ces deux emplois (certains motifs occupent une FD pragmatique ou cognitiveFootnote 3). Ainsi, nous nous interrogerons sur la façon dont la phraséologie étendue permet, d’une part, de définir autrement les genres paralittéraires – représentés ici par les romans historiques – qui le sont d’ordinaire soit par des critères éditoriaux, soit par des ouvrages de critique littéraire envisageant essentiellement leur thématique et leur macrostructure (Krulic, Reference Krulic2007 ; Gengembre, Reference Gengembre2005), mais très rarement leur phraséologie et son usage statistique ; d’autre part, notre objectif est d’identifier certaines spécificités de la langue littéraire romanesque.
4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Pour chaque CLS, nous analyserons tout d’abord les variations paradigmatiques et syntagmatiques actualisées autour du noyau syntaxique avant de détailler leurs FD. L’ensemble de ces données permet de mettre en évidence le fonctionnement de ces motifs dans chaque sous-genre romanesque. Les exemples sont tous issus du corpus. Ils illustrent les phénomènes linguistiques décrits et quantifiés par les analyses et en sont donc représentatifs.
4.1. Les motifs autour des CLS de parole dans HIST
Dans HIST, parmi les quatre CLS de parole retenues (donner l’ordre, dire d’une voix, je vous prie, je vous remercie), donner l’ordre présente le LLR le plus élevé (307.84) et donc la spécificité la plus élevée. La mise en scène récurrente des rapports de pouvoir dans le roman historique est très certainement à l’origine de ce premier résultat.
4.1.1. Les variations paradigmatiques
L’analyse des variations paradigmatiques porte sur les constituants du noyau de chaque CLS à savoir le verbe et, éventuellement, le déterminant pour donner l’ordre et dire d’une voix.
Pour ces deux CLS, seule donner l’/les ordre(s) connaît une variation du déterminant. Bien que le pluriel apparaisse de manière marginale dans 8% des occurrences (28/356 occ.), cette variation du déterminant semble propice à une configuration syntaxique particulière. En effet, le pluriel ordres apparaît dans des constructions dépouillées (exemple 1) alors que ce n’est pas le cas de la CLS au singulier.Footnote 4
1) Madeleine donna les ordres, fila à sa chambre, revint habillée. (P. Lemaitre, Au revoir là-haut, 2013)
La construction dépouillée donner les ordres se rencontre dans un contexte très marqué hiérarchiquement où un supérieur s’adresse à un inférieur, ici les domestiques de la maisonnée.
Pour les deux CLS donner l’ordre et dire d’une voix, la personne la plus usitée est la 3e du singulier : pour donner l’ordre (203/356 occ. soit 57%, voir exemple 1) et pour dire d’une voix (305/377 occ. soit 81%, voir exemple 2) ; elles se rencontrent parfois avec une première personne du singulier (respectivement 30/377 occ. soit 8% et 48/356 occ soit 13%) et beaucoup plus sporadiquement avec les autres personnes.
2) Puis, comme en sortant d’un rêve, le comte se tourna vers son camarade et lui dit d’une voix sourde : « Adieu, mon ami, et merci pour ton aide, merci pour ta confiance ! » (P. Laine, Fleur de pavé, 1996)
Les exemples 1 et 2 sont représentatifs des temps verbaux les plus usités dans les deux CLS (ici le passé simple) car donner l’ordre et dire d’une voix privilégient les temps du passé au service de la narration et de la description tels l’imparfait (exemple 3), le passé composé (exemple 4) et le plus-que-parfait (exemple 5) :
3) Surpris, il eut un sursaut de recul, tandis qu’elle lui disait d’une voix calme : … (B. Clavel, Les Colonnes du ciel t.3, 1978)
4) Jiang Qing a donné l’ordre de laisser entrer quelques centaines de Gardes Rouges dans Zhongnanhai… (L. Bodard, Le Chien de Mao, 1998)
5) Comme il partait, Cassandre lui avait dit d’une voix froide : … (J. d’Aillon, La Guerre des trois Henri t.3, 2009)
Cette situation de grande variation sur les temps verbaux contraste avec celle des deux autres CLS je vous remercie et je vous prie, quasi-exclusivement attestées au présent de l’indicatif (respectivement 166/175 occ. soit 95% et 496/511 occ. soit 97%) qui revêt sa valeur déictique dans un énoncé ancré (exemples 6 et 7) :
6) – Ma santé est meilleure, je vous remercie. (J.-C. Rufin, Rouge Brésil, 2001)
7) Je vous prie instamment d’insister auprès du roi pour qu’il accepte ma démission… (R. Merle, Fortune de France t.12, 2001)
Ces deux CLS semblent donc nettement moins susceptibles de variations paradigmatiques que les deux autres donner l’ordre et dire d’une voix. Ce résultat était prévisible dans la mesure où les deux CLS ont un emploi de routine conversationnelle (sur ce point, voir Née, Sitri et Veniard Reference Née, Sitri and et Veniard2016) dans l’interaction verbale.
4.1.2. Les variations syntagmatiques
L’étude des variations syntagmatiques porte sur les extensions privilégiées du noyau de chaque CLS c’est-à-dire sur sa combinatoire lexico-syntaxique.Footnote 5
Parmi les quatre CLS, dire d’une voix présente le plus grand nombre de collocatifs (32). Il s’agit majoritairement (60%) d’adjectifs qualificatifs caractérisant l’intensité de la voix (dire d’une voix forte, haute, douce, basse, sourde, éteinte, ténu, étouffée, faible, petite) ou la qualité de la diction (dire d’une voix claire, grave, ferme, calme, brève, tremblante, entrecoupée, trémulante, sèche). La CLS donner l’ordre présente aussi de nombreux collocatifs (21), mais de natures grammaticales différentes car il s’agit essentiellement de pronoms (33%), de verbes (28%) et de noms (24%). Le sens des lexies de ces deux dernières catégories (verbes et noms), relève des champs de la ‘guerre’ (attaquer, tirer, charger ; troupe, général, officier) et du ‘mouvement’ (arrêter, aller ; départ) et contribue ainsi à ancrer le corpus HIST dans un univers de référence bien particulier. Le collocatif pronominal le plus spécifique pour donner l’ordre est l’anaphorique complément en (LLR 149.3). Par comparaison, les deux autres CLS je vous prie et je vous remercie présentent peu de collocatifs (respectivement 9 et 4). Il s’agit principalement de verbes de parole (respectivement supplier, ordonner et dire) et de cognition (respectivement pardonner, croire et savoir). La combinatoire lexicale des quatre CLS reflète la même tendance que celle observée précédemment sur l’axe paradigmatique, à savoir que je vous prie et je vous remercie connaissent moins de variations sur l’axe syntagmatique que donner l’ordre et dire d’une voix.
Sur le plan syntaxique, les variations syntagmatiques concernent l’absence ou la présence d’une complémentation de la CLS. Pour dire d’une voix, la complémentation se traduit par la présence systématique d’une expansion du nomFootnote 6, qu’il s’agisse d’un adjectif qualificatif épithète (voir liste supra), d’un complément du nom (exemple 8) ou d’une proposition subordonnée relative (exemple 9) :
8) Comme s’il avait craint que nous n’échangions des souvenirs, mon protecteur a dit aussitôt, d’une voix de commandement : … (M. Gallo, Croix de l’Occident t.1, 2004)
9) Le chauffeur dit d’une voix qui portait l’angoisse : … (B. Clavel, Le Soleil des morts, 1998)
Dans le cas de donner l’ordre, la complémentation sur le plan syntagmatique est plus variée. En effet, le noyau peut être complété par la mention du destinataire Y (X donner l’ordre à Y, exemple 10) et parfois d’une expansion du nom ordre (24/356 occ. soit 6%), relevant majoritairement du champ sémantique de la ‘guerre’, qu’il s’agisse d’un adjectif qualificatif (ordre écrit, formel, impérieux, nécessaire, salvateur, ultimes, promis), d’une proposition relative (ordre que ceux-ci réclamaient, qu’il vous plaît) ou d’un complément du nom (ordre de la retraite, de la résistance, du départ, de l’attaque, de repli, de rassemblement). Par ailleurs, le contenu de l’ordre est précisé dans presque toutes les occurrencesFootnote 7 sous la forme d’une proposition du type Vinf (exemple 10) ou queP (exemple 11) ou bien par le pronom anaphorique en (exemple 12) :
10) J’ai donné l’ordre à mes cavaliers de les escorter jusqu’à Tyr, où ils feront ce qu’ils voudront. (D. Camus, Crucifère, 2009)
11) Sans perdre de temps, leur père avait donné l’ordre qu’on fasse charger les corps sur un chariot par les quatre prisonniers encore en vie. (B. Clavel, Les Colonnes du ciel t.3, 1978)
12) Fermer les grilles, d’accord, mais qui sortirait en donner l’ordre? (C. Thomas, Les Adieux à la reine, 2002)
Sur le plan syntagmatique, la CLS je vous prie se distingue des deux précédentes car elle constitue à elle seule une proposition autonome et incidente. En effet, dans 43% de ses emplois (221/511 occ.), je vous prie accompagne un nom ou un prénom en position syntaxique d’apostrophe (Madame Ozareff, Monsieur Ricou, Madame Jeanne), un titre de politesse, de noblesse ou de charge (Messieurs, Sire, Excellence, Éminence etc.), une indication de parenté (Monsieur mon père, mon oncle, ma cousine etc.) ou encore l’expression d’une intimité (mes chers amis, ma commère, Monsieur mon mari etc.). Dans 48% de ses emplois (246/511 occ.), la CLS accompagne un impératif (exemples 14 et 16) ou une structure équivalente à l’ordre ou à la prière (exemple 15), parfois sous la forme d’une interrogation (exemple 13). Cet emploi avec des formes impératives n’est pas remarquable en tant que fait de langue mais sur le plan statistique puisqu’il est surreprésenté dans HIST par rapport aux autres structures construites avec je vous prie.
13) – Pourriez-vous, je vous prie, me répéter les faits – et me les détailler? (D. Camus, Le Roman de la croix t.1, 2005)
14) Disposez, je vous prie. (J.-C. Rufin, Rouge Brésil, 2001)
15) – Le chat à neuf queues, monsieur Berrichon, je vous prie. (J. Héliot, Flibustière, 2012)
16) Mais mon frère, dit-elle, dégageant ses mains des miennes mais pour me les passer incontinent autour du col, considérez, je vous prie, le péril où je suis en cette maison ! (R. Merle, Fortune de France t.2, 1979)
Dans les emplois les plus fréquents, les verbes auxquels je vous prie est incident
(1) impliquent le mouvement, parfois lié à la relation de pouvoir entre les interlocuteurs (exemple 14 avec disposez, mais aussi ailleurs avec prenez place, marchez, ou inclinez-vous, veuillez avancer, etc.);
(2) invitent l’allocutaire à une représentation mentale qui relève de la cognition (exemple 16 avec considérez, mais aussi ailleurs rappelez-vous, observez etc.);
(3) sont des verbes de l’interlocution (exemple 13 avec répéter mais aussi ailleurs poursuivez, dites-moi, etc.).
La CLS a alors valeur d’ordre, que le locuteur atténue par la formule de politesse (exemples 13, 14 et 15), ou de prière, dont la modestie est renforcée précisément par la formule de politesse (exemple 16). Elle apparaît, dans HIST, presque comme l’équivalent d’une locution adverbiale (du type s’il vous plaît) relevant du registre de langue soutenu, plus typique de la langue classique.
En outre, la complémentation du noyau peut se réaliser, dans un quart des occurrences, en de Vinf (129/511 occ. soit 25%, exemple 17) :
17) Si vous avez encore quelque estime pour moi, je vous prie de quitter cette chambre. (H. Troyat, Les Lumières des justes t.1, 1959)
Sur le plan sémantique, le verbe à l’infinitif dénote
(1) un mouvement de l’allocutaire (exemple 17 avec quitter, mais aussi ailleurs avec retourner, me suivre, céder votre place, me sauver, etc.), dans presque la moitié des occurrences;
(2) une action de l’allocutaire (attitude, expression d’un affect : (m’)(en) excuser, accepter nos plus plates excuses, agréer mes plus humbles excuses, bien vouloir, ne plus m’en parler, ne pas m’interrompre etc.).
Lorsque la complémentation se réalise sous la forme pronominale en (125/511 occ. soit 24.5%), la séquence je vous en prie marque davantage la supplique traduisant l’exaspération ou l’imploration empressée (exemple 18) que l’ordre :
18) – Madame, dit le Roi avec une apparente lassitude, je ferai ce que vous voudrez, mais je vous en prie, retournez à votre couche ! (R. Merle, Fortune de France t.4, 1982)
Sur le plan syntagmatique, le comportement de la CLS je vous remercie se rapproche de celui de je vous prie. En effet, dans 54% de ses occurrences (94/175 occ.), elle constitue à elle seule une proposition autonome accompagnant une apostrophe (Monsieur d’Orbieu, Citoyens d’Acragas, Camarade Xiao Ling etc.), d’un titre de noblesse ou de charge (Sire, Excellence, Majesté, Monsieur le Marquis, lieutenant etc.), d’un nom de parenté (Mon cousin, (Monsieur) mon père, ma mère etc.) ou encore de marqueurs d’affection (mes amis, M’amie, cher comte etc.).
Introduite par une incise (68/175 occ. soit 39%), la CLS je vous remercie apparaît de manière privilégiée – et prévisible dans le cadre du discours direct – avec des verbes de parole dont dire (exemple 19) est le plus fréquent (55/68 occ. soit 80% ; LLR 92) ; les 20% restants sont occupés par d’autres verbes de parole (répondre, balbutier, s’écrier, bredouiller, hasarder).
19) Je vous remercie, monsieur Lacroix, dit-elle sèchement. (J. d’Aillon, La Guerre des trois Henri t.3, 2009)
Dans l’exemple 19, l’extension du noyau de la CLS je vous remercie par un circonstant postposé (sèchement) donne des informations sur la manière de remercier. Cette variation syntagmatique est un peu plus fréquente (14/175 occ. soit 9%) que pour la CLS je vous prie. Ces circonstants renforcent l’acte illocutoire de politesse essentiellement par hyperbole (je vous remercie infiniment, dix mille fois, mille fois, de tout cœur etc).
Sur le plan syntagmatique, la CLS je vous remercie présente deux types de complémentation : l’une, par le pronom anaphorique en antéposé (20/175 occ. soit 11%, exemple 20) ou par un groupe prépositionnel de/pour N ou de/pour VInf (exemples 21 et 22) :
20) – Certainement, madame, et je vous en remercie, s’inclina Isabeau de Limeuil (J. d’Aillon, La Guerre des trois Henri t.2, 2009)
21) – Monsieur mon père, dis-je, vous dites vrai, je vous remercie de vos sages avis et je tâcherai à me corriger de mon peu de prudence. (R. Merle, Fortune de France t.3, 1980)
22) – Monsieur Chabot, dit ensuite Mornay, je ne vous remercierai jamais assez pour m’avoir appris la botte de votre père. (J. d’Aillon, La Guerre des trois Henri t.2, 2009)
Plus précisément, la préposition de (43/175 occ. soit 25%) introduit des groupes nominaux (N) et verbaux (VInf) exprimant
(1) l’interlocution : je vous remercie de vos précieux conseils, de vos remarques, de votre attention, de ces explications, etc. ; je vous remercie de m’avoir écouté, de m’en avertir, de me le dire etc.;
(2) l’attitude favorable de l’allocutaire : je vous remercie de votre bonne volonté, de votre zèle et de votre loyauté, de vos largesses, de votre patience etc.;
(3) plus rarement, une action précise effectuée par l’allocutaire : je vous remercie de cette danse, de votre visite… et je vous remercie de me confier cette mission / de m’avoir porté ce paquet etc.
La préposition pour (8/175 occ. soit 5%) introduit les mêmes types de complément que ceux introduits par de (je vous remercie pour votre aide, pour ces sages paroles etc.).
De l’ensemble de ces observations, nous pouvons conclure que les quatre CLS dire d’une voix, donner l’ordre, je vous prie, je vous remercie peuvent être considérées chacune comme un motif du fait des variations paradigmatiques et syntagmatiques intervenant au sein d’un cadre collocationnel. Les analyses détaillées dans HIST ont permis de constater, d’une part, une grande proximité d’emplois pour les motifs je vous remercie et je vous prie, routines lexicalisées dans le discours direct, et, d’autre part, une plus grande variation sur les axes paradigmatique et syntagmatique pour les motifs dire d’une voix et donner l’ordre, dont les sujets et les temps sont divers. En nous appuyant sur l’ensemble de ces données, nous allons maintenant étudier les fonctions discursives de ces motifs.
4.1.3. Les fonctions discursives
Dans HIST, le motif dire d’une voix occupe presque toujours une FD essentiellement descriptive :
23) Je l’ai entendu dire d’ une voix forte, alors même que le sang couvrait son flanc gauche :
– Voyez comment sont traités les gens de bien en France ! Le coup vient de la fenêtre où il y a une fumée… (M. Gallo, Croix de l’Occident t.2, 2005)
24) Eh bien, dit ma mère en sortant de son royal silence, je vous souhaite le bonsoir, monsieur mon fils. À vous aussi, Catherine.
– Merci, madame, dis-je.
Et avec un temps de retard, Catherine dit d’une petite voix douce et gentille qui, je ne sais pourquoi, me serra le cœur :
– Merci, madame. (R. Merle, Fortune de France t.1, 1977)
Dans l’exemple 23, le narrateur Bernard de Thorenc raconte la mort de Coligny lors de la Saint-Barthélémy et se présente comme un témoin des événements qu’il consigne. Ici, le motif a lointainement une fonction narrative puisqu’il introduit un discours direct crucial pour la suite de l’enquête du narrateur – mais c’est aussi le discours direct (DD) qui joue ce rôle, pas seulement la proposition introductrice de la parole. Cette dernière est régie par le verbe de perception, mais le cœur du motif a une FD descriptive : d’une voix forte rend compte de la détermination de Coligny à être vengé. La phrase elle-même repose sur l’opposition entre cette force et son état de faiblesse. Dans l’exemple 24, la FD s’attache à décrire, d’une part, les réactions de Catherine, la sœur du narrateur, et, d’autre part, les affects de ce dernier, qui a pitié de sa sœur avec qui leur mère se montre sévère et indifférente. On retrouve ici une caractéristique du roman sentimental, qui utilise le verbe dire en ajoutant une indication précise des affects et manières qui accompagnent la parole des personnages, voire qui lui est redondant (Gonon, Goossens, et Novakova, Reference Gonon, Goossens, et Novakova, Buffard-Moret, Mejri and Meneses-Lerín2019 sous presse) : « Le personnage ne peut jamais dire quelque chose sans que l’on indique comment il le formule » (Emmanuelle, Reference Emmanuelle2017 : 53). Le roman historique comportant par ailleurs des éléments du roman sentimental (Krulic, Reference Krulic2007 : 33), il s’agirait ainsi d’une caractéristique commune à certains sous-genres de la paralittérature romanesque.
La FD narrative est quant à elle bien représentée par le motif donner l’ordre. En effet, même si le contexte est très souvent militaire (un seigneur qui commande à ses soldats, exemple 25), les situations peuvent relever aussi de la vie quotidienne (un mari commande à sa femme ou un seigneur à son valet dans l’exemple 26) :
25) Quand les maisons entourant le palais de Mutarrif ne furent plus qu’un tas de cendres fumantes, Ubaid Allah Ibn Mohammad Ibn Abi Ibn Abda donna l’ordre à ses troupes d’attaquer. (P. Girard, Abdallah le cruel, 2007)
26) Le valet barbier connaissait vaguement le recteur du collège Saint-Cosme. Il demandait une somme élevée pour arracher une dent, mais assura-t-il, souvent le malade survivait. Olivier lui donna l’ordre d’aller le chercher. (J. d’Aillon, La Guerre des trois Henri t.3, 2009)
De façon générale, ce motif renvoie à une société hiérarchisée par des rapports de dominationFootnote 8 (le motif rend alors compte de l’ethos de l’homme de pouvoir, du locuteur). Dans l’exemple (25), le général aux ordres du sultan mène l’assaut contre le palais de Mutarrif, et transmet l’ordre à ses soldats ; dans l’exemple (26), le héros, Olivier Hauteville, cherche à soigner la rage de dents de son hôte, et s’adresse à un barbier, valet de chambre d’un voisin à qui il délègue le procès. Cependant, dans ces deux extraits, la FD est également indirectement descriptive : elle renvoie aux rapports sociaux entre les personnages du HIST de même que, dans le roman policier, le motif ouvrir la porte décrit indirectement le détective comme un individu toujours en mouvement, un nomade mu par l’enquête (Gonon, Goossens, Kraif, Novakova et Sorba, Reference Gonon, Goossens, Kraif, Novakova, et Sorba, Neveu, Harmegnies, Hriba and Prévost2018). C’est donc bien une caractéristique de la paralittérature d’utiliser, selon le sous-genre romanesque, des personnages qui sont davantage des types que des individualités (Krulic, Reference Krulic2007 : 46).
En ce qui concerne les motifs utilisant une routine conversationnelle, je vous prie connote un état de langue ancien typique du roman historique comme en témoigne, par exemple, la mise en scène des paroles qu’aurait prononcées Henri III, selon l’historiographie, sur son lit de mort (voir d’Aillon, 2013 ; Gallo, 2005 et Merle, 1983) : « – Je vous prie comme ami, et vous ordonne comme roi, que vous reconnaissiez après ma mort mon frère que voilà, que vous ayez la même affection et fidélité pour lui que vous avez toujours eue pour moi et que pour ma satisfaction, et votre propre devoir, vous lui portiez serment en ma présence ». Les occurrences du motif oscillent entre la prière empressée et l’ordre souverain, que celui-ci renforce ou atténue selon le contexte (voir Charaudeau et Maingueneau Reference Charaudeau and et Maingueneau2002 : 28 et les adoucisseurs ou « procédés accompagnateurs » dans la théorie de la politesse). Ce motif permet de révéler une autre FD que nous proposons de nommer FD pragmatique, le terme pragmatique renvoyant ici à la réalisation d’un acte de langage par un personnage du roman historique à l’intérieur du discours romanesque lui-même :
27) Ta fille te sera rendue, dit Clémence, et je la protégerai. J’en veux parler au roi.
– N’en faites rien, Madame, je vous en prie, s’écria Eudeline.
– Le roi me comble de cadeaux que je ne souhaite pas ; il peut bien m’en accorder un qui me plaise !
– Non, non, je vous en supplie, n’en faites rien, répéta Eudeline. J’aime mieux voir ma fille sous le voile que de la voir sous terre. (M. Druon, Les Rois maudits t.3, 1956)
28) C’est impossible, Monsieur ! Que me reproche-t-on?
– Vous le saurez en temps voulu. Laissez-nous travailler, je vous prie…
L’un des hommes se dirigea vers un secrétaire, l’autre vers une commode. Sophie ne songea même pas à protester. Elle savait, par expérience, qu’il est superflu de parler raison à un policier chargé d’exécuter un ordre. (H. Troyat, La Lumière des Justes t.5, 1963)
Dans l’extrait 27, le motif je vous prie exprime la supplique de la servante, et est d’ailleurs repris par je vous en supplie. La FD est pragmatique en ce qu’elle renforce la dimension illocutoire de l’acte de langage et oriente l’interprétation de la phrase dans le contexte dialogal : le motif souligne l’emploi de l’impératif à la forme négative (N’en faites rien) et lui donne valeur de prière et non pas d’ordre. En revanche, dans l’extrait 28, le motif est employé par un représentant du pouvoir en place, un policier venu perquisitionner chez Sophie. Sa FD pragmatique vient soutenir ou répéter l’ordre donné plutôt que l’atténuer. Enfin, dans les deux cas, le motif a également une FD indirectement descriptive, puisqu’il met en scène les rapports de pouvoir entre les personnages, particulièrement marqués dans le genre HIST.
Pour sa part, le motif je vous remercie se trouve majoritairement (136/175 occ. soit 78%) dans une phrase qui ouvre une réplique au discours direct (donc au début d’une prise de parole, comme réponse à une autre). Le motif est donc profondément ancré dans le DD, ce qui renforce sa fonction pragmatique, presque phatique. Comme formule de politesse, il est très significatif d’une interlocution pour initier une réponse, adoucir ou renforcer un acte menaçant ou valorisant pour la face de l’allocutaire :
29) Il était rouge, et paraissait épuisé. Beaujeu se leva, le regarda, et prit la parole à son tour :
– Seigneur de Tripoli, je vous remercie pour ces sages paroles. Je suis sûr qu’aucun d’entre nous ne les oubliera jamais. Mais je suis obligé de rendre la sentence, telle qu’elle a été prononcée par ce tribunal : beau doux frère Morgennes, je te condamne à la perte de la maison, définitive. (D. Camus, Le Roman de la Croix t.1, 2005)
30) – […] Cet homme est un misérable, comme la plupart, hélas ! des aventuriers qui viennent échouer dans cette colonie. Voilà pourquoi je vous garde autant que je peux de toute fréquentation.
– Je vous remercie, mon père, dit Alix, rassurée sur ce premier assaut et qui jugeait arrivée l’heure de la contre-attaque. Grâce à vous, ma vertu n’a jamais été inquiétée. Mais l’inconvénient…
– Eh bien?
– … c’est que je m’ennuie profondément ici. (J.-C. Rufin, L’Abyssin, 1997)
Dans l’exemple 29, Beaujeu, qui doit annoncer la condamnation, commence par l’apostrophe individuelle suivie de je vous remercie et de l’adoucisseur axiologique sages paroles pour ménager la face du dernier locuteur, Raymond de Tripoli, avant d’introduire le Mais annonciateur de la mauvaise nouvelle. Ici, la FD du motif est pragmatique car l’extrait met en scène le respect des règles de politesse d’un chevalier qui s’adresse à son pair et tient à le ménager. Dans l’exemple 30, Alix commence de même par faire allégeance à son père, Monsieur de Maillet, en début de réplique : le groupe apposé rassurée sur ce premier assaut explicite la stratégie de la jeune fille. Cette marque de soumission et de respect pour l’autorité paternelle lui permet ensuite d’introduire un argument contraire, là aussi par un Mais en début de phrase. La fonction pragmatique du motif est ainsi particulièrement visible dans le DD. Plus largement, ces motifs revêtent également une fonction indirectement descriptive des compétences argumentatives des personnages de HIST, qui, face à l’autorité constitutive de leurs rapports interpersonnels, mettent en place des stratégies d’adoucissement et de louvoiement.
Dans cette section, nous avons montré que les quatre CLS donner l’ordre, dire d’une voix, je vous prie, je vous remercie constituaient bien des motifs au sein de cadres collocationnels accueillant des variations paradigmatiques et syntagmatiques. Ces motifs occupent plusieurs FD dans l’économie du roman : en plus de leurs fonctions narrative et descriptive, nous avons mis en évidence une FD pragmatique, particulièrement saillante dans HIST sur le plan statistique,Footnote 9 la société hiérarchisée se marquant aussi dans les interactions verbales.
4.2. Les motifs autour des CLS de parole dans GEN
Dans le corpus GEN, parmi les 4 CLS de parole retenues (je ne sais pas, j’ai l’impression, j’ai oublié, je me dis), je ne sais pas présente le LLR le plus élevé (1078,71) et donc la spécificité la plus grande. Les quatre ALR retenus sont extrêmement spécifiques : par rapport à HIST, les romans de littérature générale se caractérisent donc plutôt comme des récits psychologiques, avec une réflexivité bien plus marquée du narrateur-personnage ou des autres personnages locuteurs.
4.2.1. Les variations paradigmatiques
Dans les quatre CLS, le pronom sujet est presque exclusivement je (seulement 4 on et 1 ils pour je ne sais pas Footnote 10). De façon générale, les ALR du corpus GEN privilégient l’expression à la première personne par rapport au corpus HIST dans lequel les ALR comportent des sujets plus variés. Dans GEN, il s’agit souvent de situations de DD, ce qui explique l’importance du présent d’énonciation : 78% pour je sais pas, 51% pour j’ai l’impression et 50% pour je me dis (exemple 31 ; quelques cas de passé simple). La prédilection de je sais pas pour le présent peut s’expliquer par la situation à laquelle il est fait référence : la remémoration de faits passés. En parallèle, l’imparfait, souvent équivalent au présent en situation de récit (aspect sécant), ou utilisé également en DD avec sa valeur modale d’atténuation dans les actes de politesse, est employé à 20% pour je sais pas (exemple 32), 48% pour je me dis et à 38% pour j’ai l’impression. Pour cette CLS, le passé composé et le passé simple (8% chacun) témoignent de variations plus importantes : la CLS j’ai l’impression se trouve aussi bien dans le DD (34) que dans le récit (33), pour évoquer le passé ou le moment de l’énonciation.
31) À bout de forces, je me traîne vers ma chambre et je me dis que je dois être malade (A. Langfus, Les Bagages de sable, 1962).
32) – Oui. Je ne savais pas que vous le connaissiez, rétorqua Jane avec un grand sourire. (F. Humbert, La Fortune de Sila, 2010)
33) Vers l’est, un feu d’artifice éclate en gerbes roses et bleues. J’ai l’impression de vivre ces instants au passé. (P. Modiano, La Ronde de nuit, 1969)
34) J’ai eu l’impression qu’elle nous observait et que je l’avais déjà vue quelque part. Mais bon. (Ph. Djian, Ça, c’est un baiser, 2002)
Le passé composé j’ai oublié est le plus employé pour cette CLS, presque à égalité avec le plus-que-parfait j’avais oublié (respectivement 50% et 46%). Ces emplois sont analogues à ceux du présent / imparfait pour les trois autres CLS (l’aspect ne peut être qu’accompli lorsque l’oubli est formulé par le locuteur, qui en a pris conscience et en fait état).
On ne peut pas a priori attribuer l’imparfait ou le plus-que-parfait au récit, et le passé composé ou le présent au DD : le présent certes intervient massivement dans le discours rapporté de façon directe, mais le récit peut être fait au présent (exemple 33) et les autres temps peuvent aussi être employés dans les deux systèmes d’énonciation.
4.2.2. Les variations syntagmatiques
C’est la CLS je ne sais pas qui compte le plus grand nombre de collocatifs (108) : majoritairement des verbes (65%) et des adverbes (17%), tendance qui se retrouve pour les trois autres CLS. Les collocatifs verbaux privilégiés par je ne sais pas et constituant généralement la complémentation sont des verbes de parole ou de cognition (dire, répondre, penser, comprendre, etc.) comme pour j’ai oublié (dire, préciser, demander). Je ne sais pas est aussi employé avec des verbes d’action (faire, danser, nager) de même que les CLS j’ai l’impression et je me dis pour lesquelles les associations les plus spécifiques sont, en plus des verbes d’action cités supra, avec être (LLR respectivement 226.1483 et 309.7758), aller (LLR 108.6133 pour j’ai l’impression) et devoir (LLR 147.4352 pour je me dis). Il s’agit cependant moins avec ces CLS de mettre en scène une action (comme pour donner l’ordre) que de commenter l’action éventuelle (j’ai l’impression d’aller, je ne sais pas danser). Les collocatifs qui appartiennent à la catégorie des verbes de cognition créent eux dans la CLS ouverte par je une double structure cognitive (exemple 35) :
35) Sans doute pensait-il que j’avais tout oublié? (C. Rochefort, Le Repos du guerrier, 1958)
Le commentaire introspectif paraît une spécificité du GEN par rapport aux autres sous-genres de la paralittérature romanesque.
Les collocatifs adverbiaux pour je ne sais pas consistent essentiellement en un renforcement de la négation (non), mais comptent aussi de nombreux modalisateurs ou indices d’oralité (37%, par ex. eh bien, oh, à vrai dire, peut-être, franchement, etc.) Pour j’ai l’impression et je me dis, ce sont en majorité des adverbes de temps : parfois, toujours, soudain (j’ai l’impression) et aussi, souvent (je me dis) qui permettent d’ancrer le moment de l’énonciation ou de la cognition passée dans la chronologie du récit. Avec ces deux CLS, se rencontrent aussi des adverbes marqueurs d’intensité (j’eus vraiment l’impression, je me dis surtout etc.). Enfin, pour j’ai oublié, les ADV peuvent également indiquer un renforcement (complètement), ou témoignent de l’emploi de la négation, je n’ai pas/jamais oublié (8%, 96/1183 occ.) : ces collocatifs informent alors de l’intensité de l’oubli (exemple 35). Les collocatifs adverbiaux renforcent le caractère du DD par des indices d’oralité ou indiquent une fréquence ou un degré.
Certaines CLS se trouvent parfois en construction dépouillée, employées comme propositions incidentes :
36) Je ne sais pas, il faudrait les rééduquer, les aimer, leur apprendre le plaisir. (M. Houellebecq, Plateforme, 2001)
37) Il désirait vous voir, j’ai l’impression (P. Bourgeade, L’Empire des livres, 1989)
Ces emplois rares (9% pour j’ai oublié et moins de 2% pour j’ai l’impression et je me dis) mettent néanmoins en valeur le rôle de « marqueur discursifFootnote 11 propositionnel », et donc la « fonction de structuration du discours » (Andersen, Reference Andersen2007), que ces motifs peuvent revêtir dans les romans du GEN. Ils sont ainsi proches de l’emploi phatique par leur brièveté.
Néanmoins, dans la plupart des cas, ces CLS présentent des extensions syntagmatiques qui précisent ce dont on parle, ce qu’on ressent, oublie, etc. Pour je sais pas, la complémentation est variée : un pronom (par ex., je ne le savais pas), un SN (exemple 38), une complétive (exemple 39), un modalisateur (au juste, vraiment) ou une marque d’oralité (oh). La variation syntagmatique montre bien que la CLS se comporte comme un motif.
38) Je ne savais pas les noms de ces arbres, mais je les aimai aussitôt (M. Pagnol, La Gloire de mon père, 1957)
39) Je ne sais pas si je lui ai appris grand-chose ; en revanche, j’ai énormément appris grâce à elle. (A. Maalouf, Les Désorientés, 2012)
On retrouve cette variété pour j’ai oublié : surtout des SN (exemple 40), mais aussi le pronom COD entre l’auxiliaire et le participe passé (190/1183 occ. soit 16%, par ex., j’ai tout oublié), une subordonnée (que, ce que, ce qui : 7%, 87/1183 occ.), ou de Vinf (13%, 159/1183, exemple 41).
40) Je n’ai jamais oublié mon premier voyage, il y a longtemps (Y. Berger, Santa Fe, 2000)
41) J’ai oublié de vous dire quelque chose de fondamental, de très, de formidablement important. (A. Kourouma, Allah n’est pas obligé, 2000)
Les subordonnées compléments sont plus fréquentes pour je me dis (30%, 412/1385 occ, exemple 42) et pour j’ai l’impression (53%, 927/1756 occ., exemple 43) qui introduisent alors du discours indirect (DI), développant le contenu propositionnel de la CLS :
42) Je me disais que je la garderais ensuite serrée contre ma poitrine, que je ne me détacherais plus jamais d’elle. (J. Laurent, Les Sous-ensembles flous, 1981)
43) J’ai l’impression que j’ai de moins en moins d’envies. (M.-S. Roger, Bon rétablissement, 2012)
Cette dernière construction est concurrente de j’ai l’impression de/d’ Vinf (42%, 740/1756 occ.) et les verbes ainsi régis sont souvent des verbes d’interlocution, comme le montre l’étude des collocatifs privilégiés supra.
Les analyses de ces différentes variations nous permettent de conclure que les 4 CLS j’ai oublié, j’ai l’impression, je ne sais pas et je me dis sont également des motifs : les variations paradigmatiques et syntagmatiques s’appliquent à toutes, quel que soit le plan d’énonciation (discours ou récit). Ces motifs permettent de construire un discours introspectif, de ménager des aveux ou des confessions. Nous allons précisément analyser à présent leurs fonctions discursives.
4.2.3. Les fonctions discursives
Certaines FD des motifs étudiés dans GEN sont identiques à celles des motifs étudiés dans HIST : les verbes se rapportant à l’interlocution au sein d’un roman expliquent ces ressemblances (le verbe dire apparaît dans dire d’une voix et je me dis). La FD narrative caractérise ainsi souvent j’ai oublié :
44) Les filles racontèrent l’histoire de ma célèbre sauce au concombre qui devait accompagner je ne sais plus quel poisson. J’avais acheté du paprika, de l’aneth, différentes moutardes à l’ancienne mais j’avais oublié d’acheter le concombre (F. Weyergans, Trois jours chez ma mère, 2005).
On a affaire dans cet exemple à un micro-récit, dont la CLS étudiée est la chute. Dans le GEN, le narrateur oublie volontiers d’acheter du sucre, son porte-monnaie, sa valise (l’oubli provoque, dans le récit, une nouvelle péripétie).
Mais dans le DD, la FD peut aussi être pragmatique : elle équivaut à un acte de langage indirect que serait l’excuse (cette dernière pouvant redoubler explicitement la CLS comme dans l’exemple 45) :
45) – Pardonnez-moi, pardonnez-moi, j’ai oublié le sucre. / Il a un air si malheureux que je lui souris. (A. Langfus, Les Bagages de sable, 1962).
46) – J’ai l’impression que vous ne m’avez pas reconnu, me dit-il d’un air agacé. Je me trompe? (É.-E. Schmitt, La Femme au miroir, 2011)
Dans l’exemple 46, le locuteur espère susciter la reconnaissance voire l’admiration chez son allocutaire, le narrateur : comme dans de nombreux emplois en DD, j’ai l’impression vient atténuer l’acte de langage, ici le reproche (par antiphrase, il signifie parfois au contraire le renforcement de l’assertion) ; il a donc une FD pragmatique. La CLS je ne sais pas employée comme motif a la même FD pragmatique : elle est une tournure idiomatique pour dire la réticence (exemple 47) ou l’hésitation, et traduit le temps de la réflexion que prend le locuteur dans une discussion familière pour affiner sa pensée (exemple 48).
47) – Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je vais me considérer comme grand-père. / – Ah oui ? Tu vois ça de même? / – Pas toi? / – Je sais pas… c’est pas mon fils. (M. Laberge, Revenir de loin, 2010)
48) Bon, je ne dis pas tout de suite une galerie, bien sûr, mais par exemple un restaurant, je ne sais pas, un centre commercial avec un peu de passage pour commencer. (J. Echenoz, Lac, 1989)
Dans l’exemple 47, le premier je sais pas + subordonnée complément fonctionne comme une dérivation allusive (trope illocutoire) : la phrase affirmative à la forme négative équivaut à demander son avis à l’allocutaire ; le second je sais pas exprime la réticence.
En outre, la FD dépend du contexte : si par exemple le COD de j’ai oublié est concret, la FD est narrative ou pragmatique (voir supra : le concombre, ex. 44) ; mais s’il est abstrait, alors la FD est généralement tout autre :
49) Je n’ai pas tout à fait oublié le mal que ces gens m’ont fait. J’y pense mais je suis indifférent. (T. Ben Jelloun, Amours sorcières, 2003)
La CLS évoque des expériences pénibles laissées derrière soi, un passé qui a marqué (ici avec la négation je n’ai pas oublié) ou dont un détail échappe. On propose de nommer cette autre FD cognitive car elle renvoie à des processus cognitifs (hypothèses, réflexions, souvenirs etc.) du personnage. Elle apparaît, dans la sélection des motifs de l’interaction verbale que nous étudions, spécifique à GEN :
50) Je ressentais une joie que je ne pouvais ressentir – dont j’avais l’impression de ne plus posséder les instruments pour la ressentir. (P. Quignard, Le Salon du Wurtemberg, 1986)
Le narrateur s’émeut ici d’une invitation et en rapporte les effets dans son récit : la FD du motif est cognitive en ce qu’il manifeste une réflexion intérieure, une analyse de la situation – dans le cas de l’exemple 49 ci-dessus, le souvenir. La CLS participe donc de l’interprétation des émotions du je narrateur, comme ce peut être également le cas pour je sais pas :
51) Il est hyper-doué et il est nul en classe : ça l’emmerde. Mais aux tests de QI, c’est le premier. Résultat : il se fait cogner par tout le monde et il régresse. Je sais pas ce qu’il va devenir. J’ai pas les moyens de le changer d’école (D. Van Cauwelaert, Hors de moi, 2003).
La locutrice s’adresse au narrateur et le motif est ici aveu d’ignorance : sa FD est cognitive, car il entre dans une réflexion à laquelle est confrontée la locutrice (je) et qu’elle expose à l’allocutaire. Selon que le motif apparaît dans du DD oral ou dans du discours intérieur, son rôle n’est pas forcément le même :
52) Elle se fâchait lorsque je lui murmurais : « Tu es toute ma vie », et je ne savais pas si c’était la banalité de l’expression qui l’indignait ou la petitesse d’une telle unité de mesure (R. Gary, Les Cerfs-volants, 1980)
Ici le DD au présent et le commentaire de ce dernier à l’imparfait rendent compte de la FD cognitive du motif je sais pas dans ce récit. Il traduit en effet l’hésitation du narrateur-personnage quant à l’interprétation de la réaction de l’allocutaire. Comme souvent dans GEN, DD oral et discours intérieur se complètent, le second vient corriger ou commenter le premier.
53) Pour une fille qui détestait la campagne, je me dis qu’elle avait de drôles d’idées, mais je préférais garder cette réflexion pour moi. (Ph. Djian, Lent dehors, 1991)
Là encore la FD est cognitive : je me dis introduit du DI intérieur, qui a une dimension évaluative. Le motif je me dis conserve sa FD cognitive dans la majorité des cas : la CLS introduit un commentaire sur l’action, un mouvement d’interprétation. Le corpus GEN souligne ces moments d’introspection, par exemple dans des phrases emphatiques (avec dislocation, c’est ce que je me dis…), à présentatif (voilà ce que…), ou en utilisant un démonstratif à valeur cataphorique introduisant les hypothèses ou la réflexion (je me dis ceci : …). La FD cognitive dans les motifs de l’interaction verbale apparaît alors comme une spécificité de la littérature générale en regard des romans historiques.
5. CONCLUSION
L’objectif de notre étude était de vérifier si les motifs de l’interaction verbale permettaient de révéler certaines spécificités de deux corpus romanesques. En effet, l’hypothèse du projet PhraseoRom est d’essayer de comprendre en quoi les motifs – construits sur une base statistique – constituent des schémas renseignant sur la structuration et l’interprétation du texte. Dans cette étude, l’analyse des variations syntagmatiques et paradigmatiques des huit CLS choisies a montré qu’il s’agissait bien de motifs même si certaines CLS sont plus sujettes à la variation que d’autres (je vous remercie et je vous prie connaissent moins de variations, par exemple, que donner l’ordre et dire d’une voix, selon que dans HIST, le motif repose sur une routine conversationnelle ou non). Le corpus HIST présente aussi souvent plusieurs caractéristiques que l’on retrouve dans d’autres romans de la paralittérature : par exemple, comme dans le roman sentimental, dire d’une voix + expansion du nom redouble l’expression des affects exprimés dans le DD ; ou bien, comme dans le roman policier, le motif revêt une FD indirectement descriptive qui tend à transformer les personnages en types. La FD pragmatique est également caractéristique de HIST parce que les actes de langage à l’œuvre dans ce sous-genre romanesque révèlent les rôles bien définis dans la société hiérarchisée qui y est décrite.
En outre, l’analyse de la FD des motifs de l’interaction verbale révèle la particularité de GEN par rapport à HIST avec la FD que nous avons choisi de nommer cognitive. En effet, alors que les FD narrative, descriptive et pragmatique se rencontrent dans les deux corpus pour les motifs de l’interaction verbale, la FD cognitive permet aux motifs dans GEN d’exprimer une réflexion intérieure ou une analyse de la situation par un locuteur. Dans HIST, les motifs de l’interaction verbale révèlent les rapports de pouvoir attendus et surreprésentés dans le roman, tandis que dans GEN, ils témoignent d’un mouvement d’introspection face à un allocutaire, soi-même, ou le lecteur.
Sitographie
Lexicoscope : http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope/
Projet PhraseoRom : https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr/accueil





