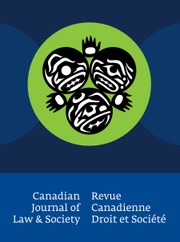1. Un manifeste plein de sens
Je perçois que ce numéro spécial se veut un manifeste – adressé aux chercheurs en droit (et société) – pour ce qui a été appelé dans d’autres contextes disciplinaires un « tournant » sensoriel ou même une « révolution » sensorielle (Howes Reference Howes2006). Ce tournant nous invite à vivre différemment le droit en reconnaissant la centralité de tous nos sens dans une pratique qui est censée nous orienter dans le bon sens et qui, puisqu’elle a un caractère herméneutique, nous appelle à la quête du sens. Ce numéro nous appelle à renverser l’anesthésie générale qui semble affliger les études en droit, et même en droit et société. Dans la lignée du « manifeste tactile » de Marinetti (Reference Marinetti and Flint1972), ce numéro spécial nous invite à mettre la main à la pâte pour mettre le droit à l’épreuve de nos sens et ainsi, peut-être, développer notre sens du droit. Ce texte est composé de mes réactions à ce tournant : j’y expose comment ce tournant « fait du sens » pour moi, comment il rejoint ma sensibilité… et l’enrichit. Je me concentre sur la façon dont le tournant sensoriel réinvestit des lieux communs avec de nouveaux – de vieux – sens. Pour paraphraser Feld, « as these commonplaces are sensed, common sense is placed » (Reference Feld, Feld and Basso1996, 91 : « As place is sensed, senses are placed »).
S’il est largement accepté que le droit est un phénomène culturel, le succès d’un tel numéro sera la reconnaissance qu’étudier les « vies culturelles du droit » (titre d’une série de Princeton University Press dirigée par Austin Sarat) exige aussi que l’on s’attarde aux vies sensorielles de celui-ci. Mais cette mesure du succès manque de justesse et ne réussit pas nécessairement à rendre justice au droit. Se peut-il que le véritable enjeu de ce numéro soit la restauration au droit de ce qui lui est propre? Il serait alors question non simplement d’inter- ou de trans-disciplinarité, mais de vivre le droit jusqu’au bout – de l’habiter (dans tous les sens) à un point tel qu’il en perdrait son caractère familier (Antaki Reference Antaki, Emerich and Plante2018). L’enjeu de ce numéro serait de rendre au droit un certain tact ou un certain sens de ce qui lui est propre… c’est-à-dire d’une proprioception. Le droit en tant que corpus iuris ne serait-il vital, vivable, qu’en renversant un détournement des sens qui a été mépris pour le droit chemin, le chemin du droit? Nous faut-il un tournant sensoriel pour que les chercheurs en droit (et société) retrouvent non seulement le sens du droit, mais aussi, et plus précisément, son goût (Franca et Carneiro Reference Franca, Carneiro and Marusek2017)?
2. Un retour au (bon) sens?
Ce numéro fait partie de l’accueil par les études en droit (et en droit et société) d’un « tournant », le tournant sensoriel, qui s’inscrit dans la lignée d’autres tournants, par exemple les tournants « culturel », « linguistique », et « visuel » (Howes Reference Howes2006). En tant que tournant sensoriel, il nous (r)amène à nos corps, et nous invite ainsi à (re)penser, à (res)sentir, à (ré)animer même, les corps du droit que nous vivons – des corpora iuris qui sont ce qu’ils sont parce que nous sommes des êtres sensibles qui habitent et partagent un monde. Mais ce tournant est aussi « sensuel » (Howes Reference Howes2003). Il nous ramène aussi à la chair et nous invite ainsi à mieux habiter « la cité charnelle du droit » (Stora-Lamarre Reference Stora-Lamarre2002) et à mieux pratiquer « l’herméneutique charnelle » (Kearney et Treanor Reference Kearney and Treanor2015). Le tournant sensoriel devient dès lors une nécessité pour toute réflexion sur « les vies affectives » (Reichman Reference Reichman2009) ou « sentimentales » (Simpson Reference Simpson2015) du droit, sur la façon dont le droit participe à ce qui peut nous émouvoir et nous motiver, à ce qui peut éveiller et informer nos sens, incluant ceux de l’équilibre, de la direction, de la justice. Mais, avant de poursuivre notre questionnement sur le sens de ce tournant, ne faudrait-il pas se demander en quoi ce tournant est un tournant… ou même une révolution?
Les tenants de ce tournant le dépeignent parfois, subtilement, non seulement comme le dernier venu d’une série de tournants, mais bien comme le dernier, c’est-à-dire un tournant qui accomplit tous ces tournants, qui représente en quelque sorte leur sens, leur finalité, leur accomplissement et leur dépassement (voir par exemple Howes Reference Howes2006, 115). C’est dans ce sens, on pourrait dire, que le tournant sensoriel est véritablement révolutionnaire. Si le tournant sensoriel se veut le dernier tournant, le tournant qui complète véritablement toute une série de tournants, nous renvoie-t-il à un premier tournant? Plus particulièrement nous renvoie-t-il à Platon et à un tournant – ou est-ce un détournement – du sensible vers l’intelligible?
Nous vivons ce premier tournant quotidiennement dans le langage même que Platon a inauguré. Après tout, nous oublions trop facilement qu’une « idée », étymologiquement, c’est quelque chose que l’on voit. En grec, le verbe « savoir » signifie « avoir vu ». Si, avec ces mots grecs, l’intelligible est lié au sensible à travers le sens de la vision, il n’en est pas de même en français pour le « savoir ». Comme nous le rappelle Barthes, « savoir et saveur ont en latin la même étymologie » (Reference Barthes1978, 21). Pensons aussi à « com-prendre ». Ou même à « under-stand » en anglais ou « Ver-stehen » en allemand. Est-ce possible que ces liens étymologiques ne soient pas que métaphoriques, mais que ce soit vraiment « le corps » qui « sait » (Merleau-Ponty Reference Merleau-Ponty1945, 276), que tout apprentissage soit « par corps » (voir par exemple Bourdieu Reference Bourdieu1997, 168; Geurts Reference Geurts2003)? Se peut-il que le mot « sensible » conserve ce lien primordial entre l’intelligible et le sensible à travers le mot même?
Ce tournant nous renvoie donc à une naissance de la métaphysique et à l’« histoire d’une erreur » par laquelle le « monde vrai » – c’est-à-dire le monde des sens – est devenu une « fable » (Nietzsche Reference Nietzsche1996). Cette erreur, séparer le sensible de l’intelligible, a contribué à la constitution des « formes juridiques » et à leur participation à diverses formes de vérité (Foucault Reference Foucault2001). Elle afflige aussi les études en droit et en droit et société (voir par exemple les analyses de Constable 1994b; Valverde Reference Valverde2015). Le tournant sensoriel est d’une importance primordiale, car l’éveil des sens qu’il prône nous rappelle (à) un monde « vrai », un monde dans lequel la vérité est sensorielle et sensuelle, événementielle. Ce tournant pourrait aider à freiner la « rationalisation » (Weber Reference Weber2005), c’est-à-dire la désincarnation du langage, et même à contribuer au « ré-enchantement » du monde… ou plus précisément à notre réveil à un monde toujours déjà enchanté. (En fait, peut-être qu’il nous faut un tournant sensoriel pour pouvoir distinguer enchantement et métaphysique.) Avec un tel ré-enchantement, le pouvoir et le savoir octroyés aux facultés humaines telle la volonté, la raison ou même l’imagination (l’imagination moderne, romantique, créative) se retrouveraient du côté de la mémoire et de la perception, facultés par lesquelles l’humain participe à un monde et à sa donation de sens (voir Antaki Reference Antaki2012).
Il ne s’agit pas de simplement renverser la subordination du sensible à l’intelligible pour subordonner l’intelligible au sensible. Le jeu de l’intelligible, le jeu du sens, incluant le sens que le droit est censé nous donner, se joue à travers nos sens. Pour apercevoir nos ordres d’intelligibilité, il faut décortiquer les nomoi de nos sens, nos « ordres sensoriels » (Howes et Classen 2013), c’est-à-dire la façon dont nos sens sont identifiés et constitués, et comment des relations et des hiérarchies sont instaurées non seulement parmi nos sens, mais à l’intérieur d’un même sens.
Si la vision sort souvent gagnante du concours des sens, de leur con-cours, ce ne sont pas toutes les formes de vision qui participent également à cette victoire. Pensons au contraste entre « seeing like a state » (Scott Reference Scott1999) et « seeing like a city » (Valverde Reference Valverde2011). Pensons au « regard fixe » et à sa lourdeur souveraine qui prend le dessus sur le « coup d’œil » « frivole » (Casey Reference Casey2007, 147). Ces formes différentes que prend la vision nous renvoient aussi aux formes différentes que prennent d’autres sens. Si le « regard fixe » correspond au toucher qui prend et maitrise (et donc au concept ou Begriff, apparenté à « grasp » en anglais), le coup d’œil correspond à l’effleurement, au « flirt ». Plutôt que de renverser l’intelligible et le sensible, nous sommes appelés à nous interroger sur leur appartenance mutuelle et sur les multiples façons de les décliner et de les conjuguer (Le Breton Reference Le Breton2006). Développer un vocabulaire sensoriel plus fin permet de mieux décrire, à la fois, des ordres sensoriels et des ordonnancements sociaux (Howes et Classen 2013).
L’éveil de nos sens nous amène à penser au sens de notre diction. Il n’est pas de révolution sensorielle qui n’affecte notre façon de parler. Il est question de jurisprudence et de justice ici, car diction nous vient du grec dike (que l’on traduit par « justice ») et deiknumi (qui signifie montrer, parler). Le tournant sensoriel nous amène à nous demander comment parler, en y incluant des êtres humains. Le rejet d’une « pensée catégorielle » (Heidegger Reference Heidegger1992, Laplantine Reference Laplantine2005) est un rejet d’une tradition métaphysique qui méprend l’être humain, être sensé et sensible, parce qu’elle méprise les sens. C’est dans ce sens que Heidegger passe de l’être humain comme « sujet » à l’être humain comme Dasein, et de « catégories » à « existentialia » (1992; voir aussi Meyer Reference Meyer2010 et Antaki Reference Antaki, Pavlich and Unger2016). L’être humain est un être-là ou un être-le-là – pour lequel le là est donné sensoriellement, sensuellement. Penser l’être humain en tant que Dasein n’est rien d’autre que de penser la « donation de sens » (le « il y a » ou le « Es gibt » de Heidegger).
Le tournant sensoriel nous amène à une ré-examination fondamentale du sens de la véridiction et de la juridiction. Dire la vérité et dire le droit ne peuvent rester indemnes après ce tournant.
3. Quel(s) sens de la juridicité?
Pas de quête de sens, pas d’épreuve de sens, pas de sens sans un éveil des sens. Le tournant sensoriel ramène l’« esthétique » au cœur de toute réflexion sur l’être humain.
L’éthique est désormais moins une question de devoir et plus une question de comment nous habitons nos corps et le monde, de « kinesthésie » même (Geurts Reference Geurts2003, 7, 73). Après tout, ethos « signifie séjours, lieu d’habitation » (Heidegger Reference Heidegger1990, 115) et « Éthique et esthétique sont une seule et même chose » (Wittgenstein Reference Wittgenstein1993, 110). L’ordre sensoriel d’une culture – ou ses ordres sensoriels – « forms the basis of the sensibilities that are exhibited by people who have grown up within that tradition » (Geurts Reference Geurts2003, 5). Ces ordres engendrent et soutiennent des dispositions et des pré-dis-positions qui ont le pouvoir dispositif que l’on associe au droit positif. Ces ordres sont aussi sensuels (« sensorial-affective regime », Hamilakis Reference Hamilakis2015, 2) offrant des humeurs – des résonances, dissonances, consonances (« Stimmungen », Heidegger Reference Heidegger1992) qu’éprouvent les êtres humains. D’où l’importance de reconnaître l’éducation juridique dès l’enfance (Manderson Reference Manderson2003), une paideia qui informe à la fois le jeu des sens (ce qui est perceptible, ce qui peut être senti et ressenti) et le sens du jeu (ce qui est possible, souhaitable) (comparer avec Cover Reference Cover1983), jeu et sens qui indiquent « comment vivre ensemble » (Barthes Reference Barthes1977). L’éthique – et donc le droit – se pensent dès lors en termes d’« inclinaison » et non de « rectitude » (Recht) (Cavarero Reference Cavarero2016). Il est question d’« usages des corps » (Agamben Reference Agamben2015).
La politique est désormais non seulement une question de quête du pouvoir et de son partage (Weber Reference Weber2002), mais exige aussi d’être pensée en termes du « partage du sensible » (Laplantine Reference Laplantine2005, 11; Rancière Reference Rancière2000). Toute « autorité » – autorité qui assure la solidité, la pérennité d’un monde (Arendt Reference Arendt1961) – ne peut être séparée d’une autorité sensorielle, sensuelle : le sens de l’autorité est lié à l’autorité des sens. La citoyenneté est, elle aussi, « sensorielle » (Trnka, Dureau et Park Reference Trnka, Dureau and Park2015) car les communautés sont des « communities of sense » (Hinderliter et al. Reference Hinderliter, Kaizen, Maimon, Mansoor and McCormick2009). Ceci veut dire que la « légitimité » d’un ordre politique n’est pas simplement une question de croyance ou d’opinion publique, mais de con-sensus et de dis-sensus (Rancière Reference Rancière2010). Le tournant sensoriel nous invite à nous pencher sur « the con-sentirer or feeling together at work in consent and consensus » (Antaki et al. Reference Antaki, Condello, Huygebaert, Marusek, Huygebaert, Condello, Marusek and Antaki2018, 2). Notre interpellation politique se joue par et dans les sens.
Le tournant sensoriel nous invite donc à re-penser le pouvoir dispositif du droit ainsi que ce qu’il dispose (partage) et comment. Un éveil des sens exige un retour à la juridicité. Par exemple, et comme Aaron Mills (Reference Mills2016, 853) nous le rappelle, « our notion of legality itself » est rarement évoquée pour expliquer ce qui est propre à l’ordre juridique canadien en opposition aux ordres juridiques autochtones. Cette anesthésie par rapport à la juridicité mène à un grand manque de tact face aux traditions juridiques autochtones, mais témoigne aussi d’un manque de proprioception de l’ordre juridique canadien.
En soulevant la question de la juridicité – la question de l’essence du droit (les sens du droit) – le tournant sensoriel nous ouvre à l’altérité « des autres » et contribue à l’effort de rendre justice à des « jurisprudences mineures » (Minkinnen Reference Minkinnen1994; Goodrich Reference Goodrich1996), à des façons de vivre juridiquement, qui ont été reléguées à un statut de minorité, oubliées, même « disappeared »… Du même coup, ce tournant nous invite à aller à la rencontre de notre propre altérité, et nous rappelle que nous sommes « étrangers à nous-mêmes » (Kristeva Reference Kristeva1988). Le tournant sensoriel rend sensible l’ampleur de l’opération – la face cachée, l’odeur dissimulée, le « soundscape » (Parker Reference Parker2015, 181; voir aussi Mohr et Hosen Reference Mohr, Hosen, Huygebaert, Condello, Marusek and Antaki2018 sur le goût) – et l’emprise de la « jurisprudence majeure ». En fin de compte le tournant sensoriel pourrait nous amener à apprécier le « métissage » – l’essence plurielle – de tout ordre juridique (Laplantine et Nouss Reference Laplantine and Nouss1998; Kasirer Reference Kasirer2003). « Le sens, au singulier, est un non-sens » (Antaki et Popovici Reference Antaki, Popovici, Nicolas and Guittard2019).
Prenons par exemple le « concept » de droit de Hart (Reference Hart1994). Marianne Constable a bien exposé comment la pensée de Hart pré-suppose que les pratiques d’un peuple (« primitif ») soient réduisibles à un ensemble de règles pouvant être écrites en forme propositionnelle et non, par exemple, en forme poétique (Constable 1994, 88). En passant des « pratiques » aux « propositions », il semble que nous passions du sensible à l’intelligible et des corps aux textes. La pensée de Hart nous présente la juridicité d’une façon qui rejoint le principe de légalité, principe qui opère la réduction du droit à la loi (Nonet Reference Nonet, Kagan, Krygier and Winston2002, 52). Comme « jurisprudence majeure », le positivisme juridique « naturalise » une façon de vivre le droit et en efface d’autres, autochtones certainement, mais non seulement (voir Howes Reference Howes1989 sur le droit civil québécois). Avec ce positivisme, nous pouvons identifier le droit, c’est-à-dire la loi, mais sans nous identifier à celui-ci (Lehun Reference Lehun2015, 67), d’où le caractère mystérieux, dénué de sens, de l’« internal standpoint » de Hart selon lequel le droit offre des raisons pour agir – mais sans résonnance particulière (voir Cover Reference Cover1985).
Le tournant sensoriel nous permet d’éprouver la juridicité comme une question sensorielle et sensuelle et d’aborder de façon plus sensée, peut-être même d’esquiver, les dichotomies pratiques-propositions, sensible-intelligible, corps-textes, terrains-archives. Même s’il est important de s’attarder aux différences entre les cultures dites orales et écrites, et aux différences à l’intérieur de celles-ci, le tournant sensoriel nous permet de remarquer la texture des corps ainsi que la corporalité des textes. Est-ce que tout principe de juridicité nous renvoie à des corps-textes?Footnote 1
D’une part, ce tournant nous offre un peu plus de tact face aux traditions juridiques autochtones. Potlatch (festin; voir, par exemple, Mills Reference Mills1994) et wampum (voir, par exemple, Borrows Reference Borrows and Asch1997) émergent comme des pratiques corporelles, mais non insensées. Au contraire, ces pratiques permettent un tissage de sens parce qu’elles sont riches en textures sensorielles et sensuelles. Elles nous renvoient à une essence du droit pleine de sens, une juridicité polysensorielle (sur la polysensorialité, voir Howes Reference Howes and Fascia-Lees2011). D’une autre part, ce tournant permet un peu plus de proprioception. Puisque tout texte est genré et corporel, la juridicité que l’on vit reflète à la fois des pré-dispositions quant à ces genres et ces corps, et des angles morts quant à leur perception et leur épreuve. Par exemple, d’un point de vue des « media studies », la « codification » dépend du passage du papyrus au codex, passage important pour la vision du droit, mais aussi pour son audition. De plus, ce passage permet au droit d’être manié d’une seule main, rendant possible ainsi une certaine « reliure » de sens (Vissman Reference Vismann2008; Reference Antaki and FournierAntaki et Fournier, à venir). Négliger le caractère corporel des textes et de leur inscription dans des contextes pratiques nous mène à leur enlever de la texture (voir Manderson Reference Manderson1995 sur les « statuta »). Qui plus est, les traditions juridiques « occidentales » ont leurs propres « festins », dans lesquels le droit est « mangé » (p. ex., la communion et le partage de la nourriture et des mots dans les Inns of Court; Raffield Reference Raffield2004; sur la gourmandise du droit, voir Manderson Reference Manderson and Kasirer2006) et leurs propres « kinesthésies » par lesquelles le droit est lié, à la fois, à des lieux et à des mouvements (les « burial and walking practices » de la common law; Barr Reference Barr2016).
Puisque la juridicité est elle-même polysensorielle, le tournant sensoriel nous ouvre à un pluralisme juridique qui n’insiste pas sur une conception particulière de la juridicité tout en multipliant les ordres juridiques. La juridicité est elle-même une question non seulement polysensorielle, mais « synesthétique » (Marusek Reference Marusek2017; voir aussi Casini Reference Casini2017). Tout vivre ensemble qui fait du sens implique un vivre ensemble des sens.
4. Vers une juridiction sensée?
Le caractère polysensoriel, synesthétique de la juridicité nous (r)amène à la juridiction : comment dire le droit après le tournant sensoriel? Comment trouver les « words of sense » qui nous permettent de percevoir et d’habiter des « worlds of sense » (Classen Reference Classen1993)?
La juridicité et la juridiction – mondes et mots – nécessitent que nous nous attardions sur la façon dont le droit se présente à nous – ses modalités de présence et de préséance – ainsi qu’à la façon dont nous nous présentons au droit et aux autres, sciemment ou non (p. ex., Goffman Reference Goffman1959). Pensons à la personnalité juridique comme présentation du sujet de droit à l’ordre juridique et comment les masques de la personnalité privilégient la vision et le son.
Tout comme la présence du droit et de ses sujets se trouve transformée par ce tournant, ce tournant situe et traduit l’exigence que la personne soit raisonnable en habitudes de résonance. Il nous met à l’affut des pratiques de résonnement – pratiques qui en appellent à tous nos sens – qui sous-tendent et soutiennent les pratiques de raisonnement. La raison attendue des sujets de droit découle d’une sensibilité (p. ex., Geertz Reference Geertz1983, 175; Koskenniemi Reference Koskenniemi2004). La responsabilité – la capacité de répondre – de ces mêmes sujets découle d’une capacité de percevoir, de ressentir des appels qui font du sens (Meyer Reference Meyer2010). Peut-être est-il temps de remplacer la personne raisonnable par la personne sensible?