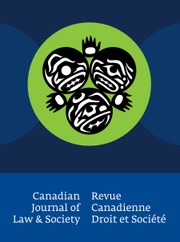Pourquoi et comment les textes portant sur le cas d’Ashley Smith occultent-ils l’agentivité de la jeune femme? C’est la question à laquelle Jaremko Bromwich entend répondre dans cet ouvrage tiré de sa thèse doctorale qui offre une analyse critique du cas d’Ashley Smith, une jeune fille de dix-neuf ans décédée dans une cellule d’isolement de l’Établissement Grand Valley par voie d’auto-strangulation en 2007. L’auteure nous propose une généalogie de la représentation d’Ashley Smith à travers trois sites discursifs : documents légaux officiels, docudrames et textes médiatiques sous forme imprimée. Ces derniers révèlent trois représentations d’Ashley Smith – la détenue, l’enfant et la patiente – qui agissent comme technologies de gouvernance. En effet, à l’intérieur de chacune d’entre elles, la jeune femme devient à la fois un problème social, un cas et un exemple. Dans cet ouvrage, Jaremko Bromwich nous révèle la complexité de ce cas, mais surtout la vision sexiste, raciste et classiste qu’il reproduit : à la fois une légitimation des mères et des détenues blanches de classe moyenne, et l’inintelligibilité de l’agentivité des jeunes femmes.
Après avoir élaboré le cadre de son projet et contextualisé le cas d’Ashley Smith, l’auteure synthétise la recension des écrits, le cadre théorique et les choix méthodologiques inhérents à son étude de cas. Les chapitres 3, 4 et 5 examinent trois déclinaisons de la représentation d’Ashley Smith.
En tant que sujet carcéral, Ashley Smith est d’abord représentée en tant que « jeune personne » au centre de détention juvénile, puis en tant que détenue dans un établissement correctionnel pour adultes. Dans les deux cas, on a recours à une figure unisexe. Ashley subit une suite d’exclusions à caractère nécropolitique Footnote 1 : elle est reléguée au secteur maximal puis au secteur d’isolement cellulaire. Ces exclusions lui confèrent le titre d’homo sacer (ni morte, ni vivante) : sa corporalité se désintègre (déshumanisation) et ses comportements d’auto-blessure s’amplifient.
Au cours de son adolescence, les intervenants considèrent Ashley comme une enfant à risques. Après sa mort, Service correctionnel Canada fait référence à la jeune fille comme à une « enfant jouant à des jeux » avec les intervenants de première ligne Footnote 2 . Plus tard, on observe une rupture dans la manière dont elle est représentée par les acteurs parlant en son nom. Ashley devient une enfant normale : blanche, de classe moyenne, qui pourrait être l’une des nôtres et qui n’a pas sa place en prison.
En tant que patiente, Ashley est principalement définie à la lumière d’un problème de santé mentale. Cette configuration est communément acceptée lors des stades finaux du cas. Au sein du service correctionnel, les évaluations psychiatriques visent à mieux la classifier plutôt qu’à la traiter. Quoiqu’il en soit, Jaremko Bromwich est d’avis que cette catégorie s’inscrit en continuité avec l’histoire : la résistance des femmes est encore une fois interprétée sous le couvert de la folie.
Le dernier chapitre synthétise les résultats et propose aux lecteurs une représentation qui prend en compte l’agentivité d’Ashley, c’est-à-dire une capacité à formuler des opinions et à faire entendre sa voix par des moyens artistiques ou politiques. Cette représentation permet de concevoir Ashley comme une détenue normale et de remettre également en question les rationalités du risque et de l’exclusion.
Outre l’interprétation novatrice de l’agentivité d’Ashley, l’une des forces de cet ouvrage est la présence d’un solide rapport entre la théorie et l’empirie et du fil conducteur qui en découle. L’auteure examine les nuances de l’agentivité d’Ashley qui se manifestent dans chacune de ses représentations : binaire, proto-dialogique, nulle ou expliquée par un diagnostic. De plus, chaque représentation porte en elle un dialogue avec des structures macropolitiques et sociales : logiques de risque et de sécurité, gouvernance nécro-politique et hiérarchisation culturelle (colonialisme).
Par ailleurs, à travers son analyse critique du discours, Jaremko Bromwich relève les stratégies derrière la représentation d’Ashley Smith en tant que détenue, enfant et patiente. L’auteure identifie également les silences occultés par chaque représentation : tantôt l’appartenance culturelle inconnue d’Ashley, tantôt sa mort sociale caractérisée par une non-correspondance avec la catégorie « fille » due à son surpoids, à son agressivité et à son désir sexuel. L’adoption de figures discursives masque parfois une tentative de déplacer ou d’individualiser le problème, de démentir des allégations ou de desservir une cause sociale : la réduction du recours à l’isolement dans les prisons. Face à un tel portrait, les lecteurs se retrouvent outillés de pistes de réflexion et d’analyse.
L’intérêt de cet ouvrage tient au renversement épistémologique proposé par Jaremko Bromwich. Plutôt que d’être un échec systémique, le cas d’Ashley Smith s’avère un succès nécropolitique : l’histoire de la manière dont le complexe industriel des prisons canadiennes s’est débarrassé d’une détenue perturbée qui drainait les ressources. Pour parvenir à cette fin, l’agentivité d’Ashley est niée tandis que son exclusion sérielle conduit à sa mort juridique et biologique.
Au niveau de la forme, Jaremko Bromwich se donne pour mission de raconter l’histoire d’Ashley. Ce faisant, l’auteure a recours à l’intertextualité et à plusieurs modes de narration. Elle ponctue l’ouvrage d’extraits pertinents de romans et de citations au début des chapitres. De plus, elle amorce et termine l’ouvrage par son propre récit de vie. Ainsi, ces stratégies littéraires confèrent à l’ouvrage un cachet particulier.
L’ouvrage a toutefois le défaut de comporter des silences théoriques ou contextuels. L’histoire de l’incarcération féminine au Canada et les conditions carcérales des établissements pour femmes ne sont pas traitées. De plus, l’auteure fait des parallèles entre l’usage de force envers Ashley et l’émeute à la prison des femmes de Kingston en 1994 sans préciser ses faits saillants. En lien avec la notion de victimisation, l’auteure aurait pu mobiliser des études à propos des expériences des femmes détenues et de leur perception de la fouille à nu. L’auteure aurait pu approfondir la non-correspondance d’Ashley par rapport à la catégorie « femmes détenues ». De plus, l’auteure emprunte le terme d’auto-blessure sans y associer de référence. Elle l’interprète tantôt comme stratégie d’agentivité (de résistance), tantôt comme suicide politique. Or, non seulement l’auto-blessure est un phénomène particulier caractérisant différemment les hommes et les femmes incarcérés, mais de nombreux auteurs ont dissocié auto-blessure et suicide.
Somme toute, l’ouvrage saura intéresser toute personne œuvrant de près ou de loin dans le milieu carcéral. Il plaira d’autant plus aux scientifiques sociaux adoptant une perspective féministe ou intersectionnelle.
Editorial Acknowledgment:
Sophie Cousineau’s excellent book review of Rebecca Jaremko Bromwich, Looking for Ashley. Re-reading What the Smith Case Reveals about the Governance of Girls, Mothers and Families in Canada, Brantford: Demeter Press, 2015, 255 pp., was originally scheduled to appear in the special issue 32.2 of the journal. The editorial team would like to express its deepest apologies to Sophie Cousineau for this oversight.
L’excellent compte rendu produit par Sophie Cousineau de l’ouvrage de Rebecca Jaremko Bromwich, Looking for Ashley. Re-reading What the Smith Case Reveals about the Governance of Girls, Mothers and Families in Canada, Brantford: Demeter Press, 2015, 255 pp., devait paraître au sein du numéro spécial 32.2 de la Revue. L’équipe éditoriale souhaite transmettre, à Madame Cousineau, ses plus sincères excuses pour cette omission.