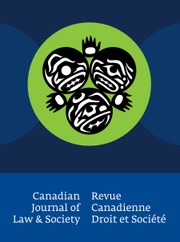Introduction
Le divorce peut être source d’iniquité entre les ex-conjoints, qui peut être partiellement compensée au moment du divorce, ou après le divorce, par des dispositifs privés de type prestation compensatoire ou des dispositifs publics de type prestations sociales de lutte contre la pauvreté. Mais, comme l’analysent notamment Jeandidier et collègues dans ce même numéro, la source de l’iniquité résulte en partie des choix professionnels antérieurs à la séparation, associés à une logique de spécialisation des tâches au sein du couple. Ces auteurs montrent notamment que la principale source d’iniquité consiste en une pénalité à la maternité. On peut s’interroger, dans une perspective comparative, sur les logiques des politiques sociales et familiales nationales du point de vue de leur impact ex ante sur cette source d’iniquité potentielle, dans l’hypothèse où le divorce adviendrait.
Nous proposons ici d’examiner, dans cinq pays d’Europe de l’Ouest relevant de modèles différenciés de protection sociale, les dispositifs prévus par les politiques publiques sociales/familiales pour compenser l’engagement parental et familial ayant pu entraîner un retrait temporaire ou durable du marché du travail, visant ainsi à réduire les risques économiques liés aux séparations ou au divorce. Ces dispositifs, très variés au regard de leur histoire, de leur ampleur, de leur configuration, le sont aussi au regard du rôle qui leur est assigné. La comparaison cherchera d’une part à relier ces dispositifs publics, compensatoires de l’investissement parental, aux processus de familialisation/dé-familialisation des activités parentales, c’est-à-dire à leur prise en charge par l’État ou le marché, et d’autre part aux transformations des relations de genre au sein des familles, et donc à la déspécialisation des rôles masculins et féminins.
Notre analyse repose sur l’examen des textes (lois, débats parlementaires, analyses secondaires) et sur l’information fournie par un réseau de référents universitaires spécialistes des questions familiales et de genre dans les cinq pays étudiés, à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni (Ecosse exclue) et la Suède Footnote 1 . Dans un premier temps, nous explicitons la grille de lecture utilisée pour comparer les évolutions des politiques sociales et justifions le choix des pays retenus pour la comparaison (partie I). Nous utilisons ensuite cet outil pour analyser deux dispositifs compensatoires particuliers que sont les congés parentaux, d’une part, et les droits familiaux et conjugaux dans les systèmes de retraite, d’autre part (parties II et III).
1 Méthodologie
1.1 Cinq pays d’Europe de l’Ouest aux systèmes de protection sociale fortement différenciés
Un examen rapide de quelques indicateurs sociodémographiques relatifs au mariage, au divorce, à l’évolution des formes de vie familiale permet de repérer différents stades de dé-familialisation dans les cinq pays étudiés ici. Aujourd’hui, l’Italie combine les taux de divorce, de naissances hors mariage et de monoparentalité les plus faibles tandis que la Suède enregistre le taux de divorce le plus élevé parmi les pays étudiés. La Suède se situe cependant après la France pour ce qui concerne les naissances hors mariage (57 pour cent des naissances en France) et après la France et le Royaume-Uni pour la proportion de ménages monoparentaux. L’Allemagne se caractérise par un taux de divorce semblable à celui du Royaume-Uni, mais par des taux de naissance hors mariage et de monoparentalité relativement faibles. Et alors que les familles multi générationnelles restent relativement nombreuses en Italie, elles sont quasi inexistantes en Suède, et faiblement répandues dans les autres pays. C’est aussi en Italie que les enfants vivent en plus grand nombre avec leurs deux parents mariés : c’est le cas pour 84 pour cent des enfants de moins de 18 ans comparés à 50 pour cent en Suède, 64 pour cent au Royaume-Uni et en France et 78 pour cent en Allemagne (OECD 2015). C’est aussi en Italie que la proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant avec deux parents non mariés est la plus faible (5,5 %) et en Suède qu’elle est la plus élevée (30,5 %).
Un second changement significatif au regard de l’évolution des modèles familiaux découle de la participation croissante des femmes, et notamment des mères, au marché du travail. Les disparités entre les cinq pays sont importantes. La Suède avec 73 pour cent et l’Italie avec 50 pour cent représentent de nouveau, parmi les pays étudiés, les deux pôles en ce qui concerne les taux d’emploi des femmes de quinze à soixante-quatre ans. Ces taux sont respectivement de 69 pour cent, 61 pour cent et 67 pour cent en Allemagne, en France et au Royaume-Uni (European Commission 2015). Mais c’est en Allemagne que le taux d’emploi à temps partiel est devenu le plus élevé pour les femmes (47 pour cent contre 32 pour cent en Italie, 42 pour cent au Royaume-Uni et 38 pour cent en Suède). En France la proportion de femmes travaillant à temps partiel stagne depuis une quinzaine d’années autour de 30 pour cent, un niveau bien inférieur à celui de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Le processus de déspécialisation des rôles masculins et féminins au sein de la famille revêt une ampleur variable dans les cinq pays, reflétant divers stades de l’émancipation des femmes vis-à-vis du modèle familial traditionnel.
Les transformations des formes familiales ont été diversement prises en compte par les politiques sociales, à la fois du point de vue des réponses apportées aux besoins de prise en charge des enfants et des personnes dépendantes et du point de vue de la construction de la citoyenneté sociale des femmes.
1.2 Justification de la grille d’analyse : la construction différenciée des droits sociaux
Chacun des pays sélectionnés pour la comparaison illustre la typologie désormais classique d’Esping-Andersen des États-providence en Europe (Esping-Andersen Reference Esping-Andersen1990). Cette typologie prend en compte l’agencement entre trois institutions à même de prendre en charge les principaux risques sociaux : la famille, qui fonctionne selon un principe de réciprocité, le secteur public, qui organise la redistribution, et le marché fondé sur l’échange monétaire, auxquels s’ajoute le secteur associatif ou la société civile. Considérant la place respective de ces trois institutions de protection sociale, l’auteur distingue trois régimes de « Welfare Capitalism » : un régime social-démocrate dont les référentiels sont l’universalisme et l’égalitarisme, un régime corporatiste-conservateur fondé sur une organisation par types de métiers, et un régime libéral qui promeut la responsabilité individuelle. Le régime social-démocrate caractérise les pays scandinaves, où l’État assure une prise en charge des risques sociaux. Les solidarités publiques y sont dominantes et le rôle redistributeur de l’État y est largement plébiscité. Ce faisant, la politique de dé-familialisation des activités domestiques et parentales permettant aux parents de participer au marché du travail y est largement admise. Le régime conservateur est de règle en Europe continentale et, de façon un peu différente, dans l’Europe méditerranéenne. Le système de protection sociale y est largement influencé par le christianisme, notamment le catholicisme, et la conception de la famille qu’il promeut. L’État adopte une politique familialiste qui favorise le modèle de spécialisation des rôles masculins et féminins. Dans ces pays, dont font partie la France et l’Allemagne, et jusqu’à un certain point l’Italie, un système de protection sociale plus ou moins bismarckien a été adopté. Enfin, le régime libéral caractérise les pays anglo-saxons parmi lesquels l’Angleterre, où l’influence catholique est faible. L’État y joue un rôle limité, la régulation par le marché y étant réputée idéale. L’intervention de l’État passe par un encouragement aux services privés. La politique d’aide aux familles est ciblée sur les familles qui en ont besoin, se limitant à des prestations sous conditions de ressources qui jouent le rôle de filet de sécurité. La vision du risque social y est resserrée, à l’opposé du régime social-démocrate fondé sur une vision plus extensive.
Le concept de « dé-commodification », central dans la construction de cette typologie, a été abondement critiqué, notamment par les chercheuses féministes, au motif qu’il ne prend pas en compte le travail non rémunéré des femmes au sein de la famille. Pour remédier à cette limite, plusieurs auteurs suggèrent de compléter ce concept par celui de « dé-familialisation » afin de réhabiliter les relations de genre dans la comparaison des systèmes de protection sociale (McLaughlin et Glendinning Reference McLaughlin, Glendinning, Hantrais and Mangen1994a, Reference McLaughlin and Glendinning1994b; Lister Reference Lister, Baldwin and Falkingham1994; Sainsbury Reference Sainsbury1996). Si l’on admet à la suite de McLaughlin et Glendinning (Reference McLaughlin, Glendinning, Hantrais and Mangen1994a, 65) que le terme dé-familialisation signifie « the terms and conditions by which people engage in families, and the extent to which they can uphold an acceptable standard of living independently of the (patriarchal) family », la famille prend alors une place de premier plan dans la comparaison des régimes de protection sociale, avec les obligations qui incombent à ses membres, et en particulier aux femmes. Dans un ouvrage ultérieur, Esping-Andersen combine les concepts de dé-familialisation et de dé-commodification (Esping-Andersen Reference Esping-Andersen1999, 51).
Le concept de familialisation permet de spécifier les régimes de protection sociale au regard de l’apport des familles à la protection des individus. Ainsi, un système de protection sociale familialisé assigne un maximum d’obligations à la famille tandis qu’un système dé-familialisé suppose l’existence de politiques sociales ou familiales qui réduisent la dépendance des individus vis-à-vis de la famille, et qui encouragent leur autonomie économique (Esping-Andersen Reference Esping-Andersen1999, 45). La dé-familialisation peut prendre diverses formes : des services publics promus par l’État ou les collectivités locales (socialisation des activités de soins et d’éducation), des services privés (marchandisation), ou des services fournis par des associations ou des ONG (communautarisation). Les politiques de dé-familialisation ouvrent aux femmes la possibilité de s’émanciper économiquement de leur statut d’épouse ou de mère, par l’accès à un revenu issu de la participation au marché du travail, et socialement par l’accès à des droits sociaux personnels, et non plus dérivés de l’activité professionnelle du conjoint. Dès lors, si l’on tient compte de la contribution des femmes à l’entretien de la famille comme le propose Jane Lewis (Reference Lewis1992), les pays que l’on retient pour cette étude reflètent différentes « conventions de genre » (Letablier Reference Letablier2009) ou « rapports sociaux de sexe » (Orloff Reference Orloff1993).
D’autres recherches ont aussi montré que la famille n’a pas le même statut au regard des politiques publiques. Le Royaume-Uni et la Suède se distinguent par l’absence de politique familiale stricto sensu au profit d’une politique sociale qui cible les individus plutôt que la famille. À l’opposé, la politique familiale est ancienne et assumée en France et en Allemagne, visant à protéger la famille et à influer sur les comportements démographiques ou d’activité (Hantrais et Letablier Reference Hantrais and Letablier1996). La famille est aussi un pilier de la société italienne, qui supplée l’État pour la protection des individus (Saraceno Reference Saraceno1994).
Ces recherches fournissent un appui pour sélectionner les pays étudiés ici et pour forger une grille d’analyse qui permette de rendre compte des évolutions des régimes de familialisation dans un contexte général de promotion des valeurs et des principes d’égalité entre les sexes. Certaines politiques familiales qualifiées de « maternalistes » (Orloff Reference Orloff2006) ont pu en effet viser en premier lieu à promouvoir et protéger la maternité et le rôle des mères dans les soins et l’éducation des enfants, tandis que d’autres ont davantage cherché à limiter les effets de la maternité et des enfants sur les carrières des mères par des dispositifs de sécurisation de leurs trajectoires professionnelles, soit directement par des systèmes de congés parentaux, ou de manière différée par des mécanismes de compensation de l’investissement domestique et parental dans les systèmes de retraites.
Partant de ces acquis, et en utilisant les concepts de familialisation/dé-familialisation, d’une part, et de spécialisation/déspécialisation des rôles masculins et féminins d’autre part, nous avons élaboré une grille d’analyse comparative pour regarder le congé parental comme premier système compensatoire de l’investissement parental durant la vie professionnelle. Nous procéderons de même pour comparer les dispositifs compensatoires des interruptions de carrière pour l’éducation des enfants dans les systèmes de retraite.
2 Politiques sociales et politiques d’égalité : des évolutions contrastées selon les pays
2.1 En France : une dé-familialisation partielle et une déspécialisation limitée
La figure centrale autour de laquelle le système des droits sociaux a été conçu est celle du « travailleur et de sa famille », comme le stipule l’ordonnance de 1945, qui créait la Sécurité sociale. Le travail rémunéré de l’homme ouvre l’accès à la protection sociale des membres de sa famille considérés économiquement comme « à charge » et juridiquement comme des « ayants droit ». Le mariage y joue un rôle essentiel dans la mesure où l’union légale des conjoints garantit un système de droits et de devoirs entre époux (obligation alimentaire des conjoints l’un envers l’autre et droits dérivés pour l’épouse au foyer …). Les époux sont ainsi supposés mettre en commun leurs ressources, au service d’objectifs communs. Cette extension familiale de la protection sociale ne requiert pas de cotisations supplémentaires.
La diffusion du modèle familial de Monsieur Gagnepain et Madame au Foyer fut fortement encouragée par la politique familiale dès les années 1930, et consolidé après 1945 pour satisfaire deux objectifs : la nécessité d’encourager la natalité et la volonté de soutenir un modèle de famille permettant le maintien d’un ordre social et d’un ordre sexué (Dauphin Reference Dauphin2015). Si la visée nataliste de la politique familiale est aujourd’hui moins explicite, les dispositifs qui ont accompagné sa mise en œuvre restent en place. Il en est ainsi du principe de solidarité horizontale qui continue d’irriguer la politique familiale, privilégiant la solidarité entre les familles qui ont des enfants, nombreux de préférence, et celles qui n’en ont pas ou peu, au détriment d’une solidarité verticale fondée sur une redistribution en fonction des revenus. Si depuis les années 1980, les réformes sont allées dans ce sens, révélant un tournant social de la politique d’aide aux familles, la force des principes fondateurs perdure. Il en est de même du modèle familial que cette politique a cherché à promouvoir.
Ce système, cohérent dans son ensemble, entretient un assujettissement des femmes à leur époux, et en particulier celles qui restent au foyer et qui ne disposent ni d’un salaire, ni de droits sociaux personnels. Lors de sa mise en place, le système avait prévu de rétribuer l’activité au foyer par une allocation (allocation de mère au foyer), ou de compenser le « manque à gagner » (allocation de salaire unique). Plutôt qu’un salaire familial, cette allocation, instaurée en 1938 et reprise dans le Code de la famille en 1946, reste emblématique du double ancrage familialiste et nataliste du système français. Cette allocation visait à encourager la natalité, et à rétribuer l’activité domestique des femmes dès leur mariage. Toutefois, n’ouvrant pas l’accès à des droits sociaux, elle ne peut être assimilée à un salaire maternel. Mais dès lors qu’un nombre croissant de femmes mariées ont intégré le marché du travail, et du fait qu’elle n’ait pas été revalorisée, cette allocation emblématique du modèle familial traditionnel est devenue progressivement obsolète avant d’être supprimée en 1978. En revanche, le système fiscal qui participe également au maintien de l’ordre social et sexué reste inchangé jusqu’à ce jour. Le quotient familial qui module les impôts en fonction du nombre d’enfants à charge, et le quotient conjugal qui tient compte du fait d’être marié ou en union civile restent au cœur de ce système fortement familialisé.
La politique familiale a néanmoins pris acte de la participation croissante des femmes au marché du travail. Aujourd’hui, les femmes sont massivement en emploi, qu’elles soient mariées ou non, et y restent souvent lorsqu’elles ont des enfants. L’incidence de la maternité sur l’activité professionnelle des mères est visible à partir du deuxième enfant, et s’accroit à partir du troisième. Ce sont surtout les mères avec les salaires moyens ou faibles qui interrompent leur activité avec l’arrivée des enfants pour la reprendre éventuellement à temps partiel après l’entrée des enfants à l’école maternelle. Toutefois, seulement la moitié des femmes ayant droit à un congé parental y a recours; les autres reprennent leur activité professionnelle après la fin du congé de maternité.
La politique d’égalité entre femmes et hommes mise en place depuis le milieu des années 1970, s’est focalisée en priorité sur l’égalité professionnelle, laissant à la politique familiale le soin de mettre en place des prestations et des services d’accueil des enfants (Dauphin Reference Dauphin2015). Le système de prestations familiales a été progressivement restructuré pour répondre aux besoins des parents qui travaillent, mais le référentiel du « libre choix » qui a présidé à la réorientation de la politique familiale a limité le processus de dé-familialisation des activités parentales.
2.2 En Allemagne, amorce d’un double processus de dé-familialisation et de déspécialisation des activités
Inspirée par l’expérience suédoise, l’Allemagne a procédé au cours de la décennie 2000 à des réformes de sa politique d’aide aux familles allant dans le même sens, c’est-à-dire faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes sa priorité affichée, mais sans aller aussi loin dans le processus d’individualisation des droits sociaux, ce qui lui vaut d’être qualifiée de « dé-familialisation » progressive (Daly and Scheiwe Reference Daly and Scheiwe2010).
Le rôle social des femmes en tant que mères a longtemps été considéré comme un pilier de l’État-providence conservateur et corporatiste allemand (Kaufmann Reference Kaufmann2009). L’organisation de la protection sociale, comme aussi du système salarial et du marché du travail, a été calée sur une division sexuée des rôles masculins et féminins, plaçant en leur centre le travail de l’homme, pourvoyeur économique de la famille. Ce modèle familial de solidarité conjugale était soutenu par les institutions de la politique familiale, de la protection sociale et de la politique fiscale. Le système reposait sur la famille comme cellule de base de la société, et sur les solidarités intra familiales organisées et confortées par les politiques sociales (Leitner Reference Leitner2003).
C’est avec l’entrée au gouvernement de la coalition rouge-verte en septembre 1998 que des changements fondamentaux ont pu se produire en faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes un objectif majeur, fondée sur la participation à l’emploi considérée comme condition nécessaire à la sécurité économique des femmes, et sur le partage des activités parentales (MacRae Reference MacRae2006). Cet objectif impulsé par l’Union européenne a guidé les réformes du système de protection sociale au cours de la décennie 2000, mais sans venir à bout des inégalités de genre sur le marché du travail (Bothfeld Reference Bothfeld2009). Il ne s’est pas davantage accompagné d’une évolution concomitante des règles légales et institutionnelles qui régissent le système de sécurité sociale et le droit familial.
Bien débattu déjà avant 2006, le nouveau régime de l’allocation parentale symbolise aujourd’hui la mesure paradigmatique du changement de référentiel politique (Klammer et Letablier Reference Klammer, Letablier, Palier and Martin2008). À cette démarche s’ajoute l’expansion du système d’accueil des enfants de moins de trois ans, récemment renforcé par l’instauration en 2013 d’un nouveau droit pour ces enfants à un mode d’accueil.
La réforme des retraites entrée en vigueur en 1991-1992 a intégré la maternité et les soins aux enfants dans le système. De même, l’assurance chômage prend désormais en compte les périodes consacrées à la garde des enfants en permettant le report du droit à l’allocation chômage sur la période du congé parental. En outre, le principe de stricte équivalence entre cotisations et prestations dans le régime de sécurité sociale a été assoupli afin de mieux compenser les suspensions d’activité professionnelle dédiées aux enfants. L’introduction du partage des droits entre conjoints (« splitting ») dans le système fiscal et dans le système de retraite, pour compenser les inégalités économiques résultant de l’investissement parental et domestique des femmes, n’a pas encore eu les effets escomptés. Les droits dérivés (notamment dans l’assurance maladie), ainsi que les pensions de réversion, restent encore le principal mode d’accès à la protection sociale pour les femmes mariées des générations les plus âgées. Ce système encourage le mariage, lequel reste le critère conditionnel au partage de ces droits.
Au total, l’Allemagne apparaît comme un système fragmenté dont les règles varient selon les types de prestations sociales. Son système de protection sociale reste très partiellement dé-familialisé, et la convention de genre qui le régit reste imprégnée d’une représentation différentialiste des rôles sociaux des femmes et des hommes, comme le signale le taux élevé de travail à temps partiel des femmes.
2.3 En Suède : une individualisation progressive des droits sociaux
L’accent mis sur les droits individuels résulte d’une longue tradition remontant au début du XXe siècle, lorsque les femmes participaient activement au marché du travail, qu’elles appartenaient à la classe ouvrière ou au monde agricole. Très tôt, la citoyenneté sociale des mères ne fut plus fondée sur la maternité, mais sur leur statut de travailleuse.
La politique d’égalité entre femmes et hommes mise en place dans les années 1960-1970, a évolué vers une politique de soutien aux parents qui travaillent. Elle stipule que les hommes, comme les femmes, doivent assumer un double rôle de parents et de travailleurs, impliquant que chaque famille se compose de deux pourvoyeurs au revenu du ménage et de soins aux enfants. Le changement majeur introduit dès la fin des années 1960 repose sur l’obligation faite aux femmes, qu’elles aient ou non des enfants, de participer au marché du travail, en vertu du principe selon lequel chaque individu doit être responsable de sa propre subsistance, économiquement autonome et légalement titulaire de droits propres.
Ainsi, depuis les années 1970, la politique sociale suédoise, y compris la politique d’aide aux familles, a été individualisée, ce qui signifie que la plupart des prestations sont versées aux individus titulaires de droits, et sont indépendantes des liens familiaux. Cette politique est neutre du point de vue du genre alors que jusque dans les années 1970, la maternité était invoquée pour justifier que certaines prestations soient réservées aux femmes. Une commission gouvernementale à l’époque stipulait que les changements devaient être fondés sur le principe d’égalité entre femmes et hommes. Elle prévoyait en même temps une garantie de garde partagée des enfants pour les pères non mariés, ainsi que la neutralité totale des prestations vis-à-vis des formes de vie familiale. Les dix années de travaux de cette commission ont abouti à des changements profonds, et en particulier à la déconnexion entre prestations sociales et règles du mariage : individualisation de la fiscalité (1971), facilitation du divorce (1974), assurance parentale (1974), droit à l’interruption volontaire de grossesse (1975), expansion de l’offre municipale de services publics d’accueil pour les enfants (1976), droit à la réduction du temps de travail pour les parents de jeunes enfants (1979).
Les critiques formulées dans les années 1980 à l’encontre de ces changements ont mis l’accent sur les maigres résultats concernant le partage des responsabilités parentales (Lundqvist Reference Lundqvist2011). L’implication des hommes dans les soins et l’éducation des enfants a été jugée prioritaire. Cet objectif a justifié l’introduction de quotas dans le système d’assurance parentale ainsi que l’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité.
Les mesures introduites par le gouvernement de centre droit au pouvoir entre 2006 et 2014 ont été en grande partie supprimées par le gouvernement rouge-vert arrivé au pouvoir en 2014. C’est le cas de la prime égalité (gender equality bonus) introduite dans l’assurance parentale, et des déductions fiscales pour l’emploi d’une aide à domicile. L’allocation de garde parentale d’enfants a aussi été supprimée, et la déduction fiscale pour l’emploi d’une personne à domicile introduite par le précédent gouvernement a été réduite de 50 pour cent à 30 pour cent. De même, ont été supprimées les déductions fiscales liées aux cotisations aux retraites privées. Aujourd’hui, le débat politique porte sur l’allongement de la partie non transférable du congé parental entre parents.
Au total, parmi les pays étudiés ici, la Suède représente le pays qui a poussé le plus loin le processus d’individualisation des droits sociaux en lien avec la mise en œuvre du principe d’égalité entre les sexes. Ce processus va de pair avec une intervention soutenue de l’État pour aider les parents qui travaillent, à la fois en termes d’offre d’accueil pour les enfants, de flexibilité de l’organisation du travail, et d’incitation au partage des activités parentales et familiales entre parents.
2.4 Au Royaume-Uni, une dé-familialisation effective et une déspécialisation limitée
Dans l’après-guerre, lors de la mise en place du système de welfare conçu par Beveridge, les conjoints avaient un rôle et des obligations définis et inscrits dans le contrat de mariage : au mari d’être le gagne-pain à plein temps, à la femme de s’occuper du foyer et des enfants à plein temps, et à l’État de veiller à ce que les conjoints remplissent ces fonctions sans avoir à y suppléer en cas d’échec du mariage. En dernier recours, les hommes qui refusaient de remplir le rôle qui leur était assigné pouvaient être envoyés en prison et, jusque dans les années 1960 dans certains emplois (services publics et enseignement entre autres), les femmes devaient quitter leur emploi lorsqu’elles se mariaient. Le principe du « family wage » devait permettre à l’homme de subvenir par son salaire aux besoins de sa femme et de ses enfants (Land et Parker Reference Land and Parker1984). Mais contrairement à de nombreux autres pays européens, il n’y a jamais eu au Royaume-Uni de politique familiale explicitement destinée à protéger une forme et une conception de la famille, ni à orienter les comportements démographiques comme en Suède ou en France. Le mariage assurait le respect de certaines obligations. Le système de protection sociale reconnaît des individus plutôt que des familles, et le système fiscal est depuis longtemps individualisé.
2.5 En Italie, une familialisation « par défaut » entretenant la spécialisation des rôles
Plusieurs auteurs ont souligné le caractère « par défaut » du familialisme des pays de l’Europe du Sud lié à la délégation aux familles des fonctions que l’État n’assume pas, ou n’est pas en mesure d’assumer par manque de moyens et /ou de légitimité (Trifiletti Reference Trifiletti, Millar and Warman1995 et Reference Trifiletti1999; Naldini Reference Naldini2003). Cette délégation concerne en premier lieu, et principalement, les fonctions d’assistance, mais sans que l’État les soutienne par des financements suffisants ou par une offre de services.
En outre, comme dans les autres pays de l’Europe méditerranéenne, le modèle familial du male breadwinner n’est qu’en partie réalisé en Italie, en raison de la longue tradition agricole, de l’industrialisation tardive et limitée à certains territoires. Par conséquent, la trajectoire de dé-familialisation des droits sociaux ne part pas d’un modèle familial de male breadwinner consolidé, partagé et affiché, mais plutôt d’une famille élargie au système de parenté qui survit à l’urbanisation et perdure à travers une tradition de travail indépendant et de petite entreprise familiale.
Jusqu’en 1975, la Constitution, qui affiche le principe d’égalité entre les sexes, a fait bon ménage avec le Code civil du régime fasciste, bien que le retour des femmes au foyer n’ait jamais été prôné par les politiques sociales. Les femmes pauvres travaillaient dans le marché gris et noir pour des salaires d’appoint, voire sans être rémunérées dans l’entreprise familiale. La protection sociale était une sorte de protection rapprochée, régulée par les valeurs de solidarité entre proches et parents, entretenues par l’Église et réglées par le Code civil. En fait, la question de la reconnaissance de la valeur sociale du travail domestique n’a jamais été portée à l’agenda, ni celle des compensations des interruptions d’activité pour les enfants.
La révision du Code civil en 1975 a conduit à l’abandon de la référence au « chef de famille » et à la notion de patria potestas, tandis que les articles réglant les obligations familiales sont restés intouchés. Ces articles prévoient l’obligation alimentaire (« alimenti ») pour tout le réseau des parents et collatéraux (époux, enfants légitimes et illégitimes, parents et ascendants frères et sœurs, voire demi-frères et demi-sœurs, beaux-parents beaux-frères et sœurs - art. 433 CC.). Les obligations alimentaires et de niveau de vie envers les enfants sont fixés sans limite d’âge jusqu’à ce que les enfants deviennent autonomes. L’obligation s’étend aux petits enfants si les parents ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins (art. 147 CC.). Ces deux niveaux d’obligations, horizontale envers les enfants et verticale envers les ascendants et descendants, perdurent, mettant un frein à toute possibilité de dé-familialisation. Selon cette conception étendue des obligations familiales qui valorise la solidarité privée au détriment de la solidarité publique, la famille se trouve au centre du système de protection sociale dans un contexte où l’action de l’État est réduite à minima.
Ce rapide tour d’horizon des logiques familiales et sociales dans les cinq pays signale différents régimes de solidarité selon qu’ils sont fondés prioritairement sur la famille, le couple (marié), ou la collectivité. Nous examinons maintenant les principes compensatoires à l’œuvre dans les congés parentaux, puis dans les systèmes de retraite.
3 Compensations des interruptions et des réductions d’activité professionnelle
Dans la mesure où il est susceptible d’influencer les comportements individuels, le système des congés parentaux s’inscrit dans les processus de choix professionnels faits par les conjoints. Ces choix, parfois contraints par l’absence ou l’insuffisance de soutien aux parents qui travaillent, comportent des risques au regard de l’employabilité de l’un des conjoints juste après le divorce, et d’incidence à plus long terme sur la retraite de l’un des conjoints, ces incidences étant plus ou moins fortes selon les dispositifs publics existants. Selon le degré d’intervention des États et selon leur idéologie plus ou moins familialiste, le risque d’inégalités au moment du divorce sera plus ou moins atténué.
3.1 Compensations par le congé parental
À la différence du congé de maternité, qui a un caractère obligatoire, le congé parental est optionnel. Les règles relatives au congé de maternité répondent à une exigence de protection de la maternité et de la santé des mères au travail. La directive sur le congé de maternité (Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992) fixe à 14 semaines la durée minimum du congé dans les pays membres de l’Union européenne. La durée de ce congé varie cependant selon les pays, de 14 semaines en Allemagne, à 16 semaines en France, 20 semaines en Italie et 26 semaines au Royaume-Uni. En Suède, le congé de maternité est fusionné avec le congé parental depuis 1974, pour une durée totale de 75 semaines. Au Royaume-Uni, le congé de maternité de 26 semaines peut être prolongé par un congé additionnel facultatif de 26 semaines dont 13 rémunérées, ce qui autorise une rémunération pour une durée totale de 39 semaines maximum, équivalente à 90 pour cent du salaire brut moyen hebdomadaire, plafonné à partir de la 7e semaine de congé. En Allemagne comme en France, la rémunération du congé équivaut à 100 pour cent du salaire antérieur, mais plafonné en France. Elle équivaut à 90 pour cent du salaire en Italie et à 80 pour cent en Suède. Certains pays accordent un congé de paternité (en France depuis 2002 et en Italie depuis 2011) ou réservent une part du congé aux pères (en Suède et au Royaume-Uni). Ces congés réservés aux pères sont rémunérés en proportion du salaire, jusqu’à un certain plafond.
Le congé parental est lui aussi régulé par une directive communautaire, laquelle a fait l’objet d’une révision en 2010 (encadré 1).
Encadré 1 : la directive communautaire sur le congé parental
La directive communautaire 96/34 du 3 juin 1996 sur le congé parental a été révisée en 2010 (Dir. 2010/18/UE) suite à l’accord-cadre européen du 18 juin 2009. La nouvelle directive fixe le principe d’un droit individuel des travailleurs à bénéficier d’un congé parental pour pouvoir s’occuper de leur enfant, biologique ou adoptif, jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans. La fixation de cette limite d’âge est laissée aux États membres ou aux partenaires sociaux, qui devaient transposer la directive dans les deux ans suivant sa publication. La durée minimale du congé est prolongée, passant de trois à quatre mois, avec un mois non transférable à l’autre parent, de manière à inciter les pères à prendre une partie du congé. Les modalités d’application du congé parental sont définies par les États membres ou les partenaires sociaux, qui peuvent décider d’accorder le congé à temps plein, à temps partiel, de manière fragmentée ou sous forme d’un crédit-temps, tenant compte des besoins des employeurs et des travailleurs. Des modalités particulières sont prévues en cas d’enfant gravement malade. Ce droit s’applique à tous les travailleurs, quel que soit leur contrat de travail. Les conditions d’accès au congé sont définies dans chaque pays. Le droit au congé peut être conditionné à une ancienneté dans l’emploi, mais qui ne peut dépasser un an. La directive ne prévoit pas de rémunération, cette décision étant laissée aux États membres ou aux partenaires sociaux. Plusieurs dispositions sont prévues pour protéger le travailleur en congé, concernant notamment la garantie de retour sur le poste de travail, l’aménagement des horaires et la réintégration dans l’entreprise.
Les configurations actuelles du congé parental en termes de durée, de rémunération, de transférabilité varient considérablement d’un pays à l’autre. Ces configurations révèlent des formes très variables de compensation de l’investissement parental, ainsi que des logiques contrastées d’allocation de droits sociaux associés à la maternité et à la parentalité.
3.1.1 Des objectifs différents
Tous les pays n’ont pas attendu la directive européenne pour mettre en place un congé parental. Parmi les pays étudiés ici, la Suède se démarque par l’antériorité de sa décision, prise dès 1974, de combiner congé de maternité et congé parental. Le droit à un congé parental a été inscrit dans le code du travail français en 1977, et l’allocation parentale d’éducation (APE) destinée à compenser l’interruption d’activité professionnelle par la politique familiale a été créée en 1985. La mise en place du congé parental remonte à 1986 en Allemagne, à 2000 au Royaume-Uni, contraint de transcrire la directive européenne de 1996 (Dir. 96/34/CE), et à 2000 en Italie avec la loi 53/2000, qui réorganise les droits aux congés alloués aux parents. Alors qu’en Suède, l’objectif du congé parental était de stimuler la participation des mères au marché du travail, en lien direct avec une politique d’égalité entre femmes et hommes, les objectifs étaient plus diffus et controversés en France. Si l’objectif affiché par l’inclusion du congé parental dans le droit du travail était d’accompagner le mouvement de participation des mères au marché du travail et ainsi d’octroyer des droits nouveaux aux mères en emploi, les objectifs assignés à l’Allocation parentale d’éducation (APE) étaient quant à eux entachés d’un certain flou. Il s’agissait pour ses promoteurs de permettre aux mères qui le souhaitaient de poursuivre leur activité professionnelle ou de l’interrompre pour élever leurs jeunes enfants, sous certaines conditions d’expérience professionnelle et de nombre d’enfants. Cette politique de « libre choix » visait en fait à contenir l’effet supposé du travail des mères sur le niveau de la fécondité d’une part Footnote 2 , et à maintenir les mères dans leur rôle éducatif d’autre part, au moins jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école maternelle. En Allemagne, le congé parental visait plutôt à rémunérer sous une forme forfaitaire le travail parental des mères, par une allocation s’apparentant à un « salaire maternel » car aucune condition d’activité professionnelle antérieure n’était requise pour avoir droit à cette allocation, qui restait liée au fait d’avoir un enfant en bas âge. Le Royaume-Uni se distingue des autres pays par une application stricte de la directive. Le congé parental n’y est pas rémunéré, et par conséquent ne compense pas financièrement l’interruption ou la réduction d’activité professionnelle des parents qui y ont recours. L’Italie revendique une longue tradition d’attention législative à la maternité et à la protection de la mère au travail. Cette législation a toutefois été portée par un souci de protection des enfants plutôt que par un souci d’égalité (Del Re et de Simone Reference Del Re and de Simone2005, 162 et suiv.). Pour autant, les objectifs assignés au congé parental mettent en avant la nécessaire implication des pères dans les activités parentales. Ce n’est qu’au début des années 2000 que ce droit sera affiché en tant que tel dans le décret législatif de 2001 (n° 151/2001) qui réunit dans un répertoire (Testo Unico – TU) les dispositions législatives en matière de congés liés à la famille et qui en fixe l’organisation. Cette organisation sera revue à plusieurs reprises, jusqu’en 2015 pour ce qui concerne le congé parental et sa mise en conformité avec la nouvelle directive communautaire.
3.1.2 Une diversité de fonctionnement
C’est en Allemagne et en France que la durée du congé est la plus longue : 148 semaines en Allemagne et 146 en France, et au Royaume-Uni qu’elle est la plus courte, treize semaines, c’est-à-dire la durée minimum prévue par la directive européenne Footnote 3 . La durée longue en Allemagne et en France témoigne à la fois de l’importance accordée aux parents (mères) dans les soins et l’éducation des jeunes enfants, et de la part prise par l’État dans cette responsabilité. La durée du congé de 480 jours en Suède regroupe congé de maternité et congé parental, incluant soixante jours réservés au père et non transférables. En Italie, la durée du congé est de onze mois dont un mois réservé au père.
La compensation financière du congé peut être totale ou partielle sur la durée; elle peut aussi être inexistante comme au Royaume-Uni, ou laissée à la négociation collective entre les partenaires sociaux. Alors qu’elle s’applique à toute la durée en Suède, elle est limitée en Allemagne et en Italie. En effet, depuis la réforme allemande de 2007, non seulement le principe de rémunération a changé mais la durée de rémunération a été raccourcie à 75 semaines Footnote 4 .
Autant que le montant, les formes de compensation varient d’un pays à l’autre. Elles peuvent prendre la forme d’un salaire de remplacement comme en Suède, en Allemagne ou en Italie, ou d’une allocation forfaitaire comme en France. Le taux de remplacement du salaire varie de 80 pour cent du salaire antérieur en Suède à 67 pour cent en Allemagne Footnote 5 et 30 pour cent en Italie. En France, la politique familiale verse une allocation forfaitaire aux parents qui interrompent leur activité, laquelle varie en fonction du rang de l’enfant. Les conditions d’accès à cette allocation ont été modifiées à plusieurs reprises, comme aussi sa dénomination : Allocation parentale d’éducation, puis Complément de libre choix d’activité en 2004 et, enfin, Prestation partagée d’éducation de l’enfant en 2014. Les modifications ont porté sur les conditions antérieures d’activité professionnelle (assouplissement par les gouvernements de droite et renforcement par les gouvernements de gauche), sur la possibilité d’une allocation à taux partiel pour les parents qui optent pour une réduction d’activité, et enfin sur des ajustements en fonction du rang de l’enfant (création du complément libre choix d’activité – COLCA - pour les parents d’au moins trois enfants et instauration d’une allocation plus courte pour les parents d’un premier enfant). La France est le seul parmi les pays étudiés où l’allocation dépend du rang de l’enfant.
Dans plusieurs pays, le congé parental a été remodelé afin de le rendre plus équitable entre les parents. En Suède, deux mois non transférables sont réservés au père, qui sont perdus si celui-ci ne les prend pas selon le principe « à prendre ou à laisser » (« take it or lose it »). Un système analogue a été instauré en Allemagne lors de la réforme de 2007, en France depuis 2014, avec six mois non transférables réservés au père ou au parent qui n’a pas pris le congé, et en Italie.
3.1.3 Des compensations qui tendent à se dé-familialiser
Les diverses configurations du congé parental (durée, rémunération, financement, partage) reflètent fortement le caractère plus ou moins individualisé, ou familialisé, du système de protection sociale, et ses référentiels normatifs au regard des rôles parentaux dans l’éducation des enfants et de la conception dominante de l’égalité des femmes et des hommes. Les réformes successives du congé parental signalent un souci d’égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère privée, fondé sur l’idée que les inégalités dans la sphère publique/professionnelle prennent leurs racines dans les inégalités présentes dans la sphère privée. Le système suédois reste celui qui est le plus dé-familialisé. La réforme allemande s’est inspirée du système de congé parental suédois, tant dans le mode de rémunération que dans l’incitation au partage avec le père, ce qui introduit un changement radical au regard de la conception qui prévalait avant la réforme, amorçant un processus de dé-familialisation de ce congé. En revanche, les réformes françaises paraissent plus timides, car en dépit des changements de dénomination de l’allocation, celle-ci reste une prestation de la politique familiale qui conforte son statut d’allocation (forfaitaire) au détriment d’une référence au salaire et à l’activité professionnelle. La rémunération reste ainsi consubstantielle à la famille plutôt qu’au travail. En Italie, en dépit de la grande flexibilité du congé parental, son faible taux de rémunération ne permet pas une réelle autonomie des mères et reste peu incitatif pour les pères, malgré les objectifs affichés allant dans ce sens, notamment depuis la réforme de 2015 (décret du 15 juin 2015), qui introduit une flexibilité plus grande dans les conditions de prise du congé. Footnote 6
Dans la plupart des pays, la compensation est dorénavant davantage fondée sur l’objectif de sécuriser les trajectoires professionnelles ou de compenser les interruptions de carrière. À l’inverse, cette forme de compensation ne tente plus de consolider le modèle de la femme au foyer en lui offrant une rémunération de son travail domestique. On peut avancer l’hypothèse que cette évolution est parallèle au recul relatif du modèle de la prestation compensatoire comme revenu de substitution versé à la femme qui s’est consacrée aux activités domestiques, au profit d’une compensation de sa perte corrélative de capacité de gains.
Des recherches ont montré que les politiques qui incitent fortement au retrait du marché du travail à l’occasion de la maternité contribuent à creuser les inégalités entre les hommes et les femmes, en termes de carrière professionnelle, de rémunération et de retraites (Chauffaut et Pucci Reference Chauffaut and Pucci2012; Lequien Reference Lequien2012). Ces politiques creusent aussi les inégalités entre les membres du couple, et accroissent les risques d’iniquité au moment du divorce, en particulier si la durée du congé est élevée et la compensation limitée. Le risque est plus faible si l’incitation au partage du congé entre les parents est forte, si la durée est courte ou si le congé est pris à temps partiel.
De fait, en France, où le risque inégalitaire est élevé (durée longue, rémunération forfaitaire, suspension du contrat de travail et des cotisations retraite), le recours au congé parental reste relativement modeste (environ la moitié des ayants droit), et peu pris par les pères (moins de 4 pour cent des pères ayants droit). Les mères qui y ont recours sont celles qui ont les salaires les plus bas, ou les conditions de travail les plus contraignantes au regard de la parentalité. En revanche, le congé est davantage plébiscité dans les pays où il est plus court, mieux compensé et plus flexible, comme en Suède ou en Allemagne. Le mécanisme de compensation y est pour quelque chose. Il est peu incitatif en France du fait de son caractère forfaitaire et de son faible niveau, qui ne le rend attractif que pour les salariés ayant les salaires les plus bas. Au total, dans la mesure où le congé parental s’inscrit dans un processus de choix professionnels et familiaux (même si ceux-ci sont contraints et pas toujours choisis), il entretient, voire renforce, la division sexuée des tâches au sein du couple. Il a aussi des incidences sur le montant de la retraite, et accroît les risques d’inemployabilité après séparation.
3.2 Compensations dans les régimes de retraite obligatoires
Les carrières professionnelles discontinues, ainsi que les durées du travail plus courtes des femmes en comparaison de la durée des hommes, expliquent les écarts de pensions de retraite entre les femmes et les hommes. Des dispositifs de compensation ont été mis en place pour pallier à l’insuffisance des droits des mères. Ces dispositifs non contributifs, indépendants des cotisations versées dans les systèmes contributifs, sont liés à la présence d’enfants. Ils diffèrent sensiblement selon les pays tant par l’ampleur des masses financières qu’ils représentent que par leur variété.
3.2.1 Des objectifs proches, des modalités différentes
Plusieurs objectifs sont assignés aux dispositifs compensatoires : relever le niveau de pensions des femmes dont les carrières professionnelles sont plus courtes et plus segmentées que celles des hommes, compenser le temps consacré aux enfants, faciliter un départ à la retraite anticipé pour les mères de famille ou compenser un déficit d’épargne des familles avec enfants. Ces objectifs ont évolué au fil du temps avec les réformes des systèmes de retraite et avec les injonctions communautaires à promouvoir le principe d’égalité entre les sexes dans les politiques publiques. Comme pour le congé parental, l’influence de l’Union européenne est déterminante dans ces évolutions, qu’il s’agisse des directives et recommandations de l’UE, ou de la jurisprudence communautaire (Lanquetin Reference Lanquetin2011; Lanquetin et Letablier Reference Lanquetin and Letablier2003).
Selon Bonnet, Chagny et Monperrus-Veroni (Reference Bonnet, Chagny and Monperrus-Veroni2004, 344), qui ont comparé les avantages familiaux dans les systèmes de retraite en Allemagne, en France et en Italie, il « ne ressort pas de logique commune aux réformes mises en œuvre dans les trois pays jusqu’au début des années 2000 ». Si les réformes conduites en Allemagne dans les années 1990 visaient clairement à encourager la constitution de droits individuels pour les femmes, les réformes italiennes n’ont que peu introduit de dispositions compensatoires. Et en France, si les réformes ont encouragé la constitution de droits individuels, la logique familialiste qui a prévalu lors de la création de ces droits a perduré. La Suède encourage fortement la constitution de droits individuels depuis le début des années 1970 et s’est affranchie des principes familialistes depuis cette date. Au Royaume-Uni, des dispositifs compensatoires existent mais sont moins développés qu’en France ou en Allemagne par exemple.
Les compensations répondent à différentes logiques selon qu’elles prennent en compte le fait d’avoir donné naissance à des enfants (la maternité), d’avoir interrompu son activité professionnelle pour élever des enfants (le travail parental), ou bien d’avoir encore des enfants à charge au moment du départ à la retraite. Elles prennent aussi différentes formes : majorations de durées d’assurance, bonifications et majorations du montant de la pension, validation des cotisations sociales au titre des périodes de non emploi, possibilité de départ avant l’âge légal d’ouverture des droits. Selon la logique mise en avant, ces compensations sont accessibles exclusivement aux mères ou aux mères et aux pères. Enfin, les compensations n’ont pas seulement un lien direct explicite avec les enfants; elles peuvent être aussi liées au statut conjugal (droits dérivés et réversion).
3.2.2 Compensations liées aux enfants
Plusieurs dispositifs sont utilisés pour compenser l’effet pénalisant de la maternité et du temps dédié aux enfants pendant le cycle de vie.
3.2.2.1 Les majorations de durées d’assurance
En France, les majorations de durées d’assurance (MDA), créées en 1972, consistent, pour les femmes ayant acquis des droits personnels, à accroitre la durée d’assurance en fonction du nombre d’enfants. Une majoration de huit trimestres par enfant est accordée, qu’il y ait eu interruption ou non d’activité professionnelle. Lors de sa création, l’objectif de ce dispositif était double : revaloriser les ressources au moment de la retraite et prendre en compte les interruptions de carrière des mères qui réduisent leur durée de cotisation (Bac Reference Bac2011, 168). Ce dispositif longtemps réservé aux mères est désormais accessible aux pères si les deux membres du couple en décident. Il peut aussi être partagé. En cas de désaccord, ce droit est alloué au parent qui est en mesure d’établir le fait d’avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut d’accord, la majoration est partagée par moitié.
En Allemagne, le principe d’une majoration de durée d’assurance (Kindereiziehungszeiten) a été introduit dans la réforme des retraites en 1994. Cette majoration de trois ans par enfant, et de deux ans (au lieu d’un an) pour les enfants nés avant 1992, procure un avantage substantiel. Le fait d’avoir eu trois enfants donne ainsi droit à neuf années de majoration, et comme la durée minimale de cotisation s’élève à cinq ans, les mères ou les pères de trois enfants peuvent acquérir des droits propres – très bas – à une pension quand bien même ils n’ont jamais cotisé. En pratique, cette possibilité de valider trois années de cotisation par enfant, sans condition d’interruption d’activité revêt une grande importance pour les femmes, à qui elle permet d’augmenter le nombre d’années de cotisation, et ce faisant d’augmenter le montant de leur pension.
En Italie, une majoration de quatre mois par enfant est accordée dans la limite d’un an pour le système en annuités et jusqu’à deux ans dans le système par points.
3.2.2.2 Bonifications pour avoir élevé des enfants
En France, ces bonifications revêtent trois formes : Des majorations de pension pour enfants nés et élevés, des majorations pour enfant à charge au moment de la retraite, et des majorations pour les parents qui ont élevé au moins trois enfants. Leur création avait pour but explicite d’augmenter le montant des pensions des femmes, en prenant en compte le fait d’avoir donné naissance et élevé des enfants, c’est-à-dire d’avoir pris en charge leur éducation pendant au moins neuf ans avant l’âge de seize ans. Le régime général précise que dans ce cadre, la prise en charge comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apporté à l’enfant (Nicolas et Chaslot-Robinet Reference Nicolas and Chaslot-Robinet2012).
L’introduction d’un dispositif similaire en Allemagne a pour but explicite de réduire les inégalités de genre par une validation de l’investissement parental (Berghahn Reference Berghahn2004). Pour chaque enfant né après le 1er janvier 1992, une période de deux ans est allouée sur le compte d’un des deux parents, quel qu’ait été son investissement effectif dans les activités parentales. Les parents doivent s’accorder sur qui, de la mère ou du père, bénéficie de cette mesure. Cette bonification est favorable aux femmes ayant de bas salaires. La bonification est allouée sans condition d’interruption d’activité professionnelle, étant liée au fait d’avoir eu des enfants. Le désavantage subi par les parents d’enfants nés avant 1992 a été partiellement comblé par la réforme de la « retraite des mères » (Mütterrente) de 2014 qui prévoit qu’à partir du 1er juillet 2014, toute mère (ou tout père) a droit à deux années pour chaque naissance (au lieu d’une seule année jusqu’alors) survenue avant 1992.
Les majorations de pension pour avoir élevé au moins trois enfants existent actuellement dans tous les régimes de retraite français à l’exception du régime des professions libérales. Lors de sa création en 1945, ce droit était justifié par la volonté d’encourager la natalité dans le contexte démographique d’après-guerre (Bac et coll. Reference Bac, Bridenne, Marc and Pucci2011).
Enfin, certains dispositifs, réservés aux mères, permettaient un départ anticipé à la retraite avant l’âge légal. En Allemagne, ce droit était alloué à toutes les femmes et pas seulement aux mères, tandis qu’en France, ce droit était jusqu’en 2013 réservé aux mères d’au moins trois enfants employées dans la fonction publique, avant d’être supprimé. En Italie, les réformes récentes du Gouvernement Monti comportent une clause baptisée « option femme » offrant à ces dernières la possibilité de partir plus tôt à la retraite, avec une pension calculée en fonction de leurs cotisations, même si un autre mode de calcul (mixte pro quota) leur est plus favorable. Bien que l’option soit désavantageuse du point de vue du montant de leur pension, de nombreuses femmes ont saisi cette opportunité afin de partir plus tôt à la retraite, dans un contexte d’allongement de cinq ans de la durée légale du départ, déjà en vigueur dans le secteur public, et prévu en 2018 pour les salariés du secteur privé. Les bénéficiaires de « l’option femme », qui n’étaient que quelques dizaines l’année qui a suivi l’adoption de la loi, étaient près de 9 000 en 2013.
3.2.2.3 Validation des périodes consacrées à l’éducation des enfants
La validation des périodes d’interruption, ou d’activité réduite, consacrées aux enfants prend la forme de périodes créditées au titre de l’éducation des enfants (Berückstichtigungszeiten) en Allemagne, de cotisations fictives pour congés parentaux (Contributi figurativi per congedo parentale) en Italie, d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) en France et, depuis 2013, de crédits de cotisations en Angleterre. Ces périodes créditées au titre de l’éducation des enfants confèrent des droits qui varient fortement selon les pays, en fonction de la durée d’interruption validée, du niveau de validation, et des conditions d’accès à ce droit. Ainsi, la durée d’interruption qui peut être validée est très courte en Italie (six à sept mois maximum par enfant) et plus longue en Allemagne (période qui s’étend du quatrième au dixième anniversaire de l’enfant) et en France (trois ans maximum par enfant pour un ou deux enfants, mais durée beaucoup plus longue pour trois enfants et plus). Le niveau de validation de ces périodes se fait sur la base du salaire minimum (SMIC) en France, de la rémunération antérieure en Italie, et en référence au salaire moyen en Allemagne. En outre, l’accès à ce droit est conditionné au retrait du marché du travail en Italie et en France, tandis qu’en Allemagne, les parents y ont accès qu’ils aient ou non interrompu leur activité professionnelle, ou s’ils ont une rémunération inférieure au salaire moyen, ce qui compense pour le travail à temps partiel lié aux enfants.
En France, la création de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP) en 1972 visait à limiter les effets des arrêts d’activité professionnelle liés à la charge d’enfants sur les retraites des parents ayant de faibles revenus. Le dispositif permet au parent allocataire de certaines prestations familiales qui a interrompu ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants d’être couvert par l’assurance vieillesse. L’objectif a évolué, consistant aujourd’hui à limiter les effets des interruptions d’activité professionnelle sur les retraites des parents. Aujourd’hui l’accès à l’AVPF est ouvert aux pères ou aux mères, en couple ou « isolés », allocataires de prestations familiales, ayant de faibles ressources, sans activité professionnelle ou avec une activité qui procure un revenu limité. Au total, sachant que le système de retraite repose sur des principes liés à l’activité professionnelle, on peut en inférer que l’AVPF permet une mise en équivalence entre travail professionnel et travail domestique et familial. Ce dispositif constitue de fait une reconnaissance de la contribution des mères, puis du parent qui interrompt son activité, à la collectivité. Il s’apparente à une rémunération de l’activité au foyer, comportant une allocation et des droits sociaux équivalents à ceux que procurerait un salaire.
En Suède, les prestations reçues de l’assurance maladie, de l’assurance parentale, de l’assurance chômage sont incluses dans les revenus qui servent au calcul de la pension. Les personnes peuvent faire valoir leurs droits à pension entre soixante-et-un et soixante-sept ans. Le système ne compense pas pour le travail à temps partiel, mais seulement pour les études et le service militaire (qui n’est plus obligatoire en Suède) et les parents d’enfants de moins de quatre ans en congé parental.
En Angleterre, la réforme des pensions de vieillesse de 2013 (Pensions Act) accorde un crédit de cotisations pour les bénéficiaires de l’allocation de soins à un proche (carer’s allowance), du crédit d’impôt alloué aux personnes à bas revenus (Working Tax Credit) et d’indemnités de maternité ou d’adoption (Statutory Maternity Pay; Statutory Adoption Pay) pour les périodes d’incapacité de travail et de chômage. Dans la retraite de base (Basic State Pension), les périodes non-contributives (années passées à la maison pour élever les enfants, ou soigner une personne malade ou handicapée) (Home Responsibilities Protection, HRP) sont déduites du nombre d’années requises pour une pension à taux plein. Pour les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite après le 5 avril 2010, les cotisations sont créditées pour les périodes de réception des allocations familiales (Child Benefit) pour un enfant de moins de douze ans.
3.2.3 Les droits conjugaux : droits dérivés et partage des droits
Deux dispositifs sont utilisés pour remédier à la faiblesse des droits propres des femmes et à la dépendance vis-à-vis du conjoint : la réversion et le partage des droits, désigné aussi sous le terme anglais « splitting ». L’introduction du « splitting » en Allemagne en 2001 est apparue comme une mesure originale et innovante au regard du système plus ancien de la réversion. Ce nouveau dispositif propose le choix entre un système de réversion et un partage égal des droits à la retraite acquis par les deux membres du couple au cours du mariage (Retensplitting). Lorsqu’un couple opte pour la solution du partage, les droits à pension acquis pendant la durée du mariage sont partagés au moment où le plus jeune des conjoints prend sa retraite ou atteint l’âge de soixante-cinq ans. Chacun reçoit alors une pension correspondant à ses droits acquis hors mariage et à la moitié des droits communs acquis pendant le mariage. Ces droits peuvent être partagés indépendamment de toute condition d’âge en cas de décès prématuré, mais à condition que le survivant totalise vingt-cinq années d’assurance. Les droits issus du partage sont des droits propres. À la différence de la réversion, ils ne dépendent d’aucune condition de ressource, et restent acquis si le titulaire se remarie. Les couples en union libre peuvent également opter pour ce système de partage des droits à pension. La logique patrimoniale qui sous-tend ce système de partage n’est que partiellement présente dans le système de la réversion. Sa mise en place répond à une évolution de la conception du mariage, cohérente avec la réforme allemande du droit matrimonial et du divorce de 1976 qui avait substitué une conception partenariale du mariage à une conception hiérarchique fondée sur le mari gagne-pain et sa femme au foyer.
Ce dispositif de partage des droits vise à rendre visible et à faire reconnaitre, au moins au moment de la retraite, le travail domestique effectué par la femme pendant la durée de la vie commune, en adéquation avec la conception partenariale du mariage largement admise dans la société allemande. Un autre argument en faveur de ce système est lié au maintien de la retraite en cas de remariage, alors que la réversion cesse ou diminue dans cette situation. Cet aspect peut satisfaire les tenants d’une conception individualisée des droits sociaux, en raison de la redistribution de la pension opérée au sein du couple. Pour autant, cette option reste peu diffusée, pour au moins deux raisons : la complexité de la procédure d’une part et, d’autre part, les désavantages induits pour deux types de cas, pour les femmes au foyer dont le mariage a été de courte durée et qui avaient acquis peu de droits propres et pour les hommes percevant des pensions d’un montant élevé avec une conjointe sans droits ou avec peu de droits propres (COR 2007).
Le partage des droits à la retraite se pratique aussi au Royaume-Uni et en Suède, selon une ampleur et des modalités variables. En cas de divorce, le partage est obligatoire, avec deux options possibles : le partage à égalité des droits acquis pendant la durée du mariage par les deux conjoints tel qu’il se pratique en Allemagne (y compris les pensions privées), et l’inclusion des droits à la retraite dans l’ensemble du patrimoine du ménage, à répartir ensuite entre les deux conjoints comme cela se pratique au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, depuis 1999, les juges doivent tenir compte des droits à pension lors du partage du patrimoine d’un couple au moment du divorce. Cette obligation s’applique aux droits concernant les retraites complémentaires, au titre du régime additionnel public (State second pension), des régimes de retraite professionnels ou des plans d’épargne retraite personnels. Depuis 2005, toutes les dispositions concernant les couples mariés sont étendues aux couples en union civile. Le partage des droits ne s’applique pas au régime de base. Celui-ci alloue des droits au conjoint au titre des cotisations versées par l’assuré pendant la durée du mariage. Le conjoint sans droits issus de son activité professionnelle a droit à une pension égale aux droits acquis par l’assuré. En cas de divorce, l’ex-conjoint conserve les droits acquis pendant le mariage grâce aux cotisations de l’assuré, auquel cas il n’y a pas lieu de partager les droits puisque chaque conjoint acquiert des droits au fur et à mesure du mariage au titre des cotisations versées par l’assuré. Ces droits acquis en tant que conjoint sont annulés en cas de remariage.
Le système suédois de retraites est public et obligatoire pour tous, fondé sur la contribution (18,5 pour cent des revenus sont versés au système) et calculé en fonction des revenus depuis l’âge de seize ans et tout au long de la vie active. Le nouveau système par capitalisation offre la possibilité de transférer une partie du capital acquis à un conjoint, mais pas les droits à pension. Ce système applique un barème de conversion du capital en pension qui est fonction de l’espérance de vie de la cohorte à laquelle appartient l’affilié, mais qui ignore le sexe. Le système actuel vise à réduire « les dépenses publiques destinées aux retraites, à accroître les incitations au travail et rendre le nouveau système plus actuariel et moins redistributif (Hort Reference Hort2014, 44). Les autres régimes obligatoires ne versent pas de pension de réversion.
En France, la compensation des inégalités économiques au moment de la retraite est fondée sur les droits dérivés (Bonnet et Hourriez Reference Bonnet and Hourriez2012). Ce principe ne s’applique qu’aux couples mariés. Les célibataires ou les couples non mariés n’acquièrent que des droits directs issus de leur activité professionnelle tandis que les personnes mariées ou divorcées acquièrent des droits directs auxquels peuvent s’ajouter des droits dérivés. Ainsi, pour une même cotisation, une personne mariée reçoit en moyenne un montant plus élevé de prestations qu’une personne non mariée. Ce principe va de pair avec un modèle familial hiérarchique traditionnel fondé sur une conception complémentaire des rôles masculins et féminins, qui contraste avec le modèle individualisé suédois. Le système compensatoire fondé sur la réversion est souvent critiqué pour son manque de neutralité au regard des choix de vie en couple. C’est en effet un système qui n’assure pas l’égalité de traitement entre célibataires et mariés.
En Italie, les pensions de retraite ont longtemps assumé une fonction d’assistance, en l’absence de filet de sécurité contre la pauvreté Footnote 7 . Ce n’est qu’en 1995 avec la grande réforme Dini qu’a été introduite la distinction entre prestations d’assistance et prestations d’assurance, au moins d’un point de vue budgétaire. Cette réforme a instauré une assistance aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dépourvues de moyens de subsistance. Mais en transformant la « pensione sociale » qui était une prestation individuelle en « assegno sociale » dont les conditions d’accès différent selon que les bénéficiaires vivent seules ou en couple, cette mesure réintroduit une forme de familialisation des droits.
Au final, le partage des droits à la retraite tel qu’il se pratique en Allemagne, conçu comme une modalité de répartition des droits à pension parmi les deux membres d’un couple, peut se concevoir comme un dispositif compensatoire alternatif à la réversion. Il peut aussi remplacer la réversion lors d’un divorce, étant une compensation entre des époux ayant des niveaux de revenu ou de droits différents.
3.2.4 La dimension sexuée des compensations dans les régimes de retraite
Ce rapide aperçu des compensations du temps consacré aux enfants et aux proches au moment de la retraite appelle quelques réflexions. En termes d’effets sur les écarts de pensions entre femmes et hommes, il est indéniable que l’effet est réel. En France, alors qu’une femme sur deux interrompt ou réduit sa carrière après une naissance, les dispositifs de compensation réduisent de neuf points les écarts de pension entre femmes et hommes (COR 2014). L’ouverture de certains dispositifs aux hommes, au nom du principe de non-discrimination, risque toutefois d’en limiter la portée en termes de capacité à réduire les inégalités économiques, notamment au moment de la retraite. En Allemagne, où les interruptions d’activité professionnelle des mères sont plus fréquentes qu’en France, et où les réductions de temps de travail sont aussi plus marquées, les effets sur les pensions des femmes sont plus sensibles. Les dispositifs compensatoires permettent de réduire les inégalités entre femmes et hommes jusqu’à un certain point. À la moindre durée de cotisation s’ajoute l’écart entre les cotisations en raison des écarts de salaire entre les hommes et les femmes et du travail à temps partiel très développé chez les femmes. En conséquence, le montant actuel des pensions de retraite est très inégal entre les femmes et les hommes. Les écarts de pension sont aussi très marqués au Royaume-Uni et en Italie mais nettement moins en Suède.
Les droits conjugaux ont évolué dans la plupart des pays, et notamment avec la diffusion du mécanisme de « splitting » en remplacement ou en alternative à la réversion. Leur adaptation aux évolutions des formes de vie familiale revêt deux aspects : une extension progressive mais encore limitée des droits aux couples non mariés, et une adaptation à l’exigence d’égalité entre les sexes.
Pour ce qui concerne les droits familiaux liés à l’investissement parental, la comparaison montre que ces dispositifs ne sont pas neutres au regard du genre. Premièrement, les compensations réduisent les inégalités économiques entre époux dans la mesure où les effets des interruptions ou des réductions d’activité professionnelle sont compensés d’une manière ou d’une autre selon les divers types de mécanismes décrits plus haut (Bonnet et coll. Reference Bonnet, Chagny and Monperrus-Veroni2004). Mais d’un autre côté, les compensations peuvent accroître le risque d’iniquité entre conjoints lors d’un divorce dans la mesure où l’existence même de ces compensations peut inciter l’un des conjoints, en général la femme, à interrompre ou réduire son activité professionnelle, avec des conséquences négatives en termes de difficultés à réintégrer le marché du travail après interruption ou après un divorce. Deuxièmement, l’ouverture de la plupart des dispositifs compensatoires aux deux parents, parfois à la suite de plaintes en discrimination devant les Cour de justice, et la possibilité pour les parents de choisir qui en bénéficie, sont de nature à rendre ces dispositifs plus égalitaires, et en particulier au moment du divorce. Toutefois, si la compensation n’a pas de lien explicite avec l’interruption, mais avec le fait d’avoir eu des enfants par exemple, et si elle bénéficie aux deux parents, le résultat en termes d’équité peut être limité. En revanche, si le dispositif de compensation est strictement liée à l’interruption, il peut avoir des effets inégalitaires dans la mesure où il peut inciter à interrompre ou réduire sa carrière professionnelle et ainsi réduire son employabilité, y compris à la suite d’un éventuel divorce.
Conclusion
La comparaison entre les cinq pays européens révèle de grandes différences au regard des dispositifs de compensation des inégalités entre femmes et hommes liées à l’investissement parental et familial. Elle montre que les dispositifs actuels sont le résultat d’une longue généalogie de réformes, et d’arbitrages entre des valeurs et des principes d’action qui dessinent les référentiels des politiques publiques. Le modèle de famille qui a servi de référence lors de la mise en place des systèmes de protection sociale a évolué. Le mariage n’est plus le mode exclusif de vie en couple, le divorce a considérablement augmenté, et le nombre de familles nombreuses a sensiblement diminué. En outre, un nombre croissant de femmes acquièrent des droits propres par leur activité professionnelle. Pour autant, la logique « familialiste » des systèmes de protection sociale hors pays nordiques perdure au-delà des évolutions constatées, ce qui entrave l’avènement d’un modèle de protection plus égalitaire.
En effet, le modèle familial de « monsieur Gagnepain » et de sa femme au foyer qui a servi de référence à la construction du système de retraites est devenu plus ou moins obsolète dans la plupart des pays étudiés ici, bien qu’à des degrés divers. De fait, les femmes sont de moins en moins dépendantes de leur conjoint pour l’acquisition de droits sociaux qu’elles obtiennent par leur travail. Leur statut social « d’ayant droit » tend ainsi à s’estomper. Toutefois, si ce modèle a évolué pour intégrer des dispositifs prenant en compte la spécificité de la carrière professionnelle des femmes, le référentiel perdure au-delà des dispositifs correctifs des inégalités entre femmes et hommes.
Les droits familiaux comme les droits conjugaux doivent être réinterrogés eu égard aux principes sur lesquels ils sont fondés, car parmi les objectifs initiaux, certains sont devenus obsolètes. Encourager la fécondité ou compenser un éventuel déficit d’épargne des familles nombreuses n’est plus aujourd’hui à l’ordre du jour, laissant progressivement place à un double objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et « d’investissement social » dans les enfants, dans la ligne de la stratégie européenne. Ce recentrage des référentiels des politiques publiques et notamment familiales, offre de nouvelles perspectives de réflexion.