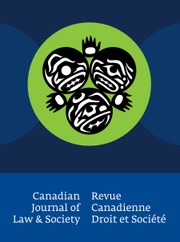Au cours de ces dernières décennies, les pays industrialisés ont été le théâtre d’une évolution très forte des relations familiales, caractérisée par l’affirmation de l’égalité formelle entre les membres du couple comme entre les enfants, l’émergence d’une pluralité de modèles familiaux et la multiplication des séparations. Ce mouvement s’est accompagné d’une évolution de la conception du mariage, plus égalitaire, et d’une libéralisation du divorce, plus facile d’accès. Parallèlement, les marchés du travail ont été marqués par la progression du travail féminin, induisant une indépendance financière croissante des femmes vivant en couple. Dans un tel contexte, on peut s’étonner que le principe de transferts privés entre époux lors du divorce n’a pas pour autant disparu. Ainsi, dans la plupart des pays, il existe toujours des mécanismes juridiques, à l’origine réservés aux couples mariés, permettant de transférer une somme d’argent d’un conjoint à l’autre à l’occasion de la séparation.
C’est à cet apparent paradoxe que s’attache ce numéro spécial, qui réunit des contributions émanant de juristes, de politistes, d’économistes et de sociologues Footnote 1 . En effet, la question centrale que posent, directement ou indirectement, ces contributions est celle des justifications d’un tel type de transfert.
De la lecture croisée de l’ensemble de ces contributions, qui concernent principalement les pays européens, on dégage trois types de justifications. En premier lieu, le versement d’un transfert entre ex-époux peut reposer sur une logique alimentaire. Il s’agit de pourvoir à la situation de besoin éprouvée par l’un des époux à la suite de la dissolution du mariage, et ce besoin servira de base à la mesure du transfert à réaliser. Dans ce modèle, la solidarité entre les époux, prévue par la loi entre les membres d’un couple historiquement indissoluble, est perpétuée au-delà de la rupture.
En second lieu, le versement peut reposer sur une logique compensatoire. Il s’agit alors de compenser, en partie seulement, la perte de niveau de vie subie par l’un des époux du fait du divorce et, ce faisant, de réduire la disparité de niveau de vie observée entre les deux ex-époux. C’est alors la disparité qui sert de base à la mesure du transfert à réaliser. Dans ce modèle, l’obligation de compenser peut encore être fondée sur les droits et obligations traditionnellement attachés au mariage, au nom d’une solidarité qui s’exprime au moment de la rupture.
Enfin, en troisième lieu, le versement peut s’appuyer sur une logique indemnitaire. La spécialisation d’un époux dans la sphère domestique durant le mariage peut conduire à la dégradation de sa valeur sur le plan du capital humain marchand. Le divorce concrétise ce dommage, qui se manifeste par la perte de capacité de gains; cette perte servira de base à la mesure du transfert à réaliser. Dans ce modèle, ce n’est plus le mariage qui constitue l’essentiel de la justification du transfert mais les conséquences économiques de l’investissement domestique.
La dénomination retenue pour chacune de ces logiques correspond à la nature de la justification du transfert entre ex-époux lors du divorce. Cette dénomination a donc été pensée « hors-sol », indépendamment des désignations données dans chaque pays à ce type de transfert.
En effet, d’un pays à l’autre, ce transfert peut porter des dénominations légales différentes. Ainsi, dans de nombreux pays en Europe, comme au Québec, le terme « pension alimentaire » est utilisé pour désigner ce transfert. Cependant, en France et en Espagne, son équivalent fonctionnel est qualifié de « prestation compensatoire ». Ces différentes désignations renvoient apparemment à des logiques différentes, sans pour autant que les législations correspondantes aient effectivement opté pour telle ou telle logique, comme le montrera ce numéro spécial. Selon les contributions à ce numéro, la terminologie retenue par les auteurs pour désigner ce transfert pourra donc porter des noms différents, selon le contexte national ou international de l’étude : « pension alimentaire entre ex-époux », « prestation compensatoire », « prestation », sans pour autant préjuger de la ou des logiques sous-jacentes à ce transfert.
La contribution de Dandoy et al. construit une analyse comparée de neuf législations européennes (Suède, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Suisse, Royaume-Uni) en matière de transfert à la lumière des trois principes de justification énoncés. Plus précisément, les auteurs élaborent une grille d’analyse composée de trois modèles. Chaque modèle est associé à l’une des trois justifications énoncées (le principe compensatoire étant appelé ici « assurantiel ») et se décline par rapport à quatre ensembles de critères légaux relatifs aux périodes prises en considération, aux conditions d’accès, à l’évaluation du montant et au régime juridique de la prestation. Ce faisant Dandoy et al. font émerger les objectifs implicites portés par le droit dans les différents pays étudiés. Ainsi l’Allemagne et les Pays-Bas seraient sur une logique purement alimentaire, le Portugal et la Suède articuleraient une logique alimentaire et une logique indemnitaire, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne combineraient plutôt une double logique assurantielle et indemnitaire.
Sur la base d’un matériau différent, en l’occurrence les débats parlementaires et les écrits des juristes suscités par la loi de 1975 introduisant, en France, le principe d’une prestation compensatoire et ses réformes successives, Sayn et Bouabdallah mettent en évidence le fait que les fondements de la prestation compensatoire ne sont pas clairement identifiés. En effet, alors que la doctrine s’est manifestement désintéressée de la questions des fondements, le discours politique, étudié à travers les débats parlementaires, oscille depuis quarante ans entre les trois logiques énoncées, même s’il semblerait que depuis le début des années 2000, la logique indemnitaire occupe une place de plus en plus importante, quoique noyée au sein d’autres justifications.
Si, du côté des juristes européens, la réflexion sur la justification des dispositifs juridiques prévoyant des transferts entre ex-époux lors du divorce est relativement peu développée, en revanche, on trouve du côté des travaux des économistes des arguments, empiriques comme théoriques, pouvant légitimer l’existence de ce type de dispositifs. Ainsi la contribution de Garbinti et al., qui s’appuie sur une revue de la littérature internationale, aboutit à deux conclusions fondant empiriquement la pertinence d’un transfert entre époux lors du divorce. D’une part, ils constatent que l’inégalité des niveaux de vie entre époux est bien réelle statistiquement, les femmes perdant en moyenne plus que les hommes au moment du divorce; l’existence d’un transfert à visée compensatoire se trouve donc pleinement justifiée. D’autre part, ils montrent que la maternité pénalise économiquement les femmes, justifiant alors un transfert à visée indemnitaire. Si l’on retient cette forme de justification, il n’y a pas de raison alors de réserver ce transfert aux seules mères mariées, la pénalisation concernant l’ensemble des mères.
La contribution de Doriat-Duban et Bourreau-Dubois rappelle pour sa part que l’analyse économique fournit des arguments théoriques pour justifier l’existence d’un transfert entre ex-époux lors du divorce, dans une perspective indemnitaire essentiellement. Les auteurs montrent qu’un tel transfert incite en effet, ex-ante, à des choix de spécialisation considérés comme optimaux et qu’elle protège ex-post la partie faible, c’est-à-dire celle qui a réalisé des investissements spécifiques pendant le mariage, au moment de la négociation autour du partage des biens du couple. Les mêmes auteurs soulignent que si les juristes anglo-saxons ont, dès les années 1990, mobilisé ce type d’analyse pour éclairer le fonctionnement du droit, cela n’a pas été le cas chez leurs homologues européens.
Les contributions précédentes mettent en évidence le manque de réflexion en Europe sur les justifications des dispositifs juridiques prévoyant des transferts entre ex-époux lors du divorce. On peut alors être étonné de constater que certains pays européens se sont pourtant dotés d’outils d’aide à la décision, plus ou moins élaborés, pour aider les juges et les praticiens à fixer les montants de ces transferts. En effet, la mise en œuvre d’outils nécessite, au moins implicitement, qu’un choix dans les finalités du dispositif soit effectué. Ainsi, dans sa contribution, Sayn montre que quatre des neuf pays étudiés par Dandoy et al. (cf. supra) sont dotés de lignes directrices ou de méthodes de calcul d’origine jurisprudentielle, juridictionnelle ou issues de praticiens (Suisse, Allemagne, Pays-Bas, France). L’analyse des paramètres mobilisés dans les onze méthodes repérées pour la France met en évidence que des composantes alimentaire, indemnitaire et compensatoire peuvent y être présentes simultanément, mais le plus souvent combinées de manière très variable, compromettant ce faisant la légitimité politique de ces règles. Cela étant, comme le montre la contribution de Le Bourdais et al. portant sur le Québec, quand bien même un pays se dote de lignes directrices, fondées sur une réflexion approfondie sur les objectifs assignés aux transferts entre ex-époux lors du divorce, cela ne garantit pas leur usage par les praticiens. En effet, l’étude menée sur des décisions prises en matière de pension alimentaire pour époux entre 2008 et 2013 met au jour des écarts relativement importants entre les montants fixés par les tribunaux québécois et les montants qui seraient issus de l’application fidèle des lignes directrices.
Les deux dernières contributions de ce numéro spécial permettent d’élargir les discussions sur des questionnements complémentaires à ceux développés par les contributions antérieures. Comme on l’a rappelé en introduction, les modèles familiaux ont évolué au cours des dernières décennies, avec notamment le développement des unions pérennes hors mariage et, plus récemment, la reconnaissance juridique des couples homosexuels (contrat civil ou mariage). Ces nouvelles situations familiales doivent conduire à s’interroger sur le périmètre actuel des transferts privés réalisés lors des ruptures d’union, encore réservés dans de nombreux pays aux seuls couples mariés et hétérosexuels jusqu’à très récemment.
Garbinti et al. et Bouabdallah et Sayn ont d’ailleurs évoqué dans leur contribution respective la légitimité qu’il y aurait à étendre ces transferts aux couples non mariés. Pour sa part, Bendall, en s’appuyant sur des entretiens réalisés auprès d’avocats et de leurs clients en Grande-Bretagne, examine la question de ces transferts dans le cas des dissolutions d’unions homosexuelles contractualisées. Selon Bendall, les avocats sont très soucieux, au nom d’un principe d’égalité de traitement, de répliquer dans le cas des dissolutions d’unions homosexuelles les raisonnements élaborés pour les couples hétérosexuels en cas d’inégalité économique lors de la séparation. En revanche, il s’avère que les clients homosexuels sont très réticents à se voir appliquer des constructions juridiques initialement construites pour régler les dissolutions des relations maritales hétérosexuelles.
Enfin, la contribution de Letablier et Dauphin met en perspective les transferts entre ex-époux lors du divorce, donc relevant du champ privé, avec les compensations relevant du champ public. En effet, la solidarité publique, par l’entremise de dispositifs de protection sociale, participe elle aussi à la réduction des inégalités économiques entre hommes et femmes dues à des investissements parentaux et domestiques différents. Comparant cinq pays européens (France, Royaume-Uni, Suède, Allemagne et Italie), ces deux auteures se centrent en particulier sur les congés parentaux et les droits à la retraite. Elles mettent en évidence que ces dispositifs peuvent, selon les cas, être pensés comme un renforcement du modèle de l’investissement domestique des femmes ou comme un dédommagement de cet investissement, dès lors qu’ils limitent le préjudice économique lié à cet investissement. Les conditions particulières d’accès à ces prestations sont alors essentielles pour déterminer s’il s’agit de promouvoir le retrait des mères du marché du travail ou de favoriser l’égalité des parents dans la prise en charge des enfants. On retrouve ainsi le débat qui a eu lieu autour des transferts économiques entre ex-époux lors du divorce, dont l’existence peut également être lue comme encourageant l’investissement domestique, parce qu’il en compense les conséquences économiques, ou comme corrigeant les conséquences d’un investissement inégalitaire.