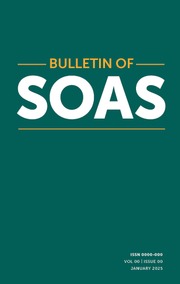Nelly Hanna nous a habitués à la parution, à intervalle régulier, de travaux toujours originaux. Dans ses recherches sur le monde urbain, elle s'est résolument tenue à l’écart de l'histoire du politique, pour s'intéresser avant tout aux gens ordinaires, à leur habitat, à leurs activités commerciales et artisanales, tout comme à leur culture.
Ce nouvel ouvrage n'est pas seulement une mise en perspective de thèmes abordés précédemment. C'est un projet beaucoup plus ambitieux qui vise à repenser l'histoire de l'Egypte durant les trois siècles déterminants qui ont précédé la pénétration européenne au XIXe siècle. Cette période d’émergence du monde moderne a connu une expansion sans précédent du commerce et un développement considérable des routes maritimes. Cet essai, organisé autour de quatre chapitres, traite des conséquences de ces mutations majeures. Il identifie un certain nombre de phénomènes économiques, sociaux et culturels, qui ont affecté de manière indépendante mais similaire aussi bien l'Europe que d'autres régions du monde. Il propose des approches nouvelles comme alternatives aux paradigmes du déclin et de l'eurocentrisme. L'objectif est de parvenir à une meilleure compréhension des dynamiques propres à l'Egypte et à l'ensemble de l'Empire ottoman et de mettre en lumière leurs contributions aux transformations globales qui ont donné naissance au monde moderne.
Dans un premier chapitre consacré au local et au global dans l'Egypte de 1600 à 1800, N.H. récuse l'idée d'une émergence exclusivement occidentale du monde moderne. Elle considère au contraire qu'il s'agit d'un processus complexe dans lequel bien d'autres régions que l'Europe, ont apporté leur contribution. Cette remise en question d'une historiographie de la modernité euro centrée n'est pas nouvelle. Des travaux portant surtout sur l'Inde, la Chine et l'Asie Sud Est ont sérieusement mis à mal ce concept né au XIXe siècle qui a longtemps été confondu avec occidentalisation. N.H. souligne que les recherches sur l'Egypte et l'Empire ottoman proposant des approches alternatives sont pour l'instant très rares. Elle invite les chercheurs à aborder l'histoire de ces régions, non pas comme celle d'un long déclin ayant précédé la domination coloniale, mais comme un moment répondant de dynamiques propres au sein d'un monde multi polaire non encore dominé par une Europe hégémonique.
Entre les Empires ottoman, safavide et moghol, on n'assistait pas seulement à des échanges croissants de marchandises, tout particulièrement de textiles. Idées et modes, artisans et techniques de production passaient aussi d'une région à l'autre. Mais ces aspects restent largement méconnus et nécessiteraient des recherches approfondies, tout comme les transferts de savoir-faire et d'artisans depuis l'Empire ottoman vers l'Europe. Ce sont là des phénomènes encore largement passés sous silence.
Le chapitre suivant, intitulé “Seventeenth- and eighteenth-century texts : colloquial in language, scholarly in form”, explore un des traits marquants qui, dans diverses parties du globe, a contribué à l’émergence du monde moderne. En Inde, en Asie du Sud-Est ou encore en Europe, le domaine de l’écrit ne cessait de s’étendre. On délaissait les langues savantes à vocation universelle au profit de langues vernaculaires. A partir du XVIIe siècle, une évolution semblable peut être observée pour l'Egypte. Des gens ordinaires se mirent à écrire des choses ordinaires dans un arabe proche du dialectal. Dès lors, l'usage de l’écrit tendait à s’élargir au-delà du cercle restreint de l’élite dirigeante et des lettrés, sans remettre en question ni la place, ni le statut de l'arabe classique. Encore aujourd'hui, ce phénomène fait l'objet d'un préjugé négatif et passe pour le signe évident d'un déclin culturel généralisé. N.H. suggère au contraire d'aborder ces changements comme l'expression de mutations économiques, sociales et politiques, et de considérer la langue comme un élément du développement historique.
Dans le chapitre 3 consacré aux artisans et aux corporations des métiers textiles au XVIIIe siècle vus sous l'angle de l’économie mondiale, N.H. montre que ce secteur, très exposé aux transformations survenues au niveau global, avait su s'adapter et se transformer. L'Egypte s’était mise à produire des tissus bon marché en quantité pour les besoins nouveaux de populations modestes en Afrique, en Asie, en Europe et même dans les Antilles. Dès lors, ils entraient en concurrence avec ceux d'autres centres mondiaux, notamment l'Inde. Les artisans égyptiens surent s'adapter en intégrant des techniques nouvelles et en imitant les cotonnades indiennes. Les corporations dans les métiers du textile surent elles aussi adapter leurs pratiques et se montrer ouvertes aux changements.
Cette évolution est, à maints égards, similaire à celle qu'on peut observer ailleurs dans l'Empire ottoman, en Iran, en Inde, à Marseille. Leur interconnexion était largement assurée grâce aux textiles, selon des modalités encore très peu explorées jusqu’à présent. Ainsi les transferts d'artisans, mieux connus pour la période ultérieure de Mohamed Ali, cette fois en sens inverse à partir de l'Europe. Dès lors, il conviendrait de replacer ces arrivées d'ouvriers et d'ingénieurs européens pour l'industrialisation de l'Egypte, dans une continuité à explorer et non dans une rupture affirmée.
Le quatrième et dernier chapitre est consacré aux transferts technologiques depuis l'Empire ottoman vers la France au XVIIIe siècle. Il remet en question la circulation en sens unique des savoirs. A partir du début du XIXe siècle, un grand nombre d'innovations techniques et scientifiques furent diffusées à partir de l'Europe. Ce mouvement était accompagné d'un discours sur le progrès et le développement, de même que de considérations sur des sociétés supposées en retard. Ce type de propos ne laissait aucune place aux transferts en sens inverse. Cependant, de récentes études ont montré l'importance de l'intégration dans les sciences européennes de savoirs en provenance de l'Inde et de l'Asie du Sud Est. Pour l'instant, pratiquement aucune recherche similaire n'a été menée dans le cas de l'Empire ottoman.
En focalisant plus particulièrement sur la France, N.H. présente quelques exemples qui permettent de comprendre comment des savoirs non européens ont pu participer à la formation du monde moderne et comment des artisans orientaux ont pu contribuer au développement des sciences et des technologies modernes. Avant la révolution industrielle, les Français étaient à la recherche de savoir-faire pour l'amélioration de leurs techniques, notamment le blanchiment des toiles et l'application de certaines teintures sur les cotonnades. Aussi manifestaient-ils un très vif intérêt pour les savoir-faire des tisserands orientaux. Par des canaux multiples (négociants, fabricants, consuls, prêtres, scientifiques), ils collectèrent d'innombrables descriptions de techniques artisanales. Cependant, la mise en application dans les ateliers français de ces savoir-faire orientaux se heurtait à de multiples difficultés. Il aura ainsi fallu près d'un siècle pour maîtriser la production de sel ammoniac, alors quasi-monopole égyptien.
De tels constats remettent fondamentalement en question l'idée d'un déclin de l'artisanat en Orient avant le XIXe siècle, tout comme les théories de centres développés, diffuseurs de savoirs, et de zones périphériques fournissant des matières premières et disposant d'une main d’œuvre illettrée non qualifiée. A partir de quelques exemples d'adaptation de méthodes traditionnelles dans des pratiques scientifiques modernes, N.H. élargit le débat à la nature même des savoirs, aux interactions entre artisans et savants, à l'empirique et au théorique, au local et à l'universel.
Ce bref compte rendu ne peut fournir qu'un aperçu très sommaire de cet essai très dense et très solidement argumenté. Il ne concerne pas seulement les spécialistes de l'Egypte moderne ou de l'Empire ottoman, mais aussi ceux qui s'interrogent sur les fondements mêmes de notre monde moderne globalisé et connecté.