1 INTRODUCTION
Au Québec, protéger son héritage francophone et affirmer son identité culturelle en s’érigeant contre la toute-puissance anglo-américaine est une réalité quotidienne tant l'influence de l'anglais est grande. De par la situation géographique de la seule province francophone du Canada, la pérennité de l'unilinguisme québécois tel que voulu par la Charte de la langue française (1977)Footnote 1 est loin d’être assurée. Que ce soit du fait des anglophones québécois (voir la Charte canadienne des droits et libertés Footnote 2 de 1982), du positionnement idéologique de certains élus politiquesFootnote 3 ou simplement de la jeune génération,Footnote 4 les occasions ne manquent pas pour que l'anglais redore son blason et dissémine çà et là ses mots et expressions shakespeariens.
Si l'on en croit le dernier recensement effectué par Statistiques Canada en 2011, 42,6% de la population québécoise se déclare bilingue. La catégorie des 20–44 ans francophones atteint même les 54% et celle des 20–44 ans anglophones avoisine les 77%, soit à peu près 45% des personnes bilingues anglais-français de naissance du Canada. Si, comme Darbelnet (Reference Darbelnet1986: 199) a pu le déclarer, ‘lorsque les situations bilingues se multiplient, les emprunts linguistiques se généralisent’, il est fort à parier que la langue utilisée par ces personnes se définissant comme bilingues ne sera pas exempte d'emprunts, conséquences de cette situation de diglossie. (Nous soulignons)
Le présent article s'interroge sur l'effet du degré de bilinguisme de milieu sur l'anglicisation de la presse écrite au Québec et en Outaouais, notamment dans l'utilisation d'emprunts lexicaux intégraux et hybrides. Nous présentons ici une analyse lexicométrique des anglicismes dans un corpus de presse constitué d'une année entière de publications de trois journaux francophones québécois et outaouais. Nous cherchons à savoir si la combinaison de plusieurs principes (‘effet de voisinage’, géolinguistique de l'emprunt et proximité éditoriale) est la plus à même de décrire la situation actuelle d'utilisation d'emprunts à l'anglais dans la presse écrite québécoise ou si au contraire, dans une optique de survie de la langue, la province du Québec présente une réalité linguistique interne aussi hétérogène que celle que l'on pourrait obtenir en la comparant par exemple avec la France métropolitaine.
Nous expliquerons, dans une première section, le contexte très spécifique de la province et nous nous arrêterons sur certains aspects de son histoire en lien avec la définition des termes-clé de cette étude. Nous aborderons ensuite brièvement la place des anglicismes dans la recherche, puis plus particulièrement le lien entre anglicismes et recherches de corpus et présenterons enfin les pistes offertes par quelques études précédentes. Cet article se propose d’étudier si l'emploi des anglicismes dans la presse écrite est comparable, selon le niveau auto-déclaré de bilinguisme de milieu et le lieu de publication (Québec, Montréal ou Ottawa-Gatineau) en étudiant la fréquence d'utilisation des emprunts à l'anglais dans les publications sur une année de trois journaux francophones, à forte implantation locale.
2 CONTEXTE ET DÉFINITIONS
2.1 L'anglicisme
Parler d’anglicisme au Québec peut s'avérer délicat tant le terme en lui-même est connoté négativement. C'est pour cela que les linguistes lui préfèrent le terme d’emprunt à l'anglais, qui a pour avantage de se défaire de toute notion de ‘bon’ ou ‘mauvais usage’. Parler d'anglicisme au Québec ne revient en effet pas seulement à aborder l'aspect linguistique de la chose, mais implique inéluctablement une plongée dans l'histoire d'une culture qui s'est formée dans l'adversité, se battant pour survivre et pour se voir reconnaître (voir Rioux, Reference Rioux1969). Au Québec, tout le monde a un avis sur la question tant le sujet des anglicismes fait partie des mœurs, et cette grande diversité d'opinions se retrouve naturellement au sein des universitaires travaillant dans ce domaine. L'histoire de ce terme, ‒ apparu pour la première fois en France dans la traduction française d’Eikonoklates de Milton par Du Gard en 1652 et défini en anglais dans la partie anglais-français du Great French Dictionary de Guy Mièges (1687) comme ‘an expression proper to the English’, puis en français comme « façon de parler angloise » dans le Dictionnaire universel françois et latin (connu sous le nom de Trévoux) en 1704 ‒, est ponctuée de positionnements idéologiques, de batailles linguistiques et de débats politiques. Détracteurs et partisans se délectent du sujet depuis des siècles, définissant et redéfinissant le concept selon leur propre point de vue idéologique, leur angle d'approche (linguistique, sociologique, politique, éducatif. . .) ou leurs objectifs.
Tour à tour qualifié de ‘forme fautive’ par de Villers dans son Multidictionnaire de la langue française (2009), de ‘trace du rapport de pouvoir qui existe entre le français et l'anglais’ (Deshaies, Reference Deshaies1984), ou encore de terme ‘critiqué comme abusif ou inutile’ (Rey-Debove et Rey, Reference Rey-Debove and Rey1993), il est même considéré par certains comme une ‘menace’ (Hagège, Reference Hagège2006: 8) voire un ‘ennemi’ (Tardivel, Reference Tardivel1880). L'anglicisme ne semble donc pas pouvoir se défaire de cette connotation négative qui lui colle à la peau. Lamontagne (Reference Lamontagne1996: 14) remarque d'ailleurs que dès son apparition dans la lexicographie québécoise – laquelle remonte à 1841 et au Manuel des difficultés de la langue française de l'Abbé Maguire (Reference Maguire1841) – on lui associe d'emblée un sens péjoratif en réservant son utilisation « aux emprunts critiqués » (voir par exemple l’étude de Courbon et Paquet-Gauthier, Reference Courbon and Paquet-Gauthier2014). Cependant, notre objectif n'est pas ici de débattre sur la recevabilité ou non du terme emprunté, bien au contraire. Nous utiliserons donc anglicisme au même titre que nous utiliserons emprunt à l'anglais et lui accolerons la définition de l'emprunt lexical donnée par Loubier (Reference Loubier2011). Notre anglicisme ‘correspond à un emprunt intégral (forme et sens) ou partiel (forme ou sens seulement) d'une unité lexicale étrangère’, − ici l'anglais −, et prend tout particulièrement la forme de l’emprunt intégral qui désigne l’ ‘emprunt de la forme et du sens, sans adaptation ou avec une adaptation graphique ou phonologique minimale’ (‘staff’, ‘lobby’, ‘artéfact’) ou de l’emprunt hybride ‘qui est un emprunt de sens, mais dont la forme est partiellement empruntée’ (‘dopage’, ‘coach’) (Loubier, Reference Loubier2011:14).
2.2 L'anglicisation
Qu'entend-on maintenant par anglicisation ? Une fois encore, le terme est fortement connoté par l'histoire de la province. Au lendemain de la rupture avec la France en 1763, la fraîchement renommée province de Québec passe sous administration de l’‘ennemi’ anglais et entame alors une relation des plus ambivalentes avec la langue anglaise. Alors que l’élite bourgeoise et éduquée se partage entre anglomanie à tout va et idéologie de conservation (Corbeil, Reference Corbeil1976 : 9), la classe ouvrière qui naît avec l'industrialisation du pays est frappée de plein fouet par la domination de l'anglais comme langue de travail. Le Québec s'anglicise alors peu à peu, enrichissant son vocabulaire de mots anglais empruntés par nécessité, faute d’équivalents français et faute d'une élite bienveillante qui, par son attitude méprisante envers la population ouvrière, creuse l’écart entre Québécois instruits et Québécois travailleurs. Ce phénomène d'anglicisation s'accentue davantage jusqu’à la montée du purisme linguistique et de la Révolution tranquille (1960–1962) durant laquelle les Québécois reprennent possession de leur culture et de leur futur, décidant alors que la voie à suivre sera celle du ‘dépassement’ (Corbeil, Reference Corbeil1976: 13). Les résultats du Rapport Préliminaire de la « Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme » de 1965 entraînent un refus en bloc de l'anglais et du bilinguisme chez les francophones qui les perçoivent désormais comme une menace (Molinari, Reference Molinari2008). La promulgation de la Loi 101 en 1977 marque le début d'une ‘refrancisation’ du Québec en donnant une priorité quasi absolue à la langue française dans le domaine public. Parler d'anglicisation dans un Québec contemporain renvoie donc inévitablement à ce passé linguistique douloureux, où culture et économie ne faisaient pas bon ménage. Parler d'une anglicisation aujourd'hui équivaudrait en fait à parler d'une ré-anglicisation, ce qui impliquerait alors un retour en arrière, un nouveau déséquilibre entre anglais et français au Québec, et ce malgré les politiques linguistiques en place. Cependant, cette étude n'ayant aucune visée de jugement, nous rejoindrons le postulat de Mareschal selon lequel anglicisation ‘ne comport[e] pas de coloration morale comme certains autres termes’ (Mareschal, 1989: 4) et entendrons donc ce terme comme le simple phénomène d'utilisation de mots anglais qui ont été catégorisés comme anglicismes dans le Multidictionnaire de de Villers (2009).
2.3 Le bilinguisme
Pour certains,Footnote 5 le bilinguisme, de par sa biculturalité, représente un danger pour le Québec car la seule manière de protéger efficacement la culture française, à leurs yeux, est de donner la priorité absolue à l'unilinguisme. Notre idée d'associer bilinguisme et anglicismes n'est pas nouvelle car Darbelnet se posait déjà la question en Reference Darbelnet1965, faisant le lien entre les deux concepts, et cherchait des solutions à l'anglicisation rampante du français de Québec. D'un point de vue linguistique, le bilinguisme est très difficile à évaluer, et ce ‘faute de critères objectifs et qualitatifs permettant de le définir’ (Gadet et Varro, Reference Gadet and Varro2006) ou de ‘standards’ (Adler, Reference Adler1977: 10). De ce fait, établir un seuil à partir duquel un locuteur pourrait être déclaré bilingue s'avère impossible tant les opinions s'opposent sur le sujet (voir par ex. Weinreich, Reference Weinreich1953; Haugen, Reference Haugen1956; Fishman, Reference Fishman1968; Mackey, Reference Mackey1976; Kremnitz, Reference Kremnitz1981; Cummins, Reference Cummins1984; Hamers et Blanc, Reference Hamers and Blanc2000; Baker, Reference Baker2011). Nous avons donc choisi de ne pas étudier le phénomène du bilinguisme en tant que tel mais plutôt de l'utiliser comme un statut revendiqué par les locuteurs eux-mêmes. Il n'est donc pas question ici de traiter de bilinguisme effectif (adéquatement évalué), ni de bilinguisme individuel (ou bilingualité) mais plutôt d'une autoévaluation linguistique permettant de rendre compte de l'importance du phénomène de bilinguisme de milieu (qui équivaudrait au ‘community bilingualism’ ou ‘group bilingualism’ d’Adler, Reference Adler1977: 9) de chaque ville à l’étude. Ce choix d'utiliser un bilinguisme de milieu auto-représenté plutôt que le bilinguisme effectif des journalistes repose sur le fait que, dans le monde de la presse écrite, « le lecteur sert de principe de légitimation [. . ., que] la perception de la position du journal dans l'espace journalistique [. . .] permet d'imposer une certaine écriture [. . . afin de faire] ‘proche des gens’ » (Hubé, Reference Hubé2007: 108). Même si ce sont effectivement les journalistes qui rédigent les articles et qui seraient donc les plus directement ‘responsables’ de l'utilisation d'anglicismes dans leurs écrits, ce sont en réalité les attentes du « lecteur incarné » (Hubé, Reference Hubé2007: 109) qui orientent les lignes éditoriales et donc le style à adopter. Ainsi, on peut s'attendre à ce qu'un journal dont le lectorat local se déclare bilingue de son propre chef ne soit pas hostile à l'usage de termes empruntés à l'anglais, peu importe le réel niveau de bilingualité, car les lecteurs se retrouveront certainement dans les situations diglossiques illustrées dans les articles.
Pour cette étude, nous comprendrons le terme bilinguisme tel qu'il est utilisé dans les rapports de recensement menés par Statistiques Canada et qui correspond à la catégorie « Langue » et à la définition « Connaissance des deux langues officielles – Anglais et français »Footnote 6 . Notre notion de bilinguisme de milieu est donc purement statistique et englobe toutes les déclarations individuelles de bilingualité pour une région donnée (ici Ottawa-Gatineau, Montréal et Québec).
3 L'ANGLICISME, LES CORPUS ET LA RECHERCHE
3.1 L'anglicisme en recherche
L'emprunt lexical, de par sa nature controversée et sa forte dimension socio-culturelle, fait l'objet d'une littérature très fournie, témoignant ainsi de l'engouement qu'il suscite depuis toujours auprès des chercheurs linguistes. Les premières études sur le sujet se sont principalement concentrées sur la description du phénomène et ont chacune tenté d'en proposer une définition. Les plus notables (Deroy, Reference Deroy1956; Rey, Reference Rey1970; Humbley, Reference Humbley1974a ; Guilbert, Reference Guilbert1975; Pergnier, Reference Pergnier1981 ; Spence, Reference Spence1987; Corbeil, Reference Corbeil and Martel1994 ; Picone, Reference Picone1996 ; Lamontagne, Reference Lamontagne1996 ; Walter, Reference Walter1997; Bouchard, Reference Bouchard1999, Reference Bouchard2002 ; Bogaards, Reference Bogaards2008; Haspelmath, Reference Haspelmath2009, Cajolet-Laganière et Martel, Reference Cajolet-Laganière and Martel2012 . . .) se sont engagées dans une approche soit purement linguistique, soit plus sociologique ou bien dans une démarche entièrement destinée à soutenir un projet politique.
Beaucoup d’études se sont également concentrées sur la création d'une typologie des emprunts (Humbley, Reference Humbley1974b ; Darbelnet, Reference Darbelnet1986 ; Walter, Reference Walter1988 ; Meney, Reference Meney1994 ; Sablayrolles, Reference Sablayrolles1996 ; Privat, Reference Privat1997) ouvrant ainsi la voie aux recherches axées sur un type d'emprunt en particulier. Les emprunts lexicaux intégraux et hybrides sont indéniablement l'un des objets d’étude les plus populaires (Darbelnet, Reference Darbelnet, Bédard and Maurais1983 ; Rey-Debove, Reference Rey-Debove1987 ; Humbley, Reference Humbley1990 ; Walter, Reference Walter1994; Klein et al., Reference Klein, Lienart and Ostyn1997), certainement à cause de leur graphie ‘étrangère’ très facilement repérable permettant une analyse quantitative à grande échelle. Cependant, les études portant, par exemple, sur la catégorie plus « insidieuse » (selon les puristes) des emprunts sémantiques (Colpron, Reference Colpron1970 ; Delisle, Reference Delisle, Pergnier and Seleskovitch1988 ; Nadasdi, Reference Nadasdi1991 ; Bernard, Reference Bernard2006 ; Courbon et Paquet-Gauthier, Reference Courbon and Paquet-Gauthier2014 ; Paquet-Gauthier, 2015) ne sont pas en reste, même si elles requièrent une approche forcément plus qualitative.
L'anglicisme est sans doute l'emprunt le plus polémique et de ce fait, l'instigateur de la recherche la plus prolifique. Peu importe la langue dans laquelle il s'invite, sa présence ne passe jamais inaperçue et donne inexorablement lieu à d'intenses débats. Les réactions à ce phénomène sont cependant bien plus négatives du côté de la francophonie que chez certains linguistes allemands qui n'hésitent pas à souligner par exemple que les emprunts servent avant tout à ‘enrichir le lexique’ d'une langue (Kovács, Reference Kovács2008) ou à en assurer la vitalité en stimulant constamment sa ‘capacité à assimiler de nouvelles influences lexicales venues de régions culturellement et linguistiquement différentes.’ (Onysko, Reference Onysko2007 : 322, notre traduction).
Dans un pays tel que le Canada par exemple, où l'anglais et le français se partagent le statut de langues officielles, les relations entre les deux langues sont loin d’être égalitaires. Selon le dernier rapport de recensement produit par Statistiques Canada en 2011, le taux de personnes de langue maternelle française se déclarant bilingues au Québec (c'est-à-dire ayant une connaissance des deux langues officielles) a augmenté de presque 2 points (36,08% à 36,3%) en 5 ans et le taux de personnes bilingues issues de la population de langue maternelle anglaise est passé de 70,6% en 2006 à 67,8% en 2011. Malgré les mesures assez drastiques de protection de la langue française mises en place dans la province, il semblerait que les Québécois francophones embrassent de plus en plus la langue de Shakespeare, alors que leurs voisins anglophones sont plus nombreux à ne vivre qu'en anglais au Québec en 2011 qu'ils ne l’étaient en 2006.
3.2 La recherche en corpus
Toutes ces données proviennent des rapports de recensement produits par Statistiques Canada et reposent sur la perception et le jugement personnels des personnes ayant rempli les questionnaires. La question est donc de savoir comment ces données se traduisent au quotidien et de pouvoir juger objectivement de leur pertinence. L'analyse de la fréquence d'utilisation de mots anglais, ou d'emprunts, semble être une solution particulièrement affectionnée par les chercheurs pour traduire ce phénomène d'anglicisation. En effet, plus une population emprunte des termes issus de langues étrangères au lieu de faire vivre son propre lexique, plus elle met en danger la pérennisation de sa langue. Bien que l'oral soit certainement le mode de communication le plus facile, il est aussi le plus naturel et est souvent sujet à un plus grand relâchement dans l'expression, entraînant assez communément des erreurs grammaticales, syntaxiques ou lexicales. Il est donc courant pour les chercheurs linguistes d'utiliser des corpus écrits afin de pouvoir travailler sur une langue à la fois mieux maîtrisée et plus recherchée. Certes les données relevées sont en général quantitativement moindres, mais leur importance n'en est que renforcée vu que cela signifie qu'elles ont réussi à résister aux différentes étapes de révision et correction qui vont normalement de pair avec la langue écrite. Le corpus de presse fournit donc, à notre avis, l'un des matériels les plus appropriés pour un chercheur spécialiste des anglicismes car il présente une langue de bonne qualité qui se veut en même temps le reflet de son lectorat.
Parmi les quelques études de corpus de presse québécois, l'on trouve très majoritairement des études comparatives entre Europe et Québec. L’étude de Mareschal (Reference Mareschal1989,Reference Mareschal1992,Reference Mareschal1994) est en ce sens incontournable car elle pose les premières pierres de la recherche comparative de corpus. En opposant quatre journaux francophones et quatre catalogues de vente par correspondance (France-Soir et La Redoute pour la France, La Presse et Sears pour le Québec, Le Soir et Les Trois Suisses pour la Belgique et 24 heures et Jelmoli pour la Suisse), elle se lance dans une étude typologique très poussée dans laquelle elle s'attache à catégoriser chaque anglicisme relevé dans ces corpus (emprunt de forme et de sens, emprunts de sens, emprunts de forme, emprunts de modèle et ex-emprunts) avant de comparer les pratiques privilégiées par chaque pays. Martel et coll. (Reference Martel, Cajolet-Laganière and Langlois2001) ont de leur côté cherché à comparer un corpus formé de quotidiens français et belges à un corpus de presse écrite québécoise afin de déterminer quels étaient les anglicismes les plus polémiques. De Villers (Reference De Villers, Raymond and Lafrance2001) présente l'analyse comparative d'un corpus québécois regroupant tous les articles publiés en 1997 par les journaux Le Devoir et Le Monde. Elle s'intéresse à la fois aux emprunts, aux différentes conditions d'emploi des québécismes, aux néologismes, aux registres de langue et aux formes féminines. Cardinal et coll. (Reference Cardinal, Melançon, Hébert and Laviolette-Chartrand2009) ont consulté près d'une quarantaine de sources différentes, québécoises et européennes, majoritairement issues de la presse écrite entre 1980 et 2008, pour réaliser leur VocabulAIDE, un dictionnaire basé sur une approche descriptive, une ‘méthode didactique « douce »’ dont l'objectif est d’ ‘informer et former sans culpabiliser’ (p. xii). Dans cet ouvrage dédié à ‘l’étude des influences de l'anglais en français canadien’ (p. xxi), les auteurs ont souhaité restreindre l'utilisation du terme « anglicisme » avançant qu'il était bien trop négativement connoté. Ayant également ciblé la désinformation et l‘enrichissement du lexique comme principaux objectifs, les auteurs se sont efforcés de décrire qualitativement et en contexte plus d'un millier de termes répartis en 750 articles, en accompagnant chaque entrée de notes explicatives et comparatives afin d’‘aider les locuteurs et les locutrices à enrichir, diversifier et nuancer leur vocabulaire’ (p. xii). Molinari (Reference Molinari2008) s'est intéressée aux recommandations officielles de l'OQLF en analysant différents néologismes ou termes relevés dans le Grand dictionnaire terminologique, les Capsules linguistiques ou la Banque de dépannage linguistique. Elle soulève l'intéressante hypothèse selon laquelle l'anglais pourrait en fait servir de ‘passerelle favorisant l'amélioration de la qualité de la langue française au Québec’ (Molinari, Reference Molinari2008: 103) vu l'attention et les efforts constants consacrés à son élimination. Elle s'interroge également sur la portée de l'action de l'OQLF, sur l'image que se font les Québécois de sa mission et de façon plus générale, sur leur rapport avec l'anglais, sans oublier bien sûr l’éternelle question d'une norme pour le français québécois. Enfin, Chaput (Reference Chaput, Burger, Jacquin and Micheli2009) a étudié la variation linguistique dans des blogues de journalistes québécois et français et a cherché à classer les différents anglicismes utilisés dans des chroniques et billets traitant de politique et de culture selon leur fréquence d'utilisation et les catégories (connotation, style, titre) auxquelles ils appartenaient.
Tous concluent à peu près sur la même idée, à savoir que la présence d'anglicismes dans la presse écrite reste très surestimée mais qu'il serait préférable que les journalistes les évitent afin de garantir une langue de meilleure qualité (Martel et coll. Reference Martel, Cajolet-Laganière and Langlois2001). De Villers (Reference De Villers, Raymond and Lafrance2001: 42) précise même que ‘la langue de la presse écrite constitue l'expression vivante et, par définition, ancrée dans l'actualité, d'une partie des usages linguistiques de la communauté à laquelle les titres de presse sont destinés’ ; alors que Chaput clôt son article en déclarant que le ‘choix des stratégies discursives varie en fonction du lieu d'origine du blogueur et du thème abordé parce qu'il est certainement lié aux attitudes linguistiques propres à chaque culture.’ (Chaput, Reference Chaput, Burger, Jacquin and Micheli2009: 12)
3.3 L'effet de voisinage
Cette idée du lieu d'origine du journaliste a une grande importance dans l'analyse fréquentielle des anglicismes dans un corpus de presse. La géolinguistique est un sujet très prisé au Canada tant l'histoire des deux cultures a été féconde en transferts et échanges culturels. Cependant, une très grande majorité des études existantes ne se concentrent que sur un seul endroit à la fois, notamment dès lors qu'elles font appel au corpus. Landry (Reference Landry1973) s'est par exemple intéressée aux emprunts propres à la région de Moncton alors que Lavoie (Reference Lavoie1994 et Reference Lavoie, Gauthier and Lavoie1995) s'est penché sur les milieux ruraux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et s'est ensuite associé à Verreault (Verreault et Lavoie, Reference Verreault and Lavoie2000) pour analyser la région de l'Est du Canada. Thomas (Reference Thomas2013) s'est arrêté sur l'Ontario alors que Rodriguez (Reference Rodriguez1993) s'est orientée vers le Manitoba et Charland (Reference Charland2001) vers les Bois-Francs (Centre-du-Québec)
Dès qu'il y a multiplication des contextes bilingues, le recours aux emprunts linguistiques tend à se populariser (Darbelnet, Reference Darbelnet1986). Pourtant, bien que cette relation entre les deux phénomènes – bilinguisme et anglicisation – semble assez logique, il n'existe que très peu d’études qui se soient arrêtées sur le sujet. On peut cependant noter Bouchard (Reference Bouchard1989) qui expose que ‘la fréquence [des] contacts variables avec l'anglais selon qu'on se trouve à Montréal, dans les autres villes du Québec, à la campagne ou dans les autres provinces du Canada, explique pour de nombreux auteurs le degré plus ou moins grand d'anglicisation des populations’ (1989: 73) avant de faire remarquer qu’‘il est assez rare qu'on soulève le rôle du bilinguisme individuel dans l'anglicisation du français’ (1989: 76). Pour elle, il est évident que l'environnement linguistique dans lequel une personne évolue a une incidence sur sa façon de s'exprimer, peut-être même plus que ses capacités bilingues personnelles. Poplack (Reference Poplack1989) semble d'ailleurs partager cet avis car elle affirme que ‘s'il y a bel et bien un effet du niveau de bilinguisme, celui-ci est secondaire par rapport à l'influence du milieu linguistique de l'individu.’ (1989: 148) Le degré de bilinguisme de milieu aurait donc une plus grande influence sur les habitudes linguistiques des personnes que le niveau de bilinguisme personnel, et ce à cause de l’ ‘effet de voisinage’, qu'elle définit comme étant la ‘diffusion de traits linguistiques du parler d'un centre prestigieux aux régions voisines.’ (1989: 128)
4 NOS DEUX APPROCHES
Si l'on suit ce raisonnement, l'on peut donc imaginer que les résidents de Montréal, de Québec et de Gatineau, par exemple, n'utiliseront pas tout à fait le même langage, étant donné que l'effet de voisinage sera plus ou moins puissant selon qu'ils habitent près de la capitale du Canada qui est officiellement bilingue,Footnote 7 près de la métropole économique et multiculturelle du Québec ou près de la capitale provinciale. Le cas de la région Ottawa-Gatineau est relativement populaire, notamment chez les chercheurs statisticiens comme Castonguay qui lui a consacré de nombreuses publications (Reference Castonguay and Marion1974, Reference Castonguay1979, Reference Castonguay1997, Reference Castonguay2002a, Reference Castonguay2002b, Reference Castonguay2005). En effet, la situation linguistique de la région outaouaise est très particulière. Métaphoriquement parlant, en plus d’être une frontière naturelle traversant la région de la capitale nationale, la rivière des Outaouais, symbolise une sorte de portail culturel, séparant les anglophones des quartiers francophones (Hull, Vanier. . .) mais incitant en même temps à un contact constant grâce à ses nombreux ponts. Castonguay (Reference Castonguay1997) a choisi de s'intéresser à Montréal et à Gatineau car ce sont les deux régions où la population anglophone est la plus importante au Québec et la plus stable. Utilisant les données de Statistiques Canada, il en conclut que les francophones sont bien plus prompts à s'angliciser que leurs concitoyens anglophones ne se francisent. Ces deux régions avaient d'ailleurs déjà été désignées comme étant des ‘régions anglicisantes’ par Maheu (Reference Maheu1978: 119) car leurs résidents francophones ‘subissent des transferts linguistiques négatifs’ (Reference Maheu1978: 119) et présentent donc un intérêt particulier pour les chercheurs.
Ringoot et Rochard (Reference Ringoot and Rochard2005: 73) définissent la ‘proximité éditoriale comme étant ‘l'ensemble des mécanismes discursifs créant de la proximité entre le journal et son lecteur’. Si l'on considère que ‘la proximité, en journalisme, est érigée en loi’ (2005: 73), que les journalistes se doivent d'adapter leurs codes narratifs à leurs différents lectorats cibles (Bamberger, Reference Bamberger2012), et que les Québécois, très attachés à leur langue vernaculaire, la considèrent comme faisant partie intégrante de leur identité culturelle (Chaput, Reference Chaput, Burger, Jacquin and Micheli2009), on peut assez logiquement s'attendre à ce que les journalistes n'utilisent pas tout à fait le même lexique selon la ville où ils travaillent. Et cela afin de refléter ‘l'accent local’ que leur lectorat souhaite retrouver en lisant leurs articles afin qu'il puisse s'y retrouver, s'identifier à la langue utilisée et aux faits relatés. Peu importe donc qu'ils soient personnellement bilingues ou non, l'essentiel est que les journalistes puissent utiliser une langue identique à celle de la population qu'il serve et qui a elle-même évalué son propre rapport avec l'anglais.
D'un autre côté, si l'on s'intéresse au fait que chaque étude s’étant arrêtée sur une comparaison entre Europe (France, Belgique, Suisse) et Québec a également conclu que l'on n'utilisait pas les mêmes anglicismes des deux côtés de l'Atlantique mais que les emprunts lexicaux étaient moins présents dans les journaux de la province canadienne (ce n'est par contre pas le cas pour les emprunts sémantiques comme le souligne Paquet-Gauthier, 2015), les principes évoqués dans la première hypothèse semblent être un tant soit peu mis à mal. Vu la nature bilingue du Canada, on s'attendrait en effet à des résultats bien plus élevés au Québec qu'en Europe étant données les différences évidentes en matière d'exposition à l'anglais. Pourtant, les chiffres obtenus dans ces études paraissent s'orienter vers un phénomène de surprotection de la langue, notamment écrite, né vraisemblablement d'un sentiment d'insécurité linguistique et culturelle, afin d'en assurer la survie. Cajolet-Laganière et coll. (2000) explique en effet que ‘les Québécois, pour se défendre de l'anglais, ont tendance, notamment en langue soutenue, à traduire les mots d'apparence anglaise’ (2000: 209). Cette remarque implique donc que les Européens francophones, notamment les Français de par la nature fortement unilingue de leur pays, ne voient aucun inconvénient à emprunter, tels quels, dans la presse écrite, des termes d'origine anglo-américaine vu qu'ils n'ont aucune raison vitale de se protéger contre une quelconque invasion culturelle étrangère.
Si l'on transpose ce schéma France-Québec à la province-même du Québec, l'on pourrait alors avancer que la ville de Québec, étant la moins exposée au bilinguisme de milieu, s'apparenterait le plus à la France et serait moins sujette à l'insécurité linguistique, alors que celle d'Ottawa-Gatineau, de par sa nature beaucoup plus bilingue, se retrouverait alors à la place du Québec et serait beaucoup plus sensible à la question de la langue. Contrairement, à ce que l’‘effet de voisinage’ prévoit, l'on pourrait alors s'attendre à relever un nombre d'anglicismes beaucoup plus élevé dans la presse écrite (de langue soutenue, comme le précise Cajolet-Laganière) de Québec que dans celle d'Ottawa-Gatineau, et dans une moindre mesure, que dans celle de Montréal, qui se positionnerait entre les deux.
5 HYPOTHÈSES
Chacune de ces deux approches semble donner une grande importance à la ‘régionalité’ de la langue utilisée au Québec mais amène inévitablement à deux hypothèses contradictoires.
Hypothèse 1 : Nous fondant sur l’ ‘effet de voisinage’, la ‘géolinguistique’ de l'emprunt et la ‘proximité éditoriale’ de la presse écrite, nous posons comme première hypothèse que plus une région sera bilingue, plus la fréquence d'anglicismes lexicaux dans sa presse écrite sera élevée.
Hypothèse 2 : Cependant, pour des raisons de survie de la langue, l'influence de la surprotection de la langue sur la presse écrite ne peut être négligée. Ainsi, nous posons comme deuxième hypothèse que plus une région sera bilingue, plus le français sera en situation minoritaire, plus les locuteurs francophones seront sensibles à l'insécurité linguistique et moins la presse écrite sera perméable aux anglicismes lexicaux.
Il devient donc intéressant de voir s'il existe de réelles différences dans l'utilisation des anglicismes, notamment en termes de fréquence et de terminologie, entre les différentes régions du Québec et de l'Outaouais. L'idée de l'analyse comparative d'un corpus de différentes presses locales prend donc ici tout son intérêt car elle permet de mettre en relation un matériel de bonne qualité (des articles de journaux), écrit par des personnes ayant reçu une formation identique (des journalistes) – et donc censées posséder à peu près les mêmes compétences d’écriture en français –, mais destiné à un lectorat un peu différent car localement ancré.
6 MÉTHODOLOGIE
6.1 Définition
Comme nous l'avons précédemment indiqué, nous avons adopté la définition proposée par Loubier (Reference Loubier2011) et choisi de nous concentrer sur les emprunts lexicaux. Tous les anglicismes que nous avons relevés se présentent donc sous la forme d'un ‘emprunt intégral (forme et sens) ou partiel (forme ou sens seulement) d'une unité lexicale étrangère’ (Loubier, Reference Loubier2011:14), et plus particulièrement sous la forme d'un emprunt lexical intégral (emprunt intégral de la forme et du sens originels, ou avec une adaptation graphique ou phonétique minimale : staff, lobby, démotion) ou hybride (emprunt intégral de sens mais à la forme partielle : focusser, dopage) (Loubier, Reference Loubier2011:10). Ce choix a été motivé en priorité par la facilité de repérage et d'extraction de ces termes dans un corpus volumineux grâce à leur graphie anglaise d'origine mais également car il s'agit de la catégorie la plus communément répertoriée dans les ouvrages de référence qui, aspirant à la voir disparaître, offrent à leurs utilisateurs une multitude d’équivalents plus appropriés. Leur présence dans les articles de presse n'en est donc que plus intéressante car ils devraient normalement pouvoir être assez facilement évités, ou tout du moins, bien plus facilement que les emprunts syntaxiques ou sémantiques.
6.2 Sélection de cas
Notre objectif étant d'analyser l'influence du bilinguisme environnant sur l'anglicisation de la presse écrite et sur l'utilisation des anglicismes dans trois villes différentes du Québec, nous avons tout d'abord cherché quelles villes nous semblaient particulièrement pertinentes pour ce genre de recherche. Nous avons choisi de suivre l'exemple de Castonguay et nous sommes arrêtés sur Ottawa-Gatineau et Montréal, pour les raisons que nous avons nommées plus haut, et y avons ajouté Québec, qui en tant que capitale provinciale nous a paru être un choix naturel et nécessaire. Nous avons ensuite tenu à évaluer la situation linguistique de ces trois villes afin de nous assurer qu'il existait effectivement des différences significatives en termes de bilinguisme de milieu. Statistiques Canada nous propose les données suivantes :
A l’étude du Tableau 1, l'on s'aperçoit que la ville d'Ottawa-Gatineau regroupe le taux le plus élevé d'anglophones de naissance, d'anglophones « pratiquants » (c'est-à-dire ceux qui utilisent l'anglais à la maison) et d'anglophones unilingues. Au contraire, la ville de Québec affiche un taux extrêmement élevé de francophones de naissance et pratiquants, ainsi que le taux le plus élevé d'unilingues francophones. Enfin, au milieu, Montréal se positionne avec le taux général de bilinguisme le plus élevé mais avec des taux d'anglophones de naissance, pratiquants et unilingues de 3 à 4,5 fois plus faibles que ceux d'Ottawa-Gatineau. Il est donc désormais possible de justifier notre choix de villes et de les classer de la plus sujette à l’ ‘effet de voisinage’ (Ottawa-Gatineau) à la plus unilingue (Québec) avec Montréal en trait d'union.
Tableau 1. Nos villes témoin et le bilinguisme
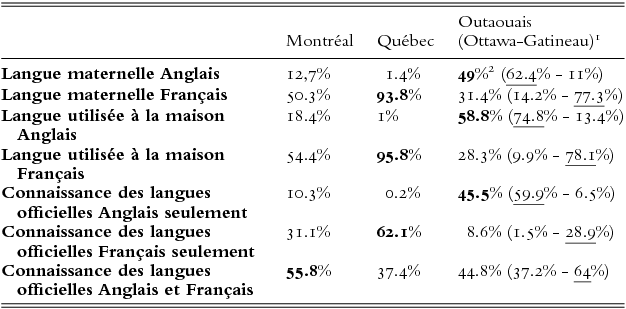
1 Les chiffres entre parenthèses correspondent respectivement aux résultats de la ville d'Ottawa et de la ville de Gatineau
2 Les chiffres en gras correspondent aux résultats les plus élevés entre les 3 villes témoins (Montréal, Québec et Ottawa-Gatineau). Les chiffres soulignés indiquent les résultats les plus élevés entre la ville d'Ottawa, Ontario et celle de Gatineau, Québec.
6.3 Notre liste témoin d'anglicismes
La deuxième phase de notre recherche a consisté à dresser une liste d'anglicismes témoins à partir d'un dictionnaire. Nous nous sommes arrêtés sur Le Multidictionnaire de la langue française de Marie-Eva de Villers, non pas par préférence personnelle mais parce qu'il présente l'avantage de posséder une version numérique récente de la 5e édition (2013), accessible sur ordinateur et qui offre la possibilité de sélectionner tous les emprunts lexicaux qui ont été répertoriés dans l'ouvrage sous l'onglet ‘Formes fautives’. De plus, même si les anglicismes ne sont pas le but premier de ce dictionnaire, ce qui influe donc inévitablement sur le nombre et la représentativité des termes répertoriés, il est recommandé par un grand nombre d'universités canadiennes, dont l'université d'Ottawa qui le considère comme l'un des ‘trois meilleurs ouvrages de référence traitant des anglicismes’ et d’’ouvrage de référence indispensable’Footnote 8 en plus d’être ‘approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec’.Footnote 9 Nous avons donc obtenu une liste de 495 emprunts lexicaux intégraux et hybrides après avoir méticuleusement éliminé tous les emprunts syntaxiques et sémantiques (calques), les erreurs orthographiques, les archaïsmes et toutes les autres impropriétés d'usage que de Villers a regroupés sous cette catégorie.
6.4 Notre corpus
La troisième étape a été consacrée à la formation de notre corpus. Nous avons sélectionné un journal par ville, en faisant particulièrement attention à choisir des quotidiens avec des caractéristiques similaires, notamment au niveau du lectorat visé et du nombre de lecteurs par semaine (voir Tableau 2). Notre choix s'est arrêté sur Le Droit pour Ottawa-Gatineau, Le Devoir pour Montréal et Le Soleil pour Québec.
Tableau 2. Notre corpus

1 Données de 2014, issues de http://www.ledevoir.com/societe/medias/438051/rapport-annuel-2014-une-autre-annee-exigeante-pour-le-devoir
2 Données de 2014, issues de publicite.lapresse.ca/htdocs/pdf/CapitalesMedias.pdf
3 Données de 2014, issues de publicite.lapresse.ca/htdocs/pdf/CapitalesMedias.pdf
Nous avons choisi ces trois journaux car ils sont très bien implantés localement. Ces quotidiens généralistes traitent des mêmes sujets et surtout, prêtent tous trois la même attention à la qualité de la langue utilisée. En effet, protéger le français est un peu la raison d’être du Droit, qui a été créé spécifiquement pour garantir la pérennité des francophones dans la région outaouaise alors que le gouvernement de la province avait voulu interdire l'instruction en français au début du 20e siècle. En tant que médias québécois, Le Devoir et Le Soleil sont encadrés par la Loi 101 et se doivent donc de promouvoir une langue française soutenue et de qualité. De plus, nous avons sélectionné Le Devoir, pour la simple raison que son lectorat hebdomadaire restait relativement comparable à celui du Droit et du Soleil, ce qui n’était pas le cas de La Presse qui, bien que faisant partie du même groupe de presse que les deux autres quotidiens, se détachait beaucoup trop avec plus de 700,000 lecteurs par semaine. Enfin, Le Devoir partage une même vision protectrice de la langue avec Le Droit, qui partage lui-même une ligne éditoriale avec Le Soleil, ce qui nous offrait une relative harmonisation du corpus.
Nous avons construit notre corpus à l'aide de la base de données Eureka.cc qui permet la consultation de tous les articles publiés par un journal sur une période donnée. Nous avons sélectionné les articles de nos trois quotidiens publiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et avons obtenu un corpus de 77,124 articles. Nous avons ensuite éliminé tous les articles « recyclés », c'est-à-dire signés par des journalistes travaillant pour des journaux différents de ceux analysés (Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP), La Presse, La Presse canadienne, La Tribune et Le Nouvelliste) ainsi que les traductions dès que l'information était mentionnée afin de ne garder que les articles rédigés par les journalistes ‘locaux’. Nous avons ainsi obtenu 16633 articles pour Le Devoir, 13243 pour Le Droit et 20247 pour Le Soleil. Nous avons par contre conservé tous les types d'articles (éditoriaux, chroniques, entretiens, reportages, critiques. . .) et tous les domaines (actualités locales, nationales et internationales, art et culture, politique, sports, cinéma, loisirs. . .) afin de bénéficier du plus large éventail de contextes possible.
6.5 Extraction des données
Enfin, la quatrième et dernière étape de notre recherche a été dédiée à l'extraction même des données afin de pouvoir déterminer la fréquence d'utilisation d'anglicismes, c'est-à-dire le nombre d'occurrences relevées par rapport au nombre total de mots. A l'aide de la base de données Eureka.cc, nous avons relevé manuellement chaque occurrence des 495 emprunts lexicaux témoins dans nos trois différents corpus, en prenant soin de rechercher toutes les variantes de genre (féminin/masculin) et de nombre (singulier/pluriel) pour les substantifs et les adjectifs, ainsi que toutes les conjugaisons (les 6 personnes du singulier et du pluriel) et les participes passés (genre et nombre) pour les verbes. Chaque article présentant au moins une occurrence du terme recherché a ensuite été lu individuellement afin d'y relever le nombre d'occurrences présentes.
7 RÉSULTATS
Comme le montre le Tableau 3, en moyenne, les articles du Devoir comprennent 698 mots, soit 1,7 à 2 fois plus que ceux du Droit (393) et ceux du Soleil (336). Parmi les 16633 articles publiés dans le journal Le Devoir en 2014 – soit environ 11 609 834 mots –, seuls 2008 contenaient au moins une occurrence des emprunts lexicaux témoins, ce qui représente 12% du corpus. Dans ces 2008 articles, nous avons pu extraire 2331 occurrences de 243 anglicismes différents alors que les 252 autres emprunts témoins (soit près de 51%) ne sont pas apparus une seule fois. Cela représente environ 0,2 anglicisme tous les 1000 mots, soit un anglicisme tous les 7 articles.
Tableau 3. Résultats chiffrés et statistiques

En moyenne, les articles du Droit comprennent 393 mots, soit 1,7 fois moins que ceux du Devoir (698) et 0,85 fois plus que ceux du Soleil (336). Parmi les 13243 articles publiés dans le journal Le Droit en 2014 – soit environ 5 204 499 mots –, seuls 991 contenaient au moins une occurrence des emprunts lexicaux témoins, ce qui représente 7% du corpus. Dans ces 991 articles, nous avons pu extraire 1138 occurrences de 169 anglicismes différents alors que les 326 autres emprunts témoins (soit près des 2/3) n'ont pas été relevés une seule fois. Cela représente environ 0,2 anglicisme tous les 1000 mots, soit un anglicisme tous les 13 articles.
En moyenne, les articles du Soleil comprennent 336 mots, soit 2 fois moins que ceux du Devoir (698) et 0,85 fois moins que ceux du Droit (393). Parmi les 20247 articles publiés dans le journal Le Soleil en 2014 – soit environ 6 802 992 mots –, 2661 contenaient au moins une occurrence des emprunts lexicaux témoins, ce qui représente 13% du corpus. Dans ces 2661 articles, nous avons pu extraire 3184 occurrences de 253 anglicismes différents alors que les 242 autres emprunts témoins (soit près de 49%) n'ont pas été relevés une seule fois. Cela représente 0,5 anglicisme tous les 1000 mots, soit un anglicisme tous les 15 articles.
Si l'on compare les données brutes de chaque journal, on s'aperçoit que le corpus du Devoir se situe entre Le Droit et Le Soleil au niveau du nombre total d'articles. Par contre, il comprend un nombre total de mots respectivement 2,2 et 1,7 fois plus élevé que celui du Droit et du Soleil pour un nombre moyen de mots par article de 1,7 à 2 fois plus élevé. Son nombre d'anglicismes/1000 mots sur le corpus total est de 0,2, comme pour Le Droit mais légèrement inférieur à celui du Soleil qui est de 0,5. La fourchette brute d'articles avec anglicismes oscille entre 991 (Le Droit) et 2661 (Le Soleil) et celle du nombre total d'occurrences va de 1138 (toujours pour Le Droit) à 3184 (Le Soleil).
Le Soleil semble donc présenter les fréquences d'utilisation les plus élevées avec 51% des emprunts témoins retrouvés, 13% d'anglicismes sur le total d'articles et 0,5 anglicisme/1000 mots. Au contraire, Le Droit affiche les résultats les plus faibles avec seulement 34% des emprunts témoins présents pour un taux de 7% du total d'articles et 0,2 anglicismes/1000 mots. Cependant, étant donné le nombre moyen de mots par article plus faible du Soleil, ce dernier a un rapport beaucoup plus élevé (1/15) que celui Droit (1/13) ou du Devoir qui prend la tête avec 1 anglicisme tous les 7 articles.
Comme le montre le tableau 4, le résultat le plus élevé pour un anglicisme s’élève à 141 articles pour Le Devoir, à 105 articles pour Le Droit et à 266 articles pour Le Soleil. Toutes origines confondues, l'anglicisme le plus fréquent dans Le Devoir comptabilise 215 occurrences, 131 occurrences dans Le Droit et 460 occurrences dans Le Soleil.
Tableau 4. Les anglicismes les plus fréquents
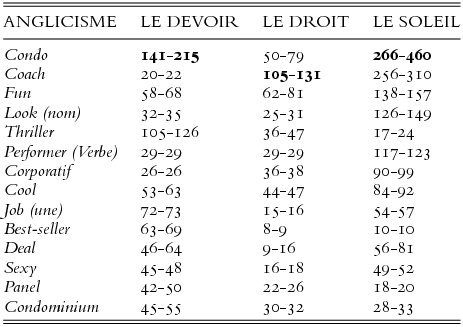
Six anglicismes dépassent les 100 occurrences dans au moins l'un des trois corpus (Condo, Coach, Fun, Look, Thriller et Performer) et 5 anglicismes sont apparus au moins 50 fois (Corporatif, Cool, Job, Best-seller et Deal). En combinant Condo et Condominium qui font référence au même concept mais sont traités sous deux entrées différentes dans Le Multi, l'on obtient des résultats atteignant 270 occurrences pour près de 190 articles dans Le Devoir, un peu plus de 110 occurrences pour 80 articles dans Le Droit et près de 500 occurrences dans Le Soleil pour presque 300 articles. Sur les 14 termes les plus fréquents, on observe que 9 sont des substantifs, 4 sont des adjectifs et on retrouve également un verbe (performer). Cet échantillon est assez représentatif de la liste témoin pour ce qui est des substantifs, par contre, De Villers a recensé dans Le Multi au moins autant d'anglicismes verbaux que d'anglicismes adjectivaux, ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, des verbes comme dispatcher, disconnecter, goaler, loader, originer ou encore patenter qui font partie de la liste témoin n'ont soit été relevés dans aucun article, soit n'affichent que des résultats très faibles (1 ou 2 occurrences).
En bas du tableau (partie non publiéeFootnote 10 ), on retrouve 74 anglicismes qui n'apparaissent que dans un seul article du Devoir, ce qui représente 30% du total d'anglicismes témoins relevés. Le Droit regroupe quant à lui 73 de ces anglicismes présents dans un seul article, soit 43% et Le Soleil 63, soit 25% du nombre d'anglicismes ‘actifs’.
On peut également noter que la fréquence d'utilisation des différents anglicismes et que leur distribution selon les « types » d'articles (chronique, éditorial, fait divers, tribune libre, critique, entrevue . . .) ne sont pas toujours semblables selon le journal. Pour Le Devoir, condo (141–215Footnote 11 ) et thriller (105–126) occupent le haut du tableau et affichent des résultats deux à trois fois supérieurs à ceux du terme arrivant en troisième place. Les termes condo et thriller affichent des résultats assez élevés car ils sont utilisés de façon répétitive, dans chaque nouvelle édition. Par exemple, condo sert systématiquement de titre d'appel dans les rubriques Maison ou Immobilier, alors que thriller est une catégorie de film prédéfinie par le journal pour les critiques de la rubrique Cinéma au même titre que « comédie », « drame » ou « documentaire ». Au troisième rang se trouve Best-seller (63–69), qui est dans la très grande majorité des cas le terme d'accroche des articles de critique littéraire et est utilisé dès que le contexte le permet. Affichant des statistiques assez similaires, fun (58–68) et deal (46–64) occupent les quatrième et cinquième places. Fun se retrouve très souvent dans des tribunes libres, des entrevues avec invités ou des passages au discours direct (conférences de presse, paroles rapportées . . .). Deal a, de son côté, été extrêmement populaire en 2014, et explique ses chiffres notamment par les retombées médiatiques de l'affaire Marois-Blanchet-Fonds FTQ.Footnote 12
Pour Le Droit, coach (105–131) revient dans presque tous les articles couvrant le domaine sportif et est utilisé aussi bien pour désigner la fonction d'entraîneur que les entraîneurs eux-mêmes. La deuxième place revient à fun (62–81) qui, comme pour Le Devoir, se retrouve souvent dans des rubriques plus oralisées (Le Mag, Opinions, Faits divers), ce qui s'explique principalement par le fait que les Québécois semblent l'utiliser à une écrasante majorité sous sa forme substantivée, laquelle s'utilise presqu'uniquement à l'oral (« Quand j'étais jeune, je voulais juste avoir du fun avec ma famille et mes amis »Footnote 13 ). On retrouve en troisième et quatrième positions les termes condo (50–79) et thriller (36–47) qui suivent le même schéma que pour Le Devoir et se retrouvent de façon quasi systématique dans les rubriques Immobilier et Cinéma.
Du côté du Soleil, les résultats sont plus importants, à la fois en amplitude et en nombre. En plus d'y retrouver les termes communs condo (266–460), coach (256–310), fun (138–157) et deal (56–81), on peut également y ajouter look (126–149), corporatif (90–99) et cool (84–92). Le terme look semble être très apprécié des journalistes de ce quotidien vu qu'ils y ont recours dans toutes sortes de contextes (mode, sports, arts, politique . . .) et toutes sortes d'articles (reportage, chronique, entretien . . .). Avec des résultats plus élevés que ceux des deuxièmes et troisièmes places des deux autres journaux, les deux derniers termes corporatif et cool se classent au cinquième et sixième rangs et semblent être également très prisés dans les éditoriaux, les chroniques quotidiennes ou les questions d'entrevues d'invités. Alors que corporatif est utilisé très majoritairement dans les rubriques Actualités (nationale et internationale), Affaires et dans leurs Dossiers, cool présente une utilisation beaucoup plus éclectique et s'invite un peu partout, peu importe le domaine, mais semble tout de même privilégier les chroniques ou billets d'opinion.
8 INTERPRÉTATION
Les données brutes valident très clairement la deuxième approche, à savoir celle de la surprotection de la langue dans une optique de survie. Alors que l'on aurait pu s'attendre à trouver plus d'anglicismes dans le quotidien Le Droit d'Ottawa-Gatineau, suite au principe d’‘effet de voisinage’, ce dernier présente les résultats les plus faibles sur presque tous les aspects testés. Que ce soit au niveau du nombre d'anglicismes témoins trouvés (seulement 34%), du nombre total d'occurrences relevées (1138) ou encore du nombre d'anglicismes pour mille mots global (0,2), Le Droit se classe en dernière position.
De l'autre côté, le quotidien pour lequel nous aurions pu prévoir les résultats les plus faibles totalisent les données les plus élevées. Le Soleil se classe en effet en première position sur tous les aspects que nous avons testés. Le nombre d'anglicismes témoins trouvés est le seul des trois journaux à dépasser la moitié (51%), le nombre total d'occurrences relevées (3184) est 1,4 fois supérieur à celui du Devoir et 2,8 fois supérieur à celui du Droit. Le nombre de termes totalisant plus de 50 occurrences est beaucoup plus élevé que dans les deux autres journaux et l'amplitude de leur fréquence d'utilisation oscille entre 3.75 et 4.5 fois celle des anglicismes relevés dans Le Devoir et Le Droit. Enfin, son nombre d'anglicismes pour mille mots global (0,5) est 2,5 fois supérieur à celui du Droit et du Devoir.
Il semblerait donc que l’‘effet de voisinage’ mentionné par Poplack (Reference Poplack1989) ne se transmette pas à la langue écrite et que bien au contraire, plus l'insécurité linguistique est élevée et plus sa protection sera importante. La région d'Ottawa-Gatineau étant de loin la plus bilingue, les journalistes du Droit feraient donc très attention à la qualité du français qu'ils utilisent dans leurs articles et ce afin d'en garantir la pérennité. La ville de Québec n’étant de son côté que très marginalement exposée à la langue anglaise au quotidien, les journalistes du Soleil ne ressentiraient pas le besoin de surprotéger la langue française.
La proximité éditoriale ne semble donc pas être un principe particulièrement important pour la presse québécoise, ou tout du moins, pour la presse écrite québécoise de ‘référence’, c'est-à-dire celle qui n'utilise qu'une langue de qualité. Il pourrait s'agir ici d'une autre forme d'insécurité linguistique qui s'exprimerait, cette fois-ci, non pas par rapport à l'anglais mais plutôt par rapport au français dit standard.
Ces résultats peuvent également s'expliquer par le fait que Le Droit a toujours fait de la protection et de la survie du français en région outaouaise son cheval de bataille. Cette prise de position éclaire certainement la dichotomie évidente qui existe chez les habitants de l'Outaouais entre leur exposition au français écrit, qui se veut le plus pur possible, et leur exposition au français oral, qui est lui beaucoup plus métissé car directement influencé par la géolinguistique et l'omniprésence de l'anglais au quotidien.
9 CONCLUSION
Malgré la faible fréquence d'anglicismes dans le corpus, − environ 1 anglicisme tous les 7 à 15 articles (ou 0,2 à 0,5 anglicisme/10 mots) −, cette étude semble indiquer que l'insécurité, la survie et la protection linguistiques jouent un rôle important sur la qualité de la langue utilisée par les journaux québécois francophones. Peu importe la réalité quotidienne dans laquelle elles vivent ou la langue qu'elles utilisent tous les jours, les trois communautés francophones que nous avons étudiées ont accès à une presse écrite qui s'attache à offrir à ses lecteurs une langue soutenue, plutôt qu’à adopter une attitude de « proximité » dans laquelle elle pourrait y faire refléter les différents vernaculaires de la province.
L'on peut également faire remarquer le manque relatif de représentativité de notre liste témoin par rapport aux anglicismes réellement utilisés par les Québécois. Même si notre choix s'est porté sur l'ouvrage du Multidictionnaire de la langue française en particulier car nous souhaitions établir une liste témoin d'anglicismes représentative de l'usage au Québec, les résultats montrent que seuls 34 à 51% des emprunts lexicaux référencés ont trouvé un écho dans notre corpus de trois journaux. Beaucoup d'autres anglicismes ont été relevés au cours de nos lectures d'articles, tels spring break (16); nation-building (9); cheap shot (1); jet-set (25); bluff (9); package deal (3); gender gap (15); voix off (8) ; pitcher (13), spin-off (12), roller-coaster (5), script-éditeur/édition (14) . . ., qui ne figuraient pas dans le Multi.
En nous servant des termes pré-listés par Le Multi, nous avons également remarqué que certains anglicismes présentaient une très bonne vitalité morphologique (cf. Höfler, Reference Höfler1982) dans les articles de presse. Nous avons par exemple relevé brainstorming > brainstormer, briefing > briefer, kitesurf > kitesurfing, kitesurfeur, kitesurfer, podcasting > podcast, podcasteur, podcaster, remix > remixer, remixage, remixeur . . . D'autres entrées se sont plus illustrées dans le domaine de la variation terminologique. C'est ainsi que nous avons par exemple repéré break dance; spring break; shooting break, base building; nation-building, light sweet crude; light-show; philosophie du light is right; light painting, script supervisor; script-girl; scripte; script-éditeur; script-édition; script-éditrice, off the record; voix off; volet off; off-mondial; off-cabaret; spin off; festival off; concours off; off-duchesses, ou encore hot spot; cold spot; bright spot; spot-zoning. Toutes ces données non comptabilisées pourraient avoir un impact considérable sur les résultats que nous avons présentés dans cet article et pourraient donc potentiellement mettre en lumière une toute autre réalité, notamment au niveau de l'implantation terminologique de ces emprunts dans la langue française.
Il va sans dire que d'autres études sur le sujet ayant recours à plusieurs ouvrages de référence voire à un relevé manuel permettront de pallier ce genre de carence et de confirmer/infirmer nos résultats.







