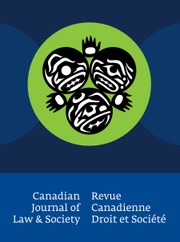Introduction
Les commissions de vérité et de réconciliation constituent une forme de recours juridique supplémentaires aux poursuites criminelles ou civiles susceptibles de traiter les cas les plus graves de violations systémiques des droits humains par des États. Bien qu’elles varient en termes d’objectifs et de procédure, elles font généralement appel au témoignage des victimes directes de ces violations dans le cadre de vastes audiences publiques ayant pour but de revoir les fondements consensuels historiques de l’État et de prévenir la répétition de dommages systémiques et institutionnalisés causés dans le cadre de ces violations. Une commission de vérité et de réconciliation va ainsi au-delà de la réparation juridique de droits humains, dans la mesure où elle représente une opportunité spéciale d’inclure les éléments marginalisés par l’État afin qu’ils puissent trouver leur place dans nos récits communs de domination et de différenciation.
La Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats autochtones au Canada (CVR), qui se réunit depuis 2010, nous offre l’opportunité d’observer ces processus où les victimes reconsidèrent leur place dans l’histoire de l’État. La CVR a été créée par la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones et a pour mandat de recueillir les témoignages d’anciens pensionnaires et de gens ayant œuvré dans les pensionnats autochtones du Canada. Elle a pour objectif de faire la lumière sur le passé des pensionnats, ses diverses répercussions dans la vie des survivants et de leurs familles, ainsi que de sensibiliser le public au sujet du régime des pensionnats et de ses répercussions. Pour ce faire, la CVR a pour mandat d’organiser sept événements nationaux, d’appuyer les événements communautaires et de créer un dossier historique public (centre de recherche national). Footnote 1
La CVR du Canada possède des caractéristiques qui la distinguent de ses homologues dans le monde. Tout d’abord, elle est la seule commission de vérité qui se penche exclusivement sur les actes de violence exercés contre des enfants. Évidemment, d’autres commissions ont inclus dans leur enquête des torts causés à des enfants, telles que celles de Sierra Leone et de l’Ouganda, qui traitent de cas d’enfants recrutés pour devenir soldats et/ou esclaves sexuels. Footnote 2 Cependant, dans le cas de la CVR canadienne, les agressions subies par les enfants constituent le noyau unique et indéniable de l’enquête.
Deuxièmement, la CVR du Canada est issue d’un litige civil. Elle ne fut pas, comme c’est le cas pour la majorité des autres commissions de vérité, conçue à la suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile. Pour cette raison, elle n’a pas eu le même degré d’attention nationale et internationale dont d’autres ont pu bénéficier. Les commissions de vérité et réconciliation sont habituellement associées à des régimes de changement (de là le terme « justice transitionnelle ») et traitent d’actes de violence perpétrés par l’État qui font déjà partie d’une histoire nationale connue et reconnue. Lorsque de telles commissions sont organisées, la trajectoire de l’État a déjà été interrompue, et elles ont pour mandat de marquer la transition vers de nouveaux régimes politiques, en harmonie avec les standards internationaux des droits humains. Mais dans le cas de la commission canadienne, les jugements qui en sont à l’origine sont ceux de tribunaux, résultant de litiges, et non de faits historiques déjà reconnus par l’ensemble de la population. Ayant débuté ses travaux sans avoir au préalable l’attention d’un public national et international, la CVR canadienne a donc dû s’engager activement dans diverses formes d’autopromotion afin de se faire connaître, et ce notamment à travers la cueillette de témoignages des victimes. Les dépositions présentées à la commission servent donc à convaincre la population de l’existence et de la véracité des faits historiques relatifs aux pensionnats autochtones, ainsi qu’à la construction d’une nouvelle trame narrative de l’histoire de l’État canadien.
Ainsi, des efforts considérables (peut-être plus que dans n’importe quelle autre commission de vérité) consacrés à la publication ainsi qu’à la transmission sur supports numériques assurent une diffusion large des événements et témoignages de la CVR. Par exemple, les témoignages livrés au cercle du commissaire sont diffusés en direct sur le site web de la CVR et les témoins déposant se voient remettre une copie de leur déclaration. De plus, une version numérique de l’ensemble des travaux de la commission doit être publiée sous forme d’archive en ligne. L’auditoire des participants à la commission va bien au-delà du public présent dans la salle et des auditeurs sur le web; il s’étend aussi à des spectateurs qui ne peuvent être perçus que dans l’abstrait, notamment le public des audiences à venir.
La CVR favorise des formes de témoignages précises, ce qui, par le fait même, donne vie à des récits de traumatismes et de crimes institutionnels au sein d’une histoire nationale redéfinie. Les témoignages sont aussi conditionnés par des influences et des structures institutionnelles extrinsèques aux salles de réunion de la commission. Cela se mesure, par exemple, dans l’impact qu’ont les organisations de survivants qui offrent un sentiment de solidarité à ceux qui autrement hésiteraient à témoigner. Aussi, il est évident que les représentants de l’Église qui comparaissent devant la commission sont des porte-paroles de leur organisation, et ceux-ci émettent donc des points de vue sur l’histoire de l’Église (pas toujours exprimées publiquement) qui coïncident avec ceux de leurs coreligionnaires. Parallèlement, les salles de réunion sont des lieux que Pottage assimilerait à un procédé juridique qui « fabrique des personnes et des choses », lequel incorpore un éventail de « techniques juridiques de personnification et de réification ». Footnote 3 Borneman y voit « une séquence temporelle d’expérience » dans laquelle « l’affliction et le crime politique sont incarnés dans des objets, des personnes, des lieux et des choses, afin de les rendre significatifs de façon renouvellée ». Footnote 4 Notre essai traite précisément de ce processus de réification. Comment la CVR réduit-elle le répertoire d’expériences dans les pensionnats à des essentialismes fondamentaux et complémentaires, tout en écartant la présentation de témoignages importuns et compensatoires ?
Il semble que les commissaires de la CVR canadienne eux-mêmes soient découragés par le désespoir prédominant qui leur est présenté. Lors du troisième rassemblement national à Halifax, en octobre 2011, les commissaires avaient déjà assisté à plusieurs événements de la sorte. Alors que se cristallisait la préséance de témoignages reposant sur les thèmes du sadisme, de l’exploitation sexuelle, de victimisation et attestant de vies entières marquées par la souffrance, les commissaires semblent avoir ressenti le besoin d’y réagir. En ouvrant la séance, Murray Sinclair explicita ses attentes: « Ce n’est pas notre intention de vous demander de ne partager que votre douleur avec nous . . . Nous avons besoin que vous n’examiniez pas seulement votre tristesse et votre douleur, mais que vous parliez des bonnes choses qui se passaient dans les écoles . . . Il est important que vos petits-enfants sachent ce pourquoi vous avez survécu ». Footnote 5 Et le commissaire Wilton Littlechild incita pareillement les témoins potentiels à présenter des témoignages qui « offre une possibilité formidable d’entendre de bonnes histoires ». Footnote 6 Toutefois, lors des quatre rassemblements nationaux complets qui se sont déroulés entre 2010 et 2012, on ne dénote que très peu de réponse à cet appel aux témoignages positifs. Malgré les encouragements des commissaires, une tendance s’est dégagée dans les témoignages qui ont été livrés lors des trois rassemblements nationaux. Cette tendance est marquée par les traumatismes des écoles et les effets continus de ces traumatismes à l’âge adulte, souvent sous les formes de dépendance et d’échec en matière de parentalité. Footnote 7
Dans leurs valorisation pour les histoires « positives », les commissaires ont exprimé une préoccupation similaire à celle de leurs homologues de la CVR sud-africaine, qui trouvaient que les témoignages ont établi progressivement ce qui pouvait être dit, et que « la commission risquait de ne pas connaître “toute l’histoire” des grossières violations de droits humains commises durant la période à l’étude ». Footnote 8 Les témoignages livrés dans le contexte canadien mettent en relief uniquement ces violations grossières, plus particulièrement les souvenirs d’agression et de torture d’enfants, au détriment d’une vue d’ensemble plus complète et variée des origines, de l’administration et des conséquences de ces pensionnats.
À un certain niveau, tout cela est peu surprenant. Il est incontestable que des torts considérables et systémiques furent commis à l’endroit d’enfants au sein d’institutions supposées les « aider ». Un rapport de la Commission du droit du Canada (2000) établit des liens spécifiques entre des institutions telles que les orphelinats, les écoles pour malentendants et, évidemment, les pensionnats autochtones, insistant sur le fait essentiel que ces institutions sont en retrait de la société à différents égards et en grande partie libres de toute supervision. Pour cette raison, elles sont souvent devenues des refuges pour des pédophiles et des sadiques, qui ont parfois abusé d’enfants dont ils avaient la garde pour des années, voire des décennies, tout en étant protégés par l’institution pour laquelle ils agissaient. Dans la plupart de ces résidences institutionnelles, des enfants ont été placés sous l’autorité presque incontestée des responsables de ces centres. Selon les mots de la Commission du droit du Canada, cela fut « une invitation à des abus de pouvoirs par des prédateurs ». Footnote 9 Il faut ajouter à ce contexte malsain le traumatisme des enfants résultant du retrait soudain d’un environnement rural isolé, de l’expérience du racisme et du dénigrement culturel à l’école ; l’objectif de rééducation loin de l’influence de leurs familles et communautés amplifiant le bouleversement. Ainsi, il n’est pas étonnant que les témoignages relatant des souvenirs d’enfance passée dans les pensionnats autochtones tendent à accentuer les expériences d’abus et de traumatisme.
Néanmoins, un autre aspect de ces témoignages mérite que l’on s’y attarde. Il existe un gouffre énorme entre la fréquence des traumatismes et la capacité des victimes d’en raconter leur expérience publiquement. Il est largement reconnu par les survivants de pensionnats autochtones que, il y a de ça quelques décennies, presque personne n’osait parler de leur expérience à l’école, et ce, même à leur famille immédiate. Le sujet était oublié et refoulé. Le silence n’a été rompu que récemment grâce à la volonté de plusieurs survivants d’en livrer leur témoignage publiquement lors de procès, à des audiences pour compensation ou plus ouvertement, en direct sur le web, lors des témoignages enregistrés au cercle des commissaires de la CVR. D’où l’importance de bien saisir comment ces témoignages puissants et chargés en émotions sont devenus, une fois livrés à la CVR, non seulement racontables mais prédominants, jusqu’à en exclure d’autres formes de témoignage.
À notre avis, nous devons également nous pencher sur ce qui demeure « irracontable », ou les sujets et les opinions que l’on aborde prudemment. Cette catégorie de « l’irracontable » va bien au-delà de l’expérience des anciens élèves qui affirment avoir profité de l’éducation des pensionnats. Une des caractéristiques importantes de la CVR canadienne est que les points de vue de ceux et celles qui ont été impliqués dans des institutions gouvernementales—les religieuses, les prêtres et autres gens d’église qui dirigeaient les écoles—ne sont pas représentés de façon significative. Ceux-ci ne sont pas plus amenés à rencontrer ou échanger avec ces anciens élèves qui sont, en quelque sorte, les plaignants dans le processus. Les prêtres oblats et religieuses que nous avons rencontrés ont souvent des versions fort différentes de la souffrance, en particulier de la souffrance qu’ils ont ressentie personnellement au travers des structures et des processus d’accusation.
La tendance marquée de la sélection des témoignages montre une contradiction inhérente fondamentale de la CVR canadienne: l’objectif d’offrir un forum aux victimes de violence et d’abus est en contradiction avec ceux liés à la réconciliation et à la reconsidération du récit historique de l’État. Les opinions développées au cours des travaux de la CVR sont influencées par la force et le pouvoir de persuasion des témoignages des survivants, ce qui s’explique simplement par la répulsion et l’indignation que suscite l’idée même de l’abus. Comme nous le démontrerons tout au long de cet article, ce type de témoignage remplit l’espace requis permettant de comprendre la dynamique réelle des pensionnats, les raisons de leur établissement, les causes de la corruption de leurs objectifs, et les caractéristiques communes qu’ils pourraient avoir avec d’autres formes durables et continues d’abus de pouvoir institutionnel. Footnote 10
Dans le cadre de nos recherches, nous avons assisté aux quatre premiers événements nationaux de la CVR (Winnipeg, Halifax, Inuvik, et Saskatoon), un événement régional (Victoria) et deux événements communautaires (Iqaluit et Ottawa). Avec l’aide d’auxiliaires de recherche, nous avons observé et pris des notes sur l’ensemble du déroulement de ces événements (qui contiennent souvent diverses activités en simultané), ainsi qu’enregistré et transcrit les dépositions publiques de centaines de témoins. Nous avons également interviewé dix-huit pères et frères oblats dans leurs résidences à Montréal, Alberville (près d’Edmonton, Alberta), Iqaluit, Ottawa, Winnipeg, et Rome, ainsi que onze sœurs grises dans deux entrevues de groupe à Winnipeg. Nous avons eu plusieurs conversations instructives avec des membres religieux et laïques des Églises anglicanes, unies et presbytériennes à chaque événement national. Nous avons effectué douze entrevues avec des survivants de pensionnats et sept entrevues avec des employés de la CVR, incluant des personnes chargées du soutien à la santé des participants, durant ces événements nationaux. Finalement, des conversations avec d’anciens pensionnaires ont également eu lieu de 1998 à 2000 à la communauté de Cross Lake au Manitoba, ainsi qu’à une rencontre en 2012 avec le Outreach Residential School Atlantic Committee en Nouvelle Écosse (un groupe de soutien pour les anciens pensionnaires de la région des Maritimes).
Notre objectif n’est pas de combler le fossé entre l’hétérogénéité des expériences dans les pensionnats et la production de témoignages spécifiques à la CVR, ni d’en arriver à un récit historique alternatif à celui résultant des travaux de la commission (bien que nous espérons que d’autres relèveront ces défis). Notre intention ne se limite pas non plus au fait d’identifier et de critiquer cette situation (bien que nous puissions le faire à l’occasion). Notre objectif est plus simple. Il consiste en une enquête sur le développement des thèmes prédominants dans rencontres de la commission qui, directement ou indirectement, sont générateurs de connaissance. Notre intérêt se centre sur les processus par lesquels des expériences communes et stigmatisées sont sorties de l’isolement, exprimées de manière conceptuelle, perçues, ressenties et donnent lieu à des réponses appropriées. Bien que nous nous attardions beaucoup à la sélectivité et aux omissions dans le discours, nous voulons aussi étudier la façon selon laquelle l’expression matérielle de la souffrance peut encourager des témoins à livrer publiquement des souvenirs douloureux, tout en donnant corps à des expressions émotionnelles, des thèmes narratifs ainsi qu’à une ou plusieurs compréhensions de l’histoire de cette pratique institutionnelle.
Nous allons tout d’abord décrire les conditions dans lesquels sont livrés les témoignages de la CVR et les dynamiques qui façonnent le discours des participants. Notre attention se portera d’abord sur les cercles de partage lors d’événements nationaux et régionaux et sur le rôle des groupes de survivants qui y sont très actifs. Nous discuterons de divers aspects matériels de la production des témoignages pour ensuite nous pencher sur les expositions d’archives et de photographies présentées lors des événements nationaux de la CVR et sur leur contribution à cette sélection de récits historiques. Ces observations nous aideront à bien cerner les thèmes narratifs communs aux témoignages livrés à la CVR, leurs modes d’expression ainsi que leur portée. Comme nous le démontrerons au terme de nos observations et argumentation, les thèmes dominants des témoignages ont une force et une portée telle que certains témoins réussissent à les réitérer, malgré leur refus de limiter leurs récits au sujet des pensionnats.
Les Cercles
Le témoignage des survivants des pensionnats évoque fréquemment les horreurs de la violence faite aux enfants. Ceci inclut entre autres les voies de fait, les agressions sexuelles, en plus des régimes sadiques de discipline, d’humiliation et de dénigrement culturel. Voici un témoignage, un exemple parmi plusieurs, livré en juin 2010, à l’occasion de l’ouverture d’un des cercles des commissaires lors du premier rassemblement de la CVR à Winnipeg :
J’éprouve jusqu’à ce jour des problèmes d’anxiété. Je suis claustrophobe. J’étais trop jeune quand j’ai commencé l’école si bien que quand les enfants étaient en classe, les religieuses m’amenaient dans une remise. On me laissait sortir pour le dîner ; mais aussitôt que les enfants étaient retournés en classe, on m’enfermait à nouveau dans cette remise. Quand j’y suis arrivée au début, on a tout fait pour me déraciner. On m’a frotté jusqu’au sang. On m’a coupé les cheveux. Je dormais sur un lit où je ne pouvais bouger. Je devais dormir comme si j’étais sur la croix. Ma peau était endolorie, j’avais des ampoules, je saignais. J’en ai toujours des cauchemars, dont un en particulier. Je flotte dans l’espace, j’y vois mon père amener une petite fille et je me dis : « ne l’y amène pas, c’est un mauvais endroit ». Mais il y entre avec elle. En montant l’escalier, il se retourne et me regarde ; il sait que je suis là. On m’a prise et on était gentil au début. Ils disaient vouloir prendre soin de moi, mais aussitôt que la porte s’est refermée, c’est là que tout a commencé. Je ne savais pas parler anglais, on m’a fouettée, j’ai été agressée par deux prêtres. Footnote 11
L’essentiel de ce genre de récits est également livré par des haut placés catholiques, anglicans, presbytériens ainsi que de l’Église unie. Leurs déclarations expriment une profonde pénitence. Les excuses officielles de l’archevêque anglican Michael Peers aux survivants de pensionnats en sont un bon exemple :
Je regrette, au-delà de mes paroles, que nous faisions partie d’un système qui vous a enlevés vous et vos enfants de vos terres et de vos familles. Je regrette, au-delà de mes paroles, que nous ayons tenté de vous remodeler à notre image, en vous dépouillant de votre langue et des symboles de votre identité. Je regrette, au-delà de mes paroles, que tant d’entre vous aient été agressés physiquement, sexuellement, culturellement et émotionnellement dans nos écoles. Au nom de l’Église anglicane du Canada, je vous présente nos excuses. Footnote 12
Ces deux exemples illustrent le genre de témoignages auquel a conduit l’instauration de la CVR, qu’ils soient livrés par des survivants ou des représentants de l’Église. En dépit de ces modèles, il convient de noter que le forum de la commission demeure très permissif ; aucune règle explicite ne limite les sujets sur lesquels les témoins décident de parler ni le temps qui leur est alloué. Dans un forum public, il est concevable que l’ordre soit établi par des règles formelles de procédure qui vont au-delà de l’étiquette et qui le garantissent par le biais de mesures spécifiques. De fait, les commissaires émettent parfois des recommandations lors des événements publics, indiquant que les témoins devraient limiter leurs déclarations à quinze minutes. Cette limite est toutefois souvent dépassée, parfois même de manière excessive. Il y prévaut plutôt un sens de démocratie participative grâce auquel on s’attend à ce que tous les témoins de la commission soient en mesure de faire valoir leur expérience, et ce, comme ils l’entendent. À une occasion, c’est avec passion qu’un témoin aux prises avec les conséquences d’une récente attaque cérébrale a prononcé au micro une suite de sons incompréhensibles, finissant ce qu’il avait à dire en hochant la tête en guise de remerciement avant de retourner à sa place.
Cette permissivité (du moins superficielle) du cercle du commissaire met en évidence le problème qui nous intéresse. Comment des témoignages exempts de contraintes procédurales ou de lignes directrices parviennent-ils à prendre des formes distinctes ? Comment les témoins font-ils le tri de leurs souvenirs pour choisir les récits qui méritent d’être racontés publiquement? Et plus particulièrement, en quoi le contexte associé à une audience publique influence-t-il ce que le témoin décide d’exprimer, qu’il soit conscient ou non de cette influence ?
Il est important de noter que l’acte de se remémorer est souvent accompagné par celui d’oublier. Se remémorer certains détails précis des expériences passées, et en faire une histoire de vie, n’est possible qu’en faisant abstraction du reste. Footnote 13 Un processus de sélection opère, et ce processus semble suivre la même trame narrative, suggérée par la TRC et par le statut de survivant. Se rappeler le passé traumatique et les souffrances, leur position de victimes aux mains d’abuseurs—l’État et l’Église—a un effet polarisateur sur le passé, et nécessite l’oubli des souvenirs modérés qui n’ont pas leur place dans l’un ou l’autre de ces pôles. Ceci, selon Natzmer, restructure la perception qu’ils ont du passé, afin de répondre aux besoins du présent et les projets du futur: « À travers les récits que les gens racontent, les images qu’ils créent, leurs performances dramatiques et les institutions qu’ils adoptent et celles auxquelles ils résistent, les événements du passé sont interprétés et se transforment en réalités sociales ». Footnote 14 Il s’agit d’une forme de prise de pouvoir sur leur passé et, ils espèrent, leur futur, à travers de nouveaux critères d’identité marqués par la souffrance.
En gardant ceci en toile de fond, tournons-nous maintenant vers la technique et les technologies utilisées qui permettent aux témoins de livrer des récits reflétant une douleur profonde. Tout d’abord, les influences les plus évidentes proviennent des témoignages présentés aux participants potentiels à titre de modèles. Ceux-ci peuvent comprendre tout ce qui a été présenté dans le cadre du forum et qui constitue un exemple destiné à diriger les idées ou les comportements des participants. Ces « témoignages modèles » sont présentés dans un environnement qui est peu familier aux participants, et les attentes qu’on a envers eux sont également inconnues ou peu claires. Corrélativement, ils laissent place à une certaine créativité et originalité. Les idées ou les comportements qu’ils mettent en scène sont présentés comme des expressions authentiques et spontanées de personnes libres, en plus d’être des exemples positifs pré-approuvés à suivre pour les prochains témoins.
Ces modèles sont facilement reconnaissables dès le début du cercle des commissaires, alors que les organisateurs donnent le ton en tentant d’établir des thématiques et des types de comportement. Lors de chacune des « journées d’ouverture » des rassemblements nationaux d’Inuvik et de Halifax, la commission a présenté un film constitué de fragments de témoignages tirés de rencontres communautaires ayant eu lieu lors des semaines précédentes. Disposant d’heures de témoignages enregistrés, la commission a été en mesure de choisir ces moments qui résonnent, les « sound bites » qui saisissent non seulement ce que le témoin essaie de dire, mais surtout ce que la commission cherche à transmettre à ceux qui s’apprêtent à livrer ensuite leur propre témoignage. Ces récits sélectionnés mettent l’accent sur les thèmes de la perte et de la souffrance, tant à l’école que dans des vies adultes brisées par cette expérience (tout en faisant preuve de retenue et d’un certain sang-froid). Le film se termine par la narration d’une histoire positive de guérison et de redécouverte de cet héritage culturel jadis destiné à la destruction par l’école, puis par un montage de danseurs, de tambours traditionnels et de femmes tenant des bébés.
La majorité des participants qui ont comparu devant la commission après la diffusion de ce film avait inscrit leurs noms sur une liste ouverte de témoins. Ils étaient inconnus des commissaires, et par conséquent, leur témoignage était somme toute imprévisible. Toutefois, avant qu’ils ne soient entendus dans l’ordre de leur inscription, on présenta une série de témoignages préparée à l’avance par la commission. Une manière de donner son récit, ponctué d’élans théâtraux, y est présentée par des individus préalablement choisis par la commission afin qu’ils livrent leur témoignage à un comité invité. Il semble que ce lot de témoignages ait été choisi principalement parce que ces personnes avaient déjà effleuré les thèmes mis de l’avant par la commission. Cela fut reconnu de manière explicite par les maîtres de cérémonie lors du rassemblement national à Halifax, qui ont présenté la première intervenante, Isabelle Knockwood, Footnote 15 spécifiant qu’elle y était « pour donner le ton, le contexte ». Footnote 16 Lors des cercles des commissaires, un exemple à suivre est ainsi offert aux intervenants volontairement inscrits, que ce soit sous la forme de témoignages joués, ou répétées et choisis à l’avance.
Avec ces performances, une forme narrative est développée et devient un modèle pour les témoignages suivants. Les divers expériences et souvenirs personnels des pensionnats seront ainsi triés, remis en ordre et alignés sur ce modèle narratif contemporain. Agissant comme gabarits, ils sélectionnent et organisent les histoires individuelles dans une trame narrative, représentant une image précise du passé. Bien que les récits évoquent de diverses manières la connaissance du passé, ils ne peuvent être confondu avec la connaissance elle-même. Autrement dit, il y a plusieurs façons de se représenter, et surtout, en ce qui nous concerne ici, de raconter le passé. Certains récits sont plus appropriés et dominent dans certains contextes ou situations. Les détails qui ne s’enlignent pas avec cette trame sont alors perçus comme inappropriés, et conséquemment censurés. Footnote 17
La littérature sur les processus de mémoire et d’oubli nous indique depuis longtemps que les événements du passé, les souvenirs que les gens en ont, sont des constructions contemporaines qui sont très souvent de nature collective. Footnote 18 Dans le contexte de la CVR, cette affirmation est d’autant plus vraie : les processus de remembrance et d’oubli opèrent dans des formes rhétoriques précises et organisées, certaines versions sont automatiquement sanctionnées, exclues, tandis qu’émerge dans le cadre collectif la « bonne façon » de raconter, au bon moment. Footnote 19 Une version « officielle » de l’histoire des pensionnats émerge alors, celle qui doit être racontée par les survivants dans les cercles de la CVR.
La catégorie de survivant (parfois écrit Survivant, avec une majuscule honorifique) n’est pas basée sur une forme de tradition partagée par tous, mais bien sur l’expérience commune par laquelle leurs traditions furent interrompues. Dans son usage général, il s’agit d’un nouveau concept identitaire issu de processus de lobbying juridiques, litiges et efforts pour une guérison collective et une redéfinition de l’histoire. Il était évident, aussi bien lors des témoignages au cercle du commissaire que dans le contexte informel du lobby et des corridors du centre de conférence, que les survivants forment des groupes de soutien bien soudés. Les survivants se démarquent lors des événements de la commission par leurs tee-shirts et les cartes d’identification qu’ils portent autour du cou, lesquels les privilégient et les distinguent des autres participants. Les mots les plus souvent entendus aux divers comptoirs d’information et de distribution de tels items étaient « êtes-vous un survivant ? » et « ceci est pour les survivants seulement ».
Ce lien privilégié était aussi visible lors de l’audition des témoignages; des survivants se tenaient parfois ensemble au micro et se soutenaient l’un l’autre au moyen de gestes de consolation. Un des survivants, Gus Joshua, a souligné dans son témoignage à la commission : « C’est comme un lien secret, parce que nous vivons tous avec cette douleur ». Footnote 20 Rose-Marie Prosper abonda dans le même sens : « Je considère tous les survivants comme des membres de ma famille . . . Je les appelle frère, soeur, même si nous ne sommes pas parents ». Footnote 21
Lors des événements médiatisés que sont les cercles du commissaire, ceux qui sont ainsi soudés se soutiennent les uns les autres pendant leurs témoignages, apparaissent souvent ensemble à la table et leurs noms se suivent l’un après l’autre sur la liste de l’animateur. Dans de telles circonstances, il devient évident que les actes de témoignages sont des mécanismes à travers lesquels les anciens pensionnaires s’identifient en tant que groupe. Ils se nomment, s’affichent et ont des droits et privilèges particuliers dans le cadre des activités de la CVR. Le fil conducteur principal de cette nouvelle identité se situe dans le passé traumatique de la souffrance et dans les perspectives présentes et futures de guérison. À travers leur participation aux activités de la CVR, les survivants construisent une mémoire collective, issue de récits et autres formes de représentations de leurs expériences du passé dans les pensionnats. Les événements nationaux de la CVR attirent l’attention de tout le pays; les survivants se déplacent d’un océan à l’autre pour y assister. L’enregistrement vidéo et la diffusion à grande échelle des témoignages (caméra web en direct et mis sur le site internet de la CVR) permettent d’élargir le cercle d’appartenance à la catégorie de survivants à travers le pays d’une façon cohérente, malgré les différences culturelles. Les Inuit, Métis et Premières Nations, habituellement distincts historiquement et culturellement, mais aussi par rapport à la structure de leurs pensionnats et leurs modes de guérison, se rejoignent quand même sous la bannière des survivants. Footnote 22 La catégorie de survivants correspond ainsi à bien plus qu’un simple réseau de groupes de soutien ; c’est aussi une catégorie identitaire qui est parvenue à incarner les thèmes de récits communs au cours de la CVR.
Un artéfact de la mémoire
Des témoignages sont aussi sollicités à travers des objets matériels qui évoquent les expériences dans les pensionnats et l’héritage de ce passé. Il s’agit d’objets souvenirs, comme des photographies ou d’items provenant des pensionnats, ou bien des créations artistiques actuelles. D’ailleurs, on peut lire sur le site internet de la CVR un appel à la soumission d’œuvres d’art, où des thèmes bien précis sont suggérés : « La Commission invite les artistes à soumettre des œuvres relatives aux excuses, à la vérité, à l’oppression culturelle, au génocide culturel, à la résistance, à la résilience, à la spiritualité, au souvenir, à la revitalisation et au rétablissement de la culture et de la fierté autochtones. [. . .] Selon la Commission, la collecte d’œuvres d’art est une façon importante et concrète de faire ressortir la vérité, de témoigner des répercussions de l’expérience des pensionnats indiens, et ainsi, paver le chemin vers la réconciliation ». Footnote 23 Ici encore, dans une forme cependant différente—matérielle plutôt que discursive—un type particulier de témoignage est encouragé, orienté vers la souffrance, la victimisation, et menant enfin vers la guérison.
Étant donné la façon dont cet appel est formulé par la CVR, il serait erroné de traiter ces œuvres matérielles comme des symboles représentant fidèlement des événements tels qu’ils ont été vécus dans les pensionnats, et leurs répercussions subséquentes dans la vie des survivants et de leurs familles. Au contraire, cet appel à soumissions artistiques aura plutôt l’effet de forger, de construire une série de représentations conformes à un modèle précis. Les œuvres ainsi produites ne reflètent pas ; au contraire, elles définissent et reconstruisent un passé, sous une forme spécifique, prescrite par la collectivité des survivants et la CVR elle-même. Footnote 24
Ici, la boîte sculptée pour la commission par Luke Marston, artiste originaire de la côte Nord-Ouest, incarne et façonne même les thèmes dominants de la commission. Cette boîte fait aussi partie de la mise en place des modèles, et vient structurer et appuyer un type de témoignage précis. L’artiste a voulu représenter sur cette œuvre sa grand-mère qui a fréquenté le pensionnat de l’Île Kuper, en Colombie-Britannique. Cette dernière avait les doigts tordus, séquelle de son séjour dans le pensionnat: une religieuse l’aurait projetée dans les escaliers, brisant ainsi ses doigts, et faute de soins convenables, ses doigts ont guérit dans une position anormale. La boîte symbolise la grand-mère (son visage en larmes et ses doigts brisés), mais l’artiste souligne qu’elle représente aussi tous les aînés qui perdirent leurs enfants et qui furent persécutés ou arrêtés lorsqu’ils tentaient de les retenir. Au-dessus de la grand-mère, quatre croix représentant le christianisme qui, selon l’artiste, a mené au mouvement des pensionnats. Les autres faces de la boîte représentent un Inuk entouré d’aurores boréales (qui représentent les ancêtres Inuit, selon l’artiste) et un jeune Indien avec une coupe de cheveux traditionnelle et maquillage de guerre (image de résistance aux pratiques hygiéniques des pensionnats culturellement offensantes). Au dessus de cette image, on peut voir le symbole des Métis. L’inclusion d’images métisses et inuit sert de rappel évident de l’expérience commune de pensionnats par tous les peuples autochtones. Cette expérience commune se manifeste spécifiquement dans l’image de la grand-mère, dont les doigts brisés sont tournés bien en évidence vers l’audience lors de chaque rencontre, un rappel aussi puissant qu’éloquent des abus qui ont eu lieu dans les écoles et de leurs effets durables. Dans ce cas, la représentation matérielle de la souffrance, de la résilience et de la guérison culturelle se voit en plus conférer les caractéristiques du pouvoir sacré et du rituel. Cette boîte est utilisée lors des cercles des commissaires à titre de dépôt pour d’autres pièces tels des livres, des documents, des DVD, et autres objets pouvant rappeler les écoles, comme (un des premiers articles déposés lors de l’événement d’ouverture à Winnipeg) une couverture de laine sous laquelle dormaient jadis des enfants dans une école.

Figure 1 Boîte sculptée pour la commission par Luke Marston.
Dans les rencontres suivantes, cette boîte semble avoir hérité d’une dimension cérémoniale. La boîte sculptée, hermétique et à l’épreuve de la vermine, autrefois utilisée pour le stockage de vivres tel l’huile d’eulakane (poisson-chandelle) ou le poisson séché, ainsi qu’à titre de contenant protecteur pour les vêtements rituels, devient, dans le contexte des audiences de la CVR, un réceptacle sacré unissant les commissaires aux participants. À chaque rencontre, après les prières d’ouverture des aînés autochtones, inuit et métis, ainsi que les discours des commissaires et de leurs invités, un animateur entretient l’auditoire au sujet de la signification voulue des symboles et du pouvoir sacré de la boîte.
Parfois, une forme de respect est exprimée envers la boîte par ce qu’on pourrait appeler un rituel de déposition. Les participants et les commissaires tiennent chacun un objet qu’ils disposent ensemble sur une couverture étendue devant la boîte, l’exposant ainsi au public, ou ils le déposent directement dans celle-ci, arborant habituellement un air impromptu de respect. Les objets ne sont pas balancés ni jetés dans la boîte. Les mouvements du corps, les gestes, la lenteur voulue, ainsi que les sourires et les étreintes suivant le dépôt font ressortir les caractères sacré et extraordinaire du processus.
Il est intéressant de penser à cette boîte en utilisant les travaux de Gell Footnote 25 en matière d’anthropologie de l’art : une œuvre qui non seulement transmet l’intention de l’artiste, mais aussi qui a des effets particuliers sur l’audience, à travers ses formes, couleurs, textures et le contexte où elle est présentée. Cette boîte ne fait pas que représenter les souffrances vécues dans les pensionnats (et celle en particulier de la grand-mère de l’artiste), les ancêtres, la résistance, les identités et traditions perdues et recherchées ; elle interpelle l’audience, rassemble les divers groupes culturels, et les invite à se rappeler et partager une sorte de souvenir en particulier, sur un ton particulier : celui de la souffrance, de la résistance, et de la commémoration.
Afin d’éviter les distractions et pour attirer l’attention (les anthropologues l’ont reconnu depuis longtemps), il n’y a pas de meilleure manière que la transmission de messages grâce à la représentation rituelle mise en contexte par des prières et des sermons. La mise en contexte explicite de ce rituel fait en sorte que l’attention de l’auditoire se centre sur la symbolique de la boîte dès qu’on y dépose un objet. Qui plus est, ce rituel fixe les témoignages dans une sorte d’invulnérabilité ontologique. Aucune divergence d’opinion ni récit historique alternatif pourvus d’un grand pouvoir de persuasion ne peut émerger devant cette infaillibilité perçue de la vérité sacralisée. Le contexte performatif dans lequel cette boîte est présentée à l’audience immédiate et au public de la CVR a pour effet non seulement de laisser une empreinte durable dans la mémoire des gens, mais aussi de provoquer immédiatement l’effet voulu : le souvenir sous forme matérielle de la souffrance vécue dans les pensionnats, et son partage avec la collectivité, par la CVR. Footnote 26
Exposer les différences
Lors des rassemblements nationaux d’Halifax et de Saskatoon, une grande pièce appelée « le lieu d’apprentissage », mettait en concurrence différents récits historiques. Contrairement aux thèmes dominants des témoignages du cercle des commissaires, un espace fut laissé—au moins temporairement—à des points de vue multiples. Les affiches d’une exposition de la Fondation autochtone de l’espoir montraient les liens entre les pensionnats et le déracinement territorial ainsi que les traumatismes associés à l’expérience dans les écoles. En contraste, la perspective historique des différentes Églises ayant participé au régime des pensionnats y était également exposée, et venait en quelque sorte contredire ce conformisme dominant.
Nos divers échanges avec des membres religieux de l’Église catholique ont mis en lumière leur désaffection envers les divers processus de la CVR, notamment ces rassemblements nationaux où ils pourraient, s’ils le voulaient, partager leur propre expérience dans les pensionnats et la perspective historique qu’ils en tirent. Par contre, comme nous l’a précisé cet Oblat, ils n’ont pas nécessairement foi en les audiences de la CVR :
Aujourd’hui, je me suis senti abusé par toutes les accusations—comment les appelez-vous?—allégations, faites contre moi. Même le fait d’être ici [à cette entrevue] est difficile pour moi. Les rencontres qu’ils ont en ce moment—comme appelez-vous ça?—vérité et réconciliation. Si vous me demandez mon avis, je n’y crois pas. Je ne crois pas la moitié de ce qu’ils disent . . . Dans mon pensionnat, pendant 5 ans je n’ai jamais été au courant d’abus physique ou d’abus sexuel. Des années plus tard, tout ça arrive et soudainement vous vous retrouvez criminel. Cela me rend furieux. J’ai perdu des heures et des heures de sommeil à cause de cette affaire. Footnote 27
Dans une lettre adressée au Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens (chargé de mettre en œuvre et d’administrer les réclamations pour sévices sexuels, sévices physiques graves et autres actes fautifs subis dans les pensionnats indiens, un processus conjoint à la CVR), l’archevêque Pettipas écrivit au nom de la Corporation des organismes catholiques signataires de l’entente sur les pensionnats indiens, à propos des modèles de témoignages présentés par les survivants devant les adjudicateurs : « Appliquer de tels standards du jour entraîne deux risques : la création d’une image irréelle de la vie idyllique des enfants des Premières Nations avant leur entrée dans les pensionnats autochtones, et la non moins irréelle description des pensionnats autochtones comme un environnement sinistre uniquement dirigé par des sadiques ». Footnote 28
Ces « standards du jour » sont identiques aux modèles de témoignages générés par la CVR. À travers les dires et écrits de ces membres religieux, il devient évident que les forums de témoignage de la commission de vérité ne laissent pas de place pour leur version de l’histoire des pensionnats. Sauf, justement, dans les lieux d’apprentissage. Au rassemblement de Halifax, une exposition de l’Église anglicane y incluait des photos d’enfants d’écoles prises dans le cadre d’activités de groupe telles, la luge, le patinage, le canot, mais aussi dans des poses plus formelles aux côtés de prêtes et de religieuses. Une vitrine gardait un dictionnaire micmac ainsi que deux livres de la bible, la Genèse et l’Exode, en version micmac : une réfutation matérielle de l’opinion souvent émise lors des témoignages voulant que l’une des visées assimilationnistes de l’Église fût d’éradiquer les langues autochtones. À Saskatoon, le Fonds anglican pour la guérison et la réconciliation a présenté une sélection de photographies issues des Archives du synode général, organisée selon les sous-titres suivants : « Jouer », « Dormir », « Apprendre », « Sports », « Couture », et « Retourner à la maison », montrant les élèves et les employés des pensionnats dans des moments agréables associés à ces mots. (Par contre, notons l’absence frappante de toute photographie relatant le « départ de la maison » ou « l’arrivée au pensionnat », deux des épisodes les plus souvent associés au traumatisme dans les témoignages de la CVR.)

Figure 2 Exposition de l’Église Anglicane, Halifax, 2011.
Les représentants des Églises présents aux rassemblements ne semblaient pas être conscients de la position conflictuelle de leurs expositions. Leur attitude tenait davantage d’une certaine fierté face à la qualité de leurs archives mises à la disposition du public, en particulier les survivants.
Ces expositions aux tons différents semblent être passées inaperçues (ou ont été ignorées) par la plupart des participants à l’événement. En revanche, l’attrait le plus populaire de ce lieu d’apprentissage fut les archives de photos des Églises, grâce auxquelles les anciens élèves ont pu pour la première fois se situer dans le passé et recevoir une confirmation de leurs souvenirs. D’anciens élèves ajoutèrent des noms (ou l’inscription « inconnu ») dans les marges de photos de groupes d’élèves accrochées aux murs. Ici, une forme plus tangible de solitude et l’absence d’un sentiment d’appartenance se dessine dans l’enthousiasme avec lequel elles furent surmontées.
Ici, la CVR prend un virage plutôt éducatif. À travers ces expositions, la commission présente et représente certaines versions de l’histoire des pensionnats. À Winnipeg et Inuvik, les « tentes d’apprentissage » exposaient un contenu semblable à celui de Halifax et Saskatoon. Il semble ici que la CVR veuille encourager la production de différentes versions de l’histoire des pensionnats, ou disons plutôt une histoire « objective », basée sur des « faits » (photos et archives à l’appui). Les archives des différentes Églises canadiennes, des kiosques préparés par Bibliothèque et archives Canada (distribuant entre autres un très dense et complexe guide de trente pages visant à expliquer la recherche sur les pensionnats auprès de cet organisme fédéral) et des ressources préparées par l’équipe de recherche de la CVR (par exemple, une sélection de références bibliographiques portant sur l’histoire et l’héritage des pensionnats, organisés selon les thèmes suivants : histoire générale, histoires de pensionnats en particulier, mémoires de survivants, l’héritage et la réconciliation, littérature, quelques sources sur les « boarding schools » aux États-Unis et des livres pour les jeunes). En gros, les lieux d’apprentissage s’efforcent de présenter les « faits historiques objectifs » des pensionnats et de leur héritage. Ceci donne parfois lieu à des représentations qui pourraient être perçues comme contradictoires par rapport au paradigme général de la CVR, mais tout est une question de perception et d’interprétation. D’ailleurs, lors de l’événement national de Winnipeg, une archiviste de l’Église Unie a commenté une série de photos d’archives: « Des pages et des pages d’enfants souriants qui contredisent leur douleur sous-jacente [. . .] Il est difficile de regarder ces photos en sachant ce qui est arrivé à ces enfants apparemment heureux ». Footnote 29
Pour leur part, les survivants qui entrent en ces lieux semblent plutôt rechercher leurs histoires personnelles. Ce n’est pas tant pour un intérêt dans « l’histoire objective », s’il en est une, des pensionnats, ou encore moins des différentes subjectivités et contradictions qu’elles peuvent contenir (ou à travers lesquelles elle peut être représentée). Il s’agit plutôt pour eux d’une recherche autobiographique extraite de ces représentations historiques (à travers la consultation d’albums souvenirs, par exemple), ou ajoutée à ces dernières (graffitis sur les photos de classe et les cartes géographiques).
L’attrait évident de ces archives photographiques et la manière dont les survivants interagissent avec elles—en y ajoutant leurs noms, celui des autres, en les personnifiant—nous présentent le témoin sous un autre angle, comme une personne s’inscrivant elle-même dans l’histoire afin de retrouver sa cohérence individuelle. Tout comme Feldman l’a affirmé, en référence aux témoignages sur la violence, il faut « porter attention aux conditions dans lesquelles ces récits prennent forme—l’impact politique que ces narrations reflètent, répliquent et autorisent—et aussi les circuits de grande envergure qui filtrent et consument l’artefact biographique. [. . .] Le témoignage a une densité et une ampleur doubles : c’est une fenêtre de visualisation historique et aussi un objet historique, dont l’émergence est facilitée par la douleur et la souffrance ». Footnote 30
« Et puisque je suis au microphone . . . »
Un des éléments les plus importants révélés par les modèles de témoignage du cercle du commissaire n’est pas tant les récits dominants qui y sont livrés et encouragés, mais plutôt les manières dont certains témoins refusent de s’y conformer, et les messages qu’ils communiquent. En effet, les digressions de certains témoins nous en apprennent davantage au sujet des raisons de leur participation à cet exercice public. Quand les témoins s’éloignent du modèle présenté, c’est généralement afin de parler d’une question autre que celle des pensionnats, mais qui leur a laissé un sentiment d’indignation comparable à leur expérience dans ces écoles. Par exemple, Emmet Peters, le premier à s’être inscrit sur la liste des témoins à Halifax, a commencé en se conformant au modèle préétabli. Il a d’abord fait allusion à des abus sexuels subis à l’école (« parfois la nuit, on ne sentait que cette mauvaise haleine et ne voyait que ces grosses mains »), à ses pertes de mémoire (« il y a des périodes dont je ne peux me souvenir. . . des années dont je ne sais rien »), à sa vie de jeune adulte (« des années après avoir arrêté de boire, je ressentais encore beaucoup de honte »), à sa guérison en s’établissant dans le Midwest afin d’apprendre les traditions des Lakotas (« j’ai finalement retrouvé la culture qui m’avait été enlevée ») et en fondant une famille selon les valeurs qu’il a découvertes parmi les Lakotas, loin de l’influence de l’Église (« l’accomplissement dont nous sommes le plus fiers est qu’aucun de nos enfants n’est baptisé ») ; Footnote 31 toutefois, ce qu’il semblait vraiment chercher à exprimer est le sentiment d’avoir été personnellement lésé par l’usurpation de la chefferie traditionnelle de l’Île-du-Prince-Édouard, quand le gouvernement fédéral a établi des élections pour le chef et le conseil. Il dit: « [J]e suis assez vieux pour me souvenir des agents indiens, et le plus triste est que je vois nos chefs se comporter comme des agents indiens ». Footnote 32 En concluant, il a fait lire par son neveu la notice nécrologique de son ancêtre, le Chef Joseph, datée du 8 juillet 1880. Celle-ci évoque les qualités d’un homme qui était à la fois un chasseur habile et un leader efficace, mais qui a été incapable de léguer en héritage ses fonctions de chef traditionnel, à laquelle, en différentes circonstances, Peters aurait lui-même été éligible.
Un autre moment du type « et puisque je suis au microphone . . . » s’est produit lorsque l’évêque Gary Gordon de Whitehorse fut appelé à témoigner par les Commissaires pour la deuxième fois de la journée, et ce, sans qu’il ne soit au courant qu’il se trouvait sur la liste des témoins. Il n’avait pas préparé sa présentation, le matin même il s’était contenté de lire une déclaration écrite. Le témoignage qu’il a livré dans ces circonstances s’est distingué du modèle de reconnaissance et de pénitence auquel on pouvait s’attendre. À la place, il a offert un récit à propos des programmes de guérison et de réconciliation pour les membres du clergé subventionné par son diocèse. Étonnamment, son récit a ensuite reproduit un modèle commun de témoignage des survivants, mettant l’accent sur la souffrance personnelle. Cependant, la source de la souffrance de l’évêque résidait dans son expérience à titre de personne associée injustement aux abus des pensionnats.
Une journée alors que j’étais un jeune prêtre et que je travaillais à Saskatoon, je conduisais en direction de l’hôpital pour visiter une famille. Quelqu’un était malade. Je portais alors le col romain. Quand je me suis arrêté à un feu de circulation, un type qui marchait à proximité a aperçu mon col et m’a soudainement montré son derrière. Vous savez, enfin, pour me montrer ce qu’il ressentait. Je ne l’avais vu ni rencontré auparavant, ce devait être la colère qui sortait. Une autre fois, alors que je me promenais toujours avec mon col, quelqu’un me fit un doigt d’honneur. Je n’avais jamais rencontré cette personne auparavant. Ce sont de petites choses, vous savez, enfin, qui s’accumulent avec le temps . . . À un moment donné je trouvais difficile de porter ce col, car tant de haine lui était dirigée. C’est peut-être anodin, mais cela témoigne de la façon dont nous avons souffert; nous souffrons aussi. Footnote 33
Ici, les auteurs de ces injustices étaient des autochtones qui, dans leur colère, l’ont associé avec la seule douleur qu’ils étaient alors capable d’exprimer. L’expression de leur souffrance était alors la cause de la sienne, son sentiment de rejet malgré son service et ses sacrifices, l’indignité d’être exposé à l’insulte et l’obscénité, desquels suivit sa réticence à porter le col, le symbole de sa foi et de son appartenance.
Cette forme de transgression du modèle dominant de témoignage nous en apprend au sujet du pouvoir d’attraction du cercle, de cette force qui pousse des témoins (lesquels parcourent parfois de grandes distances partant de communautés autochtones ou inuit isolées) à vaincre leur réticence à participer à ce forum intimidant. Le cercle du commissaire est un lieu propice à l’expression de profonds sentiments d’injustice, et ce, peu importe si l’expérience en pensionnats autochtones en est la cause immédiate. C’est un moyen visant à éliminer l’indignation, une émotion trop peu reconnue, parfois fortement causée par les injustices subies. Et c’est seulement en ayant égard à une telle émotion forte—un profond et suffocant sentiment d’injustice—que nous pouvons mieux comprendre les récits acceptables de souffrance des participants, mais aussi les transgressions de ces modèles de témoignages porteuses d’expériences qui outrepassent le mandat de la commission.
Conclusion
Dans cet article, nous avons exploré certaines facettes des témoignages, y compris leur contexte matériel, qui contribuent de manière tangible à la production de différentes formes de mémoire et de conception de l’histoire. Nous avons concentré notre attention sur les modèles que les témoins ont tendance à suivre (ou desquels ils s’éloignent parfois de manière révélatrice) dans la formation de thèmes dominants dans leurs récits. Une multitude de techniques de persuasion sont utilisées afin de former un récit historique de l’expérience des pensionnats, ce qui inclut la production matérielle d’idées, l’évocation artistique de la souffrance ainsi que l’exposition d’objets relatant l’histoire de certaines écoles. Ensemble, ces formes de connaissance produites dans le cadre des travaux de la CVR sont la source d’un récit émergent et simplifié des conséquences des pensionnats autochtones. En effet, des artifices historiques, prenant la forme d’un saisissant dualisme de souffrance et de guérison, sont produits au travers des récits prédominants (et les exclusions) au sein des témoignages de la CVR. Plus particulièrement, la possibilité limitée d’exprimer des expériences ou opinions au couru cercle des commissaires donne lieu à une histoire nucléée, dans laquelle un éventail d’informations et de récits sont réduits à une essence de violence systémique et de traumatisme. Tous les récits livrés aux commissaires de la CVR renvoyaient à une forme iconique de victime, qui a vécu la pire sorte d’injustice et d’abus aux mains d’une société dominante représentée souvent de manière anthropomorphe par « l’Église » ou « l’État ».
Les concepts de culture et de guérison exposés à la commission sont d’abord formés par une inversion épistémologique : au lieu de commencer avec des témoignages pour ensuite passer aux conclusions basés sur ceux-ci, la CVR débute avec des constatations ainsi que des suppositions au sujet de la nature des traumatismes et des conséquences du témoignage public. Il est alors possible de considérer les travaux de la CVR comme un processus par lequel des expériences hétérogènes sont façonnées en un jugement tacite et préétabli, un récit historique commun et une forme d’expérience personnelle. De la masse d’expériences possibles, on a choisi celles qui correspondent à un récit privilégié, lequel a ensuite été matériellement modelé à l’endroit où les témoignages sont livrés. Un modèle institutionnalisé pour se présenter en public a ainsi réduit l’éventail d’approches possibles à une appartenance collective, au traumatisme ainsi qu’à la guérison.
Si les épisodes où les témoins ont pu s’éloigner du modèle présenté au début de chaque rencontre, référant à d’autres injustices correspondant à la même logique (une arrestation injuste, l’usurpation de l’autorité d’une chefferie traditionnelle et même la souffrance d’un évêque exclu socialement), ils ne contredisaient pas pour autant les principes élémentaires du traumatisme, de la douleur et de l’injustice résultant d’une politique étatique visant la marginalisation ou l’élimination du statut distinct, collectif et d’autodétermination des peuples autochtones. Malgré les encouragements des commissaires, il n’y a pratiquement pas eu de témoignage évoquant des complexités ou contradictions (une absence particulièrement remarquée à l’extérieur des murs de la commission par les prêtres et les religieuses qui ont travaillé dans les écoles), des formes d’amour institutionnalisé, le jeu, l’apprentissage ou bien l’autonomisation. Une partie de la frustration exprimée par les prêtres et les religieuses avec qui nous avons parlé à l’extérieur du contexte de la commission découle de leur sentiment que ce type d’histoires positives a existé en tant que caractéristique essentielle des écoles (ils pourraient leur dire eux-mêmes s’ils pouvaient se sentir en sécurité de le faire, à l’instar de certains anciens étudiants), mais qu’on n’a pas rendu justice à ce genre de témoignage, à l’exception peut-être de quelques très brèves allusions dans les récits présentés.
Un éclaircissement sur ce phénomène d’exclusion peut être vu dans la nécessité, qui semble universelle, de donner un sens moral aux récits historiques ainsi produits. Il semble que la signification d’une séquence d’événements historiques ne peut apparaitre qu’en les plaçant dans un scénario, une intrigue morale, sans quoi il s’agirait de simples annales ou chroniques de la réalité, décousues et dénudées de sens. Footnote 34 L’aspect narratif des témoignages de la CVR, qui part de la souffrance, à l’indignation, en passant par la résilience et finalement la guérison est empreint d’une impulsion morale qui sanctionne automatiquement toute forme de récit qui divergerait de cette trame. La valeur morale attachée aux formes de représentations historiques produites dans le cadre de la CVR est donc étroitement ficelée à leur trame narrative sélective et hautement organisée. Cette moralité en est autant la source que la fonction principale.
En poussant ces idées un peu plus loin, nous pouvons supposer que le paradigme de la souffrance qui est devenu apparent dans les audiences de la CVR s’inscrit aussi dans un contexte historique autre en ce qu’il est, en particulier, le résultat de dynamiques de lobbying juridique, fort efficaces, de la part les peuples autochtones en Amérique et, plus globalement, dans des mouvements internationaux des peuples autochtones. Dans des recours aussi bien nationaux qu’internationaux, les peuples autochtones ont récemment connu des succès politiques grâce à leur mobilisation dans de nouveaux processus de lobbying juridique, ainsi qu’en formulant des demandes dans le cadre d’audiences publiques afin d’en tirer avantage auprès du judiciaire, du législatif et des gouvernements. C’est un procédé qui exige de mettre l’accent de manière sélective sur les pires abus de la part de gouvernements ainsi que sur les qualités les plus pittoresques et colorées des plaignants. Ainsi, ces revendications sont « lancées » vers des publics impersonnels et abstraits de consommateurs de souffrance et d’injustice ; les valeurs d’injustice et de traumatisme d’une part, ainsi que de vitalité culturelle et de spiritualité auxquelles le public est appelé à réagir, sont précisées et reformulées selon des préférences tant supposées qu’ouvertement affichées. Footnote 35 Les dépositions des témoins de la CVR peuvent être considérées comme étant en accord avec ces dynamiques de lobbying.
Cette constatation présente un autre indice de l’origine du paradigme d’exclusion fondé sur la souffrance qui a émergé au cours des témoignages de la CVR. En considérant les transgressions des modèles en tant qu’éléments fondamentaux des témoignages, nous pouvons dès lors constater que le thème de l’injustice peut s’appliquer à un grand éventail de témoignages, et ce, plus que toute autre sujet. Les thèmes de la CVR que les témoins ont privilégiés vont au-delà du mandat de celle-ci; ils incluent une variété de formes étatiques d’exclusion ayant toujours cours, la dépossession et des atteintes à la fierté des communautés dont sont issus les participants. La CVR ne traite pas seulement de pensionnats. Elle offre un lieu où l’on peut formuler ses doléances, lesquelles débordent parfois des modèles visant à circonscrire les témoignages à l’intérieur de certaines limites. Les sujets privilégiés par les témoins et leurs auditoires vont au-delà du mandat de la commission, afin d’inclure une variété de formes contemporaines d’exclusion, d’oppression, de dépossession, de racisme, et assauts à la fierté de la communauté à laquelle ils appartiennent. Ce phénomène nous amène à penser que la commission est une occasion pour les survivants d’exprimer leurs expériences courantes, faisant fi des frontières séparant ces dernières de leurs souvenirs des pensionnats. Le thème de l’injustice, omniprésent à la CVR, couvre donc un éventail de témoignages plus large que quiconque aurait pu l’imaginer.
Parallèlement, la CVR est un véhicule permettant aux participants d’articuler une compréhension de leur passé. Cela soulève la possibilité qu’une histoire réifiée et médiatisée des traumatismes passés vienne à définir l’identité collective et, par conséquent, qu’elle crée un espace où les expériences individuelles peuvent s’exprimer à l’intérieur d’un cadre matériellement constitué d’abus de pouvoir, de dépossession et de victimisation collective. Pour emprunter la formulation appropriée de Laurence Kirmayer, cette forme de traumatisme historique est une « façon de configurer la mémoire culturelle, reliant l’histoire de chaque individu aux blessures collectives d’un peuple ». Footnote 36 C’est dans cette optique d’expérience individuelle de vie, prise dans le contexte de préjudice collectif, que la CVR canadienne a donné forme à des points de vue sélectivement articulés sur l’histoire de l’Église et de l’État, les préjudices institutionnalisés et sur l’identité collective.