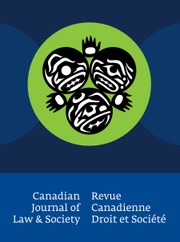1 Introduction
Dans la grande majorité des pays occidentaux, la loi prévoit que l’un des époux, généralement le mari, ait à payer une somme d’argent (qui peut prendre une forme différente selon les pays Footnote 1 ) ou à donner une partie de son patrimoine à l’autre époux, généralement la femme, après le divorce. La justification de ce type de transfert, qui porte des noms différents d’un pays à l’autre Footnote 2 , a pendant très longtemps reposé sur la dépendance financière de l’épouse ou sur la faute du mari qui avait commis l’adultère. Elle s’inscrivait dans une vision du mariage où les liens entre les époux étaient considérés comme indissolubles. Or, à partir des années 1970, une telle justification a commencé à perdre de sa pertinence. En effet, les pays occidentaux ont été marqués par une double évolution. D’une part, les normes sociales vis-à-vis des femmes ont évolué, ce qui s’est traduit en particulier par leur entrée massive sur le marché du travail. D’autre part, la conception du mariage a évolué, ce qui s’est accompagné d’une réforme du droit du divorce avec la substitution du divorce sans faute au divorce pour faute (permettant une rupture unilatérale du mariage). Dans ce contexte, le principe d’obligation alimentaire entre ex-époux est devenu moins nécessaire, voire même obsolète. Pour autant, les pays occidentaux n’ont pas remis en cause l’existence de cette obligation alimentaire et les magistrats ont continué à fixer des pensions alimentaires pour époux, alors que beaucoup d’entre eux ont profondément modifié, dans le sens d’une simplification des procédures, le droit du divorce.
La disparition des conditions traditionnelles de l’obligation alimentaire envers l’un des ex-époux a conduit certains juristes anglo-saxons, au tournant des années 1990, à questionner les fondements mêmes de cette obligation. Ainsi, en 1989, le juriste américain Ellman écrivait « [a]lthough alimony has long been a feature of divorce law, there is no theory explaining why either spouse should have a financial obligation to the other that survives their marriage » (3). C’est dans l’analyse économique, et ses différents courants de pensée, que ces juristes ont trouvé des justifications théoriques au maintien d’une telle obligation alimentaire. Cet article propose de revenir sur les deux principales approches qui ont retenu l’attention de ces juristes, tout en évoquant les débats qui les ont opposés sur ce sujet. Ainsi la première partie est consacrée à la justification de cette obligation sur le fondement de l’efficience économique. Cette approche, qui est issue de l’économie de la famille, considère que cette obligation permet de favoriser les investissements familiaux pendant le mariage. La seconde partie présente une approche qui s’appuie, pour sa part, sur l’économie des contrats. Pour cette dernière, l’obligation alimentaire joue un rôle de protection contre l’opportunisme de l’un des époux et plus généralement celui de réparation, à la suite de la réalisation d’un investissement spécifique pendant le mariage par l’un des époux.
Cette présentation des justifications théoriques et économiques de l’obligation alimentaire entre ex-époux dans le discours juridique américain prend tout sens dans ce numéro spécial consacré aux compensations financières après divorce en Europe. En effet, cela permet, par contraste, de souligner l’une des spécificités de la doctrine européenne concernant le traitement des conséquences du divorce. Alors que les juristes et praticiens nord-américains se sont naturellement tournés vers l’analyse économique pour trouver des fondements à l’obligation alimentaire envers l’un des ex-époux, une telle démarche n’a pas été entreprise au sein de la doctrine européenne, comme on pourra le constater à la lecture des articles de Bouabdallah et Sayn et de Dandoy et collègues dans ce même numéro.
2 L’obligation alimentaire entre ex-époux justifiée par la théorie économique de l’efficience
L’approche par l’efficience permet de dépasser le caractère obsolète de l’obligation alimentaire entre ex-époux (II.1) en proposant de nouveaux fondements en cohérence avec l’évolution de la conception du mariage (II.2). Cela étant, ce type d’approche est également à l’origine de critiques, développées par des juristes féministes (II.3).
2.1 L’obligation alimentaire entre ex-époux : un concept juridique obsolète?
Dans la plupart des pays occidentaux, la conception traditionnelle du mariage a prévalu jusque dans les années soixante. Les normes de la société définissaient clairement le rôle des époux, le mari s’investissant principalement dans son activité professionnelle pour subvenir aux besoins financiers du ménage, tandis que l’épouse se consacrait pleinement à l’éducation des enfants et aux tâches domestiques. Les conséquences d’une rupture des liens conjugaux étaient tout aussi claires : la femme perdait son statut et le soutien financier de son mari, tandis que l’homme devait assumer l’entretien de son ex-épouse en partageant ses avoirs avec elle et en lui versant une compensation (Brinig et Crafton Reference Brinig and Crafton1994). Mais surtout, le divorce était lié à la notion de faute, et l’obligation alimentaire était considérée comme la sanction de cette faute Footnote 3 . La pension perçue devenait alors essentiellement une forme de dommages-intérêts pour la perte du profit espéré résultant du défaut au contrat. En effet, le mariage supposait, de la part du mari, une promesse de soutien économique à vie faite à l’épouse. Si le mari décidait par la suite d’abandonner cette relation ou était responsable de la rupture en ayant commis un délit conjugal, l’épouse « innocente » pouvait revendiquer ce qu’on lui avait promis par le mariage, c’est-à-dire la sécurité économique pour la vie (Rogerson Reference Rogerson2004).
Dans les années soixante-dix, le divorce sans faute est autorisé et remplace progressivement le divorce pour faute. L’obligation alimentaire entre ex-époux perd alors sa justification première. Plus précisément, comme le divorce est désormais possible sans référence à la faute de l’un ou l’autre des époux, la sanction via le versement d’une pension n’est plus justifiée Footnote 4 . Au final, comme le souligne Singer (1994, 2425) : « [d]ivorce reform thus left alimony in somewhat of a theoretical vacuum » parce que les explications fondées sur le genre ou sur la faute ne correspondent plus à la vision moderne du mariage. Et de conclure avec Ellman (1989, 5) que « [the] answer is that alimony’s form has remained the same while its function has changed ». En effet, dans la plupart des pays, malgré des normes sociales et juridiques modifiées, les juges ont continué à fixer des pensions au bénéfice des ex-épouses, notamment pour répondre à des situations financières difficiles. Or d’un point de vue juridique, Ellman (1989, 5) explique que « [t]he financial need of one spouse at the termination of a marriage does not lead inevitably to the conclusion that the other spouse must meet that need. A theory of alimony must explain why spouses should be liable for each other’s needs after their marriage has ended ». En outre, si l’argument du besoin répond à une logique financière (lorsqu’il s’agit de subvenir aux besoins d’une ex épouse qui s’est consacrée uniquement à son foyer), il ne constitue pas une justification véritablement économique dans la mesure où il ne conduit pas à mobiliser ni les outils, ni les notions des économistes (optimalité des comportements, efficience, incitations, etc.).
Pour fonder une théorie de l’obligation alimentaire entre ex-époux, il convient alors de réfléchir à la raison qui conduit au maintien de cette obligation liée au mariage. Dit autrement, quelle justification trouve-t-on dans le mariage (donc ex ante par rapport au divorce) pour fonder le versement d’une pension après la fin de l’union (donc ex post)? En économie, cela revient à se demander quelles sont les incitations créées par cette pension versée ex post, qui ont une influence souhaitable sur les choix et le comportement des époux pendant le mariage c’est-à-dire ex ante. La question n’est alors pas de redistribuer des richesses entre les membres du couple dans une logique d’équité, mais bien de réfléchir à la façon dont cette pension crée les « bonnes » incitations, dans une logique d’efficacité au sein des couples. Si cette approche est courante en économie, elle est en revanche moins fréquente dans le raisonnement juridique. Pourtant, elle va susciter l’intérêt d’Ellman, qui va mobiliser l’analyse économique non seulement comme un outil mais aussi comme un moyen de renverser totalement la logique de l’analyse juridique en regardant les effets incitatifs de la pension (impact sur les comportements) plutôt que les effets redistributifs (impact sur la redistribution des richesses). La redistribution des richesses n’est alors plus perçue comme une fin (de sorte que l’on ne raisonne pas en termes d’équité) mais comme un moyen d’induire les « bons » comportements, entendus comme ceux qui maximisent la richesse totale du couple (considéré comme le critère d’efficience).
2.2 La pension alimentaire pour ex-époux, un moyen d’atteindre l’efficience
Le premier article en sciences économiques sur l’obligation alimentaire entre ex-époux a été publié, de façon peu surprenante, par l’un des co-auteurs de Becker qui avait le premier considéré les époux comme des individus rationnels se comportant au sein du mariage comme au sein d’une firme (Becker Reference Becker1973, Reference Becker1974). Suivant la logique beckerienne, Landes (Reference Landes1978) élabore le premier modèle théorique consacré à cette obligation alimentaire en économie, dont le titre est à la fois clair et ambitieux puisqu’il s’intitule : « Economics of Alimony ». Landes y poursuit un double objectif : d’une part, elle souhaite vérifier théoriquement la relation entre la définition d’une pension efficiente et ses déterminants économiques (durée du mariage, nombre d’enfants, capacité de gains de l’épouse) en construisant un modèle de production du ménage; d’autre part, elle vérifie empiriquement que la pension varie avec la spécialisation de l’épouse dans les tâches domestiques (en fonction des déterminants économiques identifiés préalablement) mais aussi avec les opportunités de carrière auxquelles elle a renoncé.
Son modèle est de nature normative dans la mesure où l’objectif affiché de la pension est clairement l’efficience économique. En effet, selon Landes (1978, 36), « [t]he role of alimony is to compensate the wife for the opportunity costs she incurs by entering and investing in the marriage. As such, the award and enforcement of alimony payments by the courts encourage optimal resource allocation within marriage, increase gain from marriage, and encourage the formation, productivity, and stability of marriage ». Pour comprendre cette conclusion, il faut se souvenir que, dans ce type d’analyses économiques, le mariage est perçu comme un appariement entre un époux et une épouse dont l’objectif consiste à maximiser le revenu attendu commun, défini au sens large (c.-à-d. incluant les revenus des deux conjoints mais aussi des éléments aussi divers que l’éducation des enfants, la préparation des repas et toutes les activités qui contribuent au bien-être de la famille). Le modèle est construit autour de trois hypothèses : la production du ménage est spécifique en ce sens qu’elle perd toute valeur en cas de divorce, les biens domestiques et les revenus de la femme sont produits uniquement par le temps que la femme y consacre, les gains du mari sont produits par le temps qu’il consacre à son travail mais aussi par le temps que son épouse consacre aux tâches domestiques.
Sous ces hypothèses et à partir d’un modèle à deux périodes, le degré optimal de spécialisation dans le foyer (mesuré par le temps consacré aux tâches domestiques) peut être déterminé en maximisant la valeur actuelle du revenu total du couple, d’abord sans inclure la probabilité de divorce Footnote 5 , puis en l’intégrant au cours de la deuxième période Footnote 6 . Sans surprise, plus la probabilité de divorce est élevée, plus le degré optimal de spécialisation est faible aux deux périodes Footnote 7 . Dans ce contexte, la pension est justifiée lorsqu’il existe des coûts de transaction correspondant aux coûts de négociation et d’exécution des transferts de richesse entre les membres du couple pour atteindre le niveau de spécialisation optimal. Plus précisément, si le revenu du ménage est totalement divisible, si les transferts se font sans coût et si la probabilité estimée de divorce est identique pour les deux époux, le niveau optimal de spécialisation sera obtenu indépendamment de l’attribution de la responsabilité en cas de divorce Footnote 8 . Inversement, des coûts de transaction positifs (en raison d’asymétries d’information, de biens publics indivisibles comme les enfants notamment) peuvent empêcher d’atteindre le niveau de production domestique optimal. C’est notamment le cas lorsque l’investissement de l’épouse dans son foyer ne génère pas de profits immédiats et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas récompensée pour son investissement dans l’avenir de sorte qu’elle s’investit moins dans son foyer. C’est également le cas lorsque l’épouse s’investit dans la carrière de son époux et lui permet d’augmenter ses revenus. Elle sera en effet disposée à faire cet investissement via une spécialisation accrue dans les tâches domestiques uniquement si elle espère pouvoir bénéficier du fruit de cet investissement non seulement au moment où il est réalisé mais aussi à plus long terme. Dans ce contexte, la pension s’interprète comme une revendication contingente payable à l’épouse en cas de divorce qui lui permet de faire le choix de spécialisation optimale pendant le mariage. En d’autres termes, il existe un montant de pension qui garantit que l’épouse réalise l’investissement optimal dans son foyer, même s’il existe un risque de divorce et si les coûts de transaction sont positifs. La spécialisation résulte ainsi d’un processus de maximisation de la production domestique, à travers la détermination d’un prix implicite, la pension, qui incite les époux à se comporter de manière optimale.
L’analyse de Landes fournit la première justification économique à l’obligation alimentaire entre ex-époux fondée sur l’efficience : le rôle de la pension consiste à inciter les époux à choisir les niveaux optimaux de spécialisation de façon à maximiser la production domestique conjointe. D’un point de vue économique, la pension a donc un effet positif direct parce qu’elle incite les époux à adopter les comportements optimaux. L’analyse peut être prolongée pour identifier également un effet positif indirect. Plus précisément, selon Becker, Landes et Michael (1977), une spécialisation accrue et un niveau plus élevé d’investissement spécifique réduiraient la probabilité de divorce en augmentant le revenu conjoint par rapport au revenu que les époux percevraient en dehors du mariage Footnote 9 (la rupture est donc moins avantageuse). Cette opinion est partagée par Ellman (1989, 48), qui explique que « [w]hile a wife’s strategy of reducing marriage-specific investment may protect her from some financial loss if divorce occurs, it also increases the chance that divorce will occur and reduces the chance of marriage in the first place ».
2.3 Critiques de l’approche par l’efficience
La principale critique de l’application à l’obligation alimentaire entre ex-époux de la théorie de l’efficience a logiquement émané de juristes féministes américaines Footnote 10 en raison de la conclusion à laquelle elle conduit : en justifiant la spécialisation des femmes dans les tâches domestiques, la pension contribue à faire perdurer les inégalités de genre Footnote 11 . Ainsi, Singer (1994, 2437) explique que, « [f]or feminists, perhaps the most troubling aspect of the dominant economic theory of alimony is the theory’s reliance on the efficiency—and hence the desirability—of role specialization during marriage » Footnote 12 .
Ce résultat provient en réalité directement de l’une des hypothèses faites par Landes dans l’élaboration de son modèle de pension. La théorie de l’efficience est fondée sur le principe de l’avantage comparatif qui permet de conclure que la spécialisation de l’un des époux dans les tâches domestiques leur permet de maximiser leur production commune. Le problème n’est alors pas la spécialisation mais le caractère genré de celle-ci qui découle directement de l’hypothèse de Landes selon laquelle le mari peut consacrer son temps uniquement aux activités de marché (autrement dit au marché du travail) tandis que l’épouse est la seule à pouvoir allouer son temps entre les activités de marché et les activités hors marché (ici, son activité domestique). Par conséquent, comme le souligne Singer (1994, 2431), « [t]he efficient household, under this model, was one in which the husband specialized in market production and the wife specialized in domestic work » Footnote 13 .
Si cette hypothèse n’est pas justifiée par Landes, l’observation de la réalité peut néanmoins la conforter. En effet, la persistance d’écarts de salaires entre les hommes et les femmes à poste équivalent fait qu’elle n’apparaît pas totalement arbitraire et peut trouver des justifications économiques. C’est ce qu’évoque Ellman (1989, 46-47) lorsqu’il explique à propos de la spécialisation que « [w]here the husband’s work is more lucrative than the wife’s, this arrangement [wife carrying a disproportionate share of the domestic responsibilities] is economically rational ». L’économiste Parkman (2000, 43) parvient à la même conclusion : « [t]he lower average wages available to women make the mother the lower-cost provider of child rearing ».
Au-delà de la pertinence de cette hypothèse et des conclusions auxquelles elle conduit irrémédiablement en matière de spécialisation, cette justification pose problème selon Singer (Reference Singer1994), que ce soit dans ses fondements internes ou externes. D’un point de vue interne, l’analyse économique de l’obligation alimentaire entre ex-époux fondée sur l’efficience a considéré une spécialisation entre homme et femme plutôt qu’une spécialisation entre femmes. Cette critique est formulée également par d’autres juristes féministes (Carbone Reference Carbone1990; Brinig Reference Brinig1993), pour qui le ménage le plus productif de nos jours est celui dans lequel les deux époux travaillent à temps plein et confient l’entretien de leur foyer et des enfants à d’autres (le plus souvent des femmes), rémunérés à faible salaire. D’un point de vue externe, la critique repose sur les coûts psychologiques de la spécialisation. Ainsi, Brinig (Reference Brinig1993) explique que pour beaucoup de couples, un mariage efficient n’est pas caractérisé par un degré élevé de spécialisation mais plutôt par une situation où les deux membres du couple sont à la fois investis dans leur carrière professionnelle et consacrent un temps significatif à s’occuper de leurs enfants.
Face à ces critiques, d’autres analyses de l’obligation alimentaire entre ex-époux ont été proposées, recourant elles aussi à des concepts utilisés en économie mais relevant de la théorie des contrats. Elles s’écartent de la conception du couple comme « unité de production » pour privilégier une approche mettant l’accent sur la négociation et l’engagement.
3 L’obligation alimentaire entre ex-époux justifiée par la théorie des contrats
L’approche contractuelle permet également de justifier le principe d’une obligation alimentaire entre ex-époux. En considérant que le mariage, sous certains aspects, est assez proche d’une relation contractuelle de long terme, cette approche conduit à justifier la protection de la partie lésée par le comportement opportuniste de son co-contractant, par l’entremise du versement d’une pension (III.1). De manière plus générale, la théorie des contrats permet de lier fondement de l’obligation alimentaire entre ex-époux et montant de la pension (III.2). Ce type d’approche a fait lui aussi l’objet de critiques, notamment de la part des promoteurs de l’approche en termes d’efficience (III.3).
3.1 L’obligation alimentaire entre ex-époux, un outil pour réduire le risque d’opportunisme
Certains juristes considèrent que le mariage, à défaut d’être un contrat au sens purement juridique du terme, peut être considéré comme un engagement de nature contractuelle. Il va en résulter une proximité entre le mariage et certaines formes de contrats, notamment commerciaux, dans les problèmes qui peuvent se poser dans leur exécution. Ainsi, pour le juriste Cohen (1987, 267), « [p]recisely because marriage is a species of contract, many of the problems inherent in fashioning an efficient and equitable law of divorce, alimony, and property division are variations and special cases of the difficulties that surface in the enforcement of commercial contracts ». L’analogie du mariage à un contrat est fondée sur l’idée que le mariage pourrait être comparé à un partenariat entre les époux, au cours duquel ces derniers formuleraient des engagements l’un envers l’autre, de manière explicite (en particulier lorsqu’ils sont imposés par le droit comme le respect, la fidélité, l’assistance sur le plan moral, le secours sur le plan matériel) ou implicite (promesses faites entre les époux).
Néanmoins, le mariage présente aussi des caractéristiques qui diffèrent de celles d’un contrat commercial de long terme. Cohen (Reference Cohen1987) estime ainsi que même si le mariage a une valeur instrumentale (comme tout contrat de long terme) en ce sens que les époux peuvent être considérés comme des inputs permettant la production d’un output (conformément à l’approche beckerienne), le mariage a par-dessus tout une valeur en lui-même (religieuse, spirituelle, en tant que preuve d’amour) que n’a pas un contrat commercial. Par cette dimension spécifique, le mariage est un moyen d’échanger des promesses, notamment en matière de secours et d’entretien, dont la valeur dépend du comportement de chaque époux à long terme. C’est là qu’apparaît un risque commun à tous les contrats de long terme, c’est-à-dire un risque de comportement opportuniste. Ce problème provient des investissements spécifiques réalisés généralement par l’épouse et dont les gains sont répartis inégalement à travers le temps. Au début de l’union, l’épouse réalise la majeure contribution dans le foyer en s’investissant principalement dans l’éducation des enfants, en renonçant partiellement ou totalement à son activité professionnelle (éventuellement en renonçant à certaines opportunités de carrière pour garder une disponibilité suffisante pour son foyer). La contribution de l’époux est en revanche faible. L’épouse reçoit alors les gains de son investissement dans le foyer à long terme, lorsqu’elle bénéficie des revenus de son conjoint alors que les enfants ont grandi. A l’inverse, l’époux perçoit immédiatement les gains du mariage (confort de la vie conjugale lié à l’investissement de son épouse dans le foyer) mais il en paye les coûts à long terme, via l’entretien de son épouse une fois les enfants élevés. Le risque est alors que l’époux adopte un comportement opportuniste consistant à rompre le contrat par le divorce au moment où son épouse devrait percevoir la part qui lui est due, c’est-à-dire une fois les enfants élevés. L’époux s’approprie ainsi ce que les économistes des contrats appellent « la quasi-rente » de son épouse. Les économistes Geddes et Zak (2002) expliquent en particulier que la stratégie optimale de l’époux consiste à quitter son épouse une fois que celle-ci a réalisé sa contribution dans le mariage. Le juriste anglais Dnes (Reference Dnes, Bouckaert and De Geest1999) assimile ce comportement à un « greener grass effect », selon lequel l’époux serait incité à rompre l’union avant de « payer » son épouse pour son investissement dans la famille, pour aller vivre avec une autre femme, plus jeune. Les conséquences pour l’épouse sont d’autant plus dramatiques que les investissements spécifiques qu’elle a réalisés dans l’éducation des enfants et l’organisation du foyer ne sont pas redéployables sur le marché du travail ou du remariage. Cette thèse est également défendue par les juristes Brinig et Crafton (1994), qui revendiquent une approche du mariage en tant que relation contractuelle, d’autant plus que le passage du divorce pour faute au divorce sans faute a augmenté les risques d’opportunisme parce que l’un des époux peut désormais rompre le mariage à tout moment, virtuellement sans compensation pour l’autre Footnote 14 .
Face au risque d’opportunisme, la solution consiste à rendre la rupture du contrat couteuse. La pension peut jouer ce rôle puisque d’une part l’épouse sait qu’en cas de divorce, elle sera compensée pour son investissement domestique (on retrouve ici l’approche incitative de Landes) tandis que l’époux n’est pas incité à se comporter de manière opportuniste puisque le divorce ne lui permet plus d’échapper à ses engagements envers son épouse.
Se placer sous l’angle du respect des engagements plutôt que sous celui de la maximisation du revenu total conduit à questionner la façon d’indemniser la partie lésée lorsque la rupture du contrat est effective. Cette approche soulève alors la question de la négociation de la pension entre les époux et donc celle de la détermination de son montant en fonction des pouvoirs de négociation de chacun. Cela renvoie à une conception moderne du couple, où la négociation, permise en particulier par la plus grande indépendance financière des femmes mais aussi par une évolution du statut des femmes dans la société vers plus d’égalité, a remplacé un rapport de dépendance où la négociation avait peu de place.
3.2 L’obligation alimentaire entre ex-époux justifiée par la théorie économique des contrats
L’économiste Bolin (Reference Bolin1994) a développé le premier modèle consacré à la pension fondé sur l’économie des contrats. Son objectif n’est pas d’opposer l’approche de l’efficience et l’approche contractuelle mais plutôt de montrer qu’elles sont complémentaires.
Le point de départ de son analyse est identique à celui de Landes : les époux sont confrontés à un problème d’allocation du temps de l’épouse entre le marché du travail et son foyer; plus elle consacre du temps aux activités domestiques et moins elle développe son capital humain. Si l’on introduit un risque de divorce, en l’absence de compensation de l’épouse, celle-ci va choisir un niveau d’investissement spécifique sous-optimal. La pension est efficiente si l’épouse n’est pas incitée à dévier du niveau de spécialisation optimal. Cependant, l’analyse de Landes ne fournit pas une mesure unique de la pension à verser à l’épouse. Plus précisément, Landes détermine le niveau optimal de spécialisation qui maximise le revenu en commun. Il est unique et ne dépend pas de la façon dont ce dernier est partagé entre les deux époux. Il suffit alors de fixer la pension de façon à atteindre le niveau optimal de spécialisation. Cela implique que le partage du revenu total est exogène en ce sens qu’il ne dépend pas des pouvoirs de négociation des époux.
Cependant, dans les faits, la maximisation du revenu commun du couple n’est pas le seul élément important dans les décisions d’activité des couples. La façon dont ce revenu total est partagé est également cruciale Footnote 15 . En d’autres termes, l’analyse de Landes fondée sur l’efficience permet d’élaborer un modèle de production de biens domestiques, mais pas un modèle de négociation. Cette critique n’a pas échappé à certains juristes, notamment Singer (1994, 2442) pour qui « [t]he economist’s focus on the household as an efficient, productive unit ignores both the distribution of resources within that unit and the effect of the specialization on that distribution ». Or, la spécialisation impacte le pouvoir de négociation des époux, en particulier pour les femmes au foyer dont les compétences ne sont pas redéployables sur le marché du travail, avec pour conséquence directe une plus forte vulnérabilité aux menaces de séparation du conjoint. Ainsi, comme l’écrit l’économiste Bergmann (1981, 84) : « [t]he power that a husband now has to terminate his marriage to a housewife and thus to reduce considerably her standard of living and her status has effects on those housewives whose marriage has not terminated. First of all, there is the worry that the marriage may terminate. Second, the husband may use the implicit or explicit threat of leaving to achieve dominance in the relationship, to the detriment of the housewife’s feelings of wellbeing ».
Certains économistes ont tenté d’intégrer les pouvoirs de négociation des époux (Fethke Reference Fethke1984; McElroy et Horney Reference McElroy and Horney1990). Ainsi, Fethke (269) explique que « [o]ne interesting feature of the Nash-bargaining model is that it offers an explanation of the conditions under which alimony payments might be an attractive arrangement for the couple » Footnote 16 , mais suppose pour simplifier que les pouvoirs de négociations sont égaux. Plus récemment, Kraft et Stebler (Reference Kraft and Stebler2006) montrent l’effet qu’ont les règles relatives à la pension sur les choix d’activité sur le marché du travail de chaque membre du couple mais aussi sur leur décision de divorcer ou de rester mariés. Cependant, là encore, ils adoptent l’hypothèse que la pension revient à partager de manière égale les revenus du couple après le divorce, ce qui revient à considérer que leurs pouvoirs de négociation sont identiques.
Bolin (Reference Bolin1994) ne résout pas davantage le problème complexe de l’introduction des pouvoirs de négociation mais va plutôt s’attacher à montrer que la pension, selon la façon dont elle est calculée, est très proche des différentes modalités d’indemnisation existantes en droit des contrats. Il écrit en particulier : « [i]t is the thesis of this article that the approach proposed by Landes does explain why there should be alimony. The calculation must, however, be based on some form of implicit or explicit contract. It is shown that the rule for alimony given by Landes, and argued for by Ellman, bears a close resemblance to what would be given by the theory of breach of contract if divorce is regarded as breach by one party » (494). Le lien avec les pouvoirs de négociation peut ensuite facilement être fait selon que le calcul de la pension est plus favorable à l’un ou à l’autre des ex-époux.
Plus précisément, selon l’approche fondée sur l’efficience, la pension permet d’atteindre un niveau optimal de spécialisation qui conduit à une augmentation du revenu marital commun par rapport à la situation sans transfert. Ce gain doit ensuite être partagé en cas de divorce. Le bénéfice de la spécialisation domestique peut alors revenir entièrement à l’épouse, ou à l’inverse à l’époux, ou à l’un et à l’autre selon une infinité de combinaisons possibles.
Bolin examine alors deux mesures extrêmes de la pension : le montant le plus élevé que l’époux accepterait de payer et le montant le plus faible que l’épouse accepterait de recevoir. Il établit un lien avec l’approche contractuelle puisqu’il montre que les montants de pensions alimentaires pour époux correspondant à chacune de ces options sont similaires à deux mesures de compensation traditionnellement utilisées en droit des contrats américains la restitution et la reliance. Ainsi, une mesure de la pension selon laquelle l’épouse recevrait tous les bénéfices de la coopération conjugale, en ce sens que la pension est égale au gain attendu de l’époux permis par l’investissement domestique de son épouse au niveau socialement optimal plutôt que d’un point de vue privé, non seulement crée les incitations optimales mais est aussi très proche de la notion de restitution si le divorce est considéré comme une rupture de contrat de la part de l’époux (Bolin Reference Bolin1994, 497). Inversement, si la pension correspond au montant minimum accepté par l’épouse en ce sens qu’elle est juste compensée pour les pertes qu’elle a subies du fait de son investissement accru dans les tâches domestiques, alors non seulement elle est également efficiente mais elle est en outre très proche de la notion de reliance si le divorce est considéré comme une rupture du contrat par l’époux également. Cette mesure est efficiente dans la mesure où l’épouse est intégralement compensée pour les pertes attendues de son investissement spécifique (Bolin Reference Bolin1994, 498).
Par conséquent, comme le précise Bolin, « [i]t is clear that the approach to divorce proposed by Ellman (and Landes) must be based on contractual considerations. Moreover, the efficiency-promoting rule for alimony proposed by Landes corresponds to slightly modified versions of the traditional remedies for breach of contract » (Bolin Reference Bolin1994, 501).
3.3 Critiques de l’approche contractuelle
Les limites de la conception contractuelle de la pension sont de nature juridique. Même si, comme l’admet le juriste Cohen (Reference Cohen1987), le mariage présente certaines caractéristiques de nature contractuelle, il n’est juridiquement pas un contrat. Les conséquences pour la pension alimentaire pour époux sont importantes. En effet, si le mariage n’est pas un contrat, cette pension ne peut pas être justifiée par sa rupture. Fonder l’obligation alimentaire entre ex-époux sur des motifs contractuels dépend alors de savoir si les promesses des époux pendant l’union peuvent être considérées comme des engagements contractuels et, dans l’affirmative, si l’époux ou l’épouse les a respectées. Si c’est le cas, alors l’octroi d’une pension alimentaire dépend de la preuve selon laquelle le contrat a été rompu, et elle doit être considérée comme le versement de dommages et intérêts d’un époux envers l’autre. Le principal problème repose donc sur la qualification des engagements entre les époux, qui en outre sont souvent implicites plus qu’explicites. Il existe de surcroît un risque que les juges accordent une pension sur la base de leur perception des engagements implicites et pas sur les engagements réels que les époux ont pris l’un envers l’autre.
Se pose également le problème de l’écart possible entre l’engagement que l’un des époux a pris et la perception de cet engagement par l’autre. C’est la raison pour laquelle Ellman refuse une théorie de l’obligation alimentaire ex-époux fondée sur le respect ou non de promesses et lui préfère une approche fondée sur l’efficience. Il explique en effet à propos de la théorie de l’efficience que « [t]he theory offered here is fundamentally different from contract analysis. To think of alimony in contract terms is essentially to look backwards. We ask what deals were made and what promises were relied upon, and we fashion a remedy that vindicates reliance on those promises. By contrast, the proposed approach looks forward; it generates alimony rules that encourage the kind of marital behavior we want » (51). L’approche par l’efficience s’affirme alors clairement comme une approche normative, alors que l’approche contractuelle est de nature plus positive en ce sens qu’elle vise à décrire les conséquences matérielles de la séparation mais aussi leur cause afin d’organiser leur dédommagement.
4 Conclusion
A partir des années 1970, la plupart des pays occidentaux ont basculé d’un droit du divorce basé sur la faute à un droit du divorce faisant une large place au divorce sans faute. Cette « no-fault revolution » a laissé la pension alimentaire pour époux sans véritable fondement théorique, dans une société où l’indépendance des femmes a en outre fortement modifié les rapports entre époux, notamment sur le plan de la dépendance financière. Au tournant des années 1990, certains juristes ont alors mobilisé des approches économiques, fondées sur l’efficience et le contrat, pour justifier le versement d’une pension sans référence à la faute. Bien que critiquables, soit parce qu’elles tendent à maintenir des inégalités de genre, soit parce qu’elles donnent au mariage une nature contractuelle qu’il n’a juridiquement pas, ces approches sont compatibles avec une conception plus moderne du mariage. Elles apparaissent également plus complémentaires qu’opposées : la première, fondée sur l’efficience, justifie la pension par la maximisation du revenu commun par le biais de la spécialisation optimale de l’épouse tandis que la seconde, fondée sur le contrat, s’intéresse davantage à la façon dont ce revenu commun maximisé est partagé entre les ex-conjoints, avec la difficulté de déterminer la façon dont les époux se mettent d’accord sur ce partage.
Ces deux approches, et la façon dont les juristes les ont mobilisées, ont contribué, à leur tour, à nourrir la réflexion relative à l’évolution du droit des obligations alimentaires envers l’ex-conjoint aux États-Unis et au Canada, comme celle relative à l’élaboration de barèmes en matière de fixation de pensions alimentaires pour époux (Rogerson Reference Rogerson2004). Ce type de dialogue interdisciplinaire n’a en revanche pas eu lieu au sein de la doctrine européenne, sans doute parce que les juristes européens entretiennent des relations beaucoup plus distanciées avec les économistes que leurs homologues nord-américains. Un tel dialogue pourrait pourtant être fructueux dans un contexte où les décisions des magistrats sont faiblement prévisibles (Bourreau-Dubois et Doriat-Duban Reference Bourreau-Dubois and Doriat-Duban2013), alors même que des méthodes de calcul aux origines et aux logiques variées ont vu le jour dans un certain nombre de pays européens, comme le met en évidence Isabelle Sayn dans ce numéro spécial Footnote 17 .