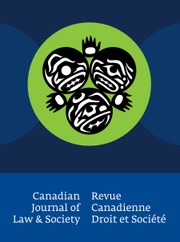Introduction :
« Il n’y a guère de légitimité démocratique sans justice sociale »Footnote 1.
Les droits fonciers des peuples autochtones seraient-ils le parent pauvre du renouveau constitutionnel au CamerounFootnote 2 ? Le doyen Léopold Donfack SokengFootnote 3 faisait pour sa part remarquer le silence entretenu sur la question par la loi constitutionnelle du 18 janvier de 1996 à partir de laquelle l’État entend préserver les droits des populations autochtonesFootnote 4. Le rapport « hommes-terres »Footnote 5 a pourtant suffisamment marqué les esprits à la faveur du renouveau de la « Révolution des peuples »Footnote 6 au début de la décennie 1990Footnote 7. Qualifiée de « polarisation ethno-régionale d’après l’adage, “Charbonnier est maître en sa demeure” »Footnote 8, la double revendication personnelle et territoriale qui en ressort est régulièrement actualisée au gré des circonstances, conflictuelles ou non, ainsi que l’ont récemment démontré les évènements de Bansoa en pays BamilékéFootnote 9 ou encore ceux de 2008 à l’occasion des émeutes dites de la faim par une Déclaration des forces vives du MfoudiFootnote 10. L’actualité de cette double revendication s’inscrit dans une logique de contestation des différentes politiques foncières qui se sont succédé au Cameroun avec pour point commun la reconfiguration de l’ethno-géographie originaire. On parle « d’autochtonisation des allogènes et d’allogénisation des autochtones » (italique dans l’original)Footnote 11. Le rapport personnalité autochtone-Conseil régionalFootnote 12 consacré en 1996 apparaît lui-même, de ce point de vue, comme « un vrai faux mensonge »Footnote 13 d’autant que le titre d’autochtone semble frappé de la « malédiction conceptuelle »Footnote 14 dont parlait Jean NjoyaFootnote 15. Il s’agira ainsi, dans les brefs développements qui vont suivre, de la mise en perspective de la sociogenèse du « brouillage identitaire » qui s’avère être le ferment de la principale problématique de la cohabitation dans les cités du Cameroun actuelFootnote 16. Sans doute conviendrait-il, avant d’aller plus loin, de relever quelques moments de la formalisation de cet État au Sud du Sahara afin d’identifier les différents acteurs qui ont contribué au cadastrage de sa société civile. Deux séquences vont principalement retenir notre attention dans cette étude : la période coloniale et la période postcoloniale.
La première se situe, pour l’essentiel, entre le cinquième siècle de l’ère chrétienne et la fin des années 1950. Elle s’étend de l’invasion occidentale, légitimée par ce qu’on qualifierait au sortir de la Conférence internationale de Berlin (1884–1885) de « légalité coloniale »Footnote 17, à l’administration internationale du territoire qui débute à la fin de la première guerre mondiale et s’achève avec le droit de la décolonisationFootnote 18. Il est établi que depuis le périple du carthaginois Hannon qui a atteint le Mont Cameroun baptisé le « Char des Dieux » au cinquième siècle, le Cameroun est une terre très sollicitée. En 1472, les marins de Fernando pôo entrent dans l’estuaire du Wouri ; surpris par l’abondance des crevettes que regorge le cours d’eau, ils l’appellent Río dos Camarões (rivière de crevettes), d’où le nom Cameroun. Se succèderont par la suite : Néerlandais, Anglais ou encore Allemands. De l’autre côté, au Nord du pays, l’invasion occidentale aurait été devancée par la colonisation islamo-peule qui n’aurait pas moins bouleversé l’organisation de la société primitive. Certaines thèses tendent à démontrer qu’Allemands et Français qui se sont illustrés dans cette partie ont renforcé—séduits par la rigoureuse organisation de la suzeraineté islamo-peule—les positions hégémoniques des arrivants au détriment des autochtonesFootnote 19. Dans tous les cas, c’est avec l’empire du Reich que le pays a écrit les premières pages de son histoire moderneFootnote 20. Suite à une kyrielle d’Accords passés avec les chefs indigènesFootnote 21, et notamment le Traité germano-douala du 12 Juillet 1884, le pays devient un Protectorat allemandFootnote 22. À l’issue de la première guerre mondiale, les troupes alliées délogent les Allemands et en 1918, le Cameroun est placé sous un régime de Condominium franco-britanniqueFootnote 23. Un an plus tard, à la Conférence de Versailles, le pays sort définitivement du régime « colonial » au même titre que les autres possessions allemandesFootnote 24. Il est par la suite régi par un Mandat international confié à la France et à l’Angleterre. Ce fut le premier pas de la normalisation de l’État camerounaisFootnote 25, et le point de départ décisif d’une société biculturelle et bilingue qui, jusqu’au début de la guerre, ne représentait aux yeux des allemands qu’une communauté d’indigènesFootnote 26. La question foncière est ainsi traitée, pendant l’administration occidentale, à trois niveaux mais sensiblement suivant les mêmes principes : d’abord par l’administration coloniale allemande puis lors de l’administration internationale et respectivement sous les gouvernements français et britannique. On assiste dans tous les cas à la désacralisation de la terre et surtout à la dé-communautarisation foncière et donc parentale du fait que le rapport entre la parenté et la terre Footnote 27 ou encore entre la famille et la terre Footnote 28 est clairement établi.
La période post indépendance est quant à elle marquée par le mot d’ordre de l’unité nationale qui a servi de base idéologique au gouvernement de la République pour quasiment les mêmes résultats. En 1974, le président de la République institue la division foncière par l’avènement du Titre foncier comme seul titre de propriétéFootnote 29. Avec la grande réforme démocratique, la question a fait une timide réapparition dans les milieux politiques et en 1994, il a été promulgué une importante loi sur le patrimoine forestier camerounais. La loi de 1994 apporte une reconsidération de l’identité des peuples autochtones à partir d’une reconnaissance du droit collectif à la terre. Les politiques foncières s’analyseront, sommes toutes, dans le Cameroun indépendant comme poursuivant une double dynamique de déconstruction et de reconstruction identitaire. Dans cette perspective, et en récapitulant, la présente étude replace la question des autochtones sur la selle des préoccupations scientifiques. Il est surtout question de proposer quelques repères qui, nous l’espérons, serviront de base à une définition synthétique de la notion d’autochtone fortement attachée aux titres de souverain de la terre ou des terroirsFootnote 30, et donc à la question foncière. C’est du moins la conclusion qui prévaut à la suite de « la redécouverte des “Natives Titles” » dans une jurisprudence australienneFootnote 31. Isabelle Schulte-Tenckhoff ne dit pas autre chose ; elle pour qui « la problématique autochtone met en jeu des revendications territoriales concurrentes, opposant l’une ou l’autre forme de titre historique, tel que le “titre aborigène” (native title) en common law, à la souveraineté présumée absolue de l’État »Footnote 32.
L’étude entend ainsi contribuer, par un exposé chronologiqueFootnote 33, et au moyen de la formule « Autochtonie égale territoire » dont s’est servi José Gomez Del PradoFootnote 34, au repérage des communautés ethno-géographiques « originaires » des régions camerounaises où la question d’autochtone semble particulièrement retenir l’attention. Nous verrons, pour y parvenir, comment la politique « civilisatrice » occidentale qui visait dans l’espèce l’évincement du droit coutumier a modifié la civilité primitive au Cameroun (I). Et, bien sûr, l’affirmation du droit moderneFootnote 35 ayant entretenu cette vision à l’occidentale du rapport hommes-terre a prolongé la politique de la déconstruction identitaire dans le Cameroun indépendant ; politique qui manifestement ne pouvait survivre au vent du libéralisme qui a secoué l’État-nation en Afrique à partir de son épicentre (II). Georg Sorensen ne disait-il pas que « la démocratisation commence quand le problème d’identité a été résolu. Pour qu’elle démarre, on doit d’abord répondre à la question de savoir qui sont ceux qui se démocratisent »Footnote 36 ? La question foncière demeure dans tous les cas d’actualité, notamment depuis la promulgation en 2007 de la Déclaration des Nation-Unies sur les peuples autochtones qui a marqué du sceau de l’irréversible la protection constitutionnelle des minorités et autochtones au CamerounFootnote 37.
I– L’aliénation de la civilité primitive par l’avènement du droit moderne
La question foncière pendant l’administration occidentale, nous l’avons dit, a été traitée au Cameroun, en deux étapes, par trois puissances : l’Allemagne, la France et l’Angleterre. « Que se soit pour le législateur colonial allemand, ou pour le législateur colonial français, le droit coutumier ne pouvait ne pas subir de modification », disait Stanislas Méloné dans un propos qui énonce le point commun à ces différents acteursFootnote 38. Il serait, chez les uns comme les autres, question d’ôter à la terre son caractère sacré afin d’en faire un bien vénal suivant les principes des Codes occidentaux qui s’attaquaient, si tel est le cas, par la même occasion à l’organisation sociale primitive. Chautemps faisait remarquer dans cette artère que le Code métropolitain fut subsisté aux lois indigènes, au mépris des conceptions religieuses ou encore familiales des annamites, de « l’organisation ancestrale de la gens, la hiérarchie des parents, le fonds culturel » (italique dans l’original)Footnote 39. La spoliation de l’autochtonie se serait particulièrement réalisée suite à deux pratiques : la désacralisation de la terre (A) et la dé-communautarisation du droit à la terre (B), considérant, ainsi que le rappellent Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps et Jacques Poumarède, que le lien à la terre et « sa sacralisation sont des éléments primordiaux » de l’identité des autochtonesFootnote 40.
A – La désacralisation de la terre
L’idée est établie dans les milieux religieux : la terre est un bien sacré. Qui ne se souvient de la célèbre affaire de la profanation du cimetière musulman au Sénégal ? Du Livre de la Genèse (Gen : 2) où il fut donné à l’homme—au sens générique du terme—de cultiver le Jardin jusqu’au partage de Canaan (Jos : 13) entre les douze tribus d’Israël en passant par la promesse d’un pays où coule le lait et le miel faite au Patriarche Abraham (Gen : 12 ; Ex : 3), la question de la terre est au centre des préoccupations humaines. Droit individuel, propriété collective ou patrimoine commun à l’humanité, voilà au moins trois problématiques qui intéressent les contemporains. Dans le droit traditionnel africain, la terre est un culteFootnote 41. Ernest Menyomo disait : « Aucun africain n’est aussi attaché au ciel qu’à la terre »Footnote 42. Celle-ci est à la fois la mamelle nourricière et le sacre des ancêtresFootnote 43 : les « pères fondateurs »Footnote 44 dont la mémoire y est toute attachée. Cette conception appelle la notion d’ancêtre commun ; Jacob (dans le cas biblique), le père des douze, lesquels ne sont pas moins eux-mêmes le commencement d’une foultitude de filiations exercées sur la portion allouée à la tribu. La terre de l’un devient celle de plusieurs, l’origine logique des luttesFootnote 45 opposant les uns aux autresFootnote 46 et bientôt de quêtes exogènes et de résistances endogènes suivant l’expression qui fait cours au CamerounFootnote 47. Le caractère sacré de la terre en fait pourtant un bien inaliénable. C’est toute cette conception traditionnelle du droit sur la terre que contesteraient les puissances occidentales, lesquelles nieront dans ce cas l’identité, toute faite au rapport avec la terre, des communautés de cultivateurs, éleveurs, cueilleurs et plus tard de pêcheurs et chasseurs qui forment la société primitiveFootnote 48 africaine. Techniquement, le titre « sacré »—« prête du sol »Footnote 49 ou encore « garde suprême »Footnote 50—de souverain de la terre semble avoir été battu en brèche pour la première fois par un Traité dont l’identité demeure une énigme, et par lequel fut introduite la notion de terra nullius dans la sociologie indigène avec un ancrage psychologique qui modifiera la civilité des peuples « indociles »Footnote 51 du Cameroun (1). C’est en fait de l’identité des natifs qu’il sera question dans toutes les pratiques du droit moderne (2).
1° Le Traité germano-duala du 12 juillet 1884 ou la contestation de la souveraineté foncière
La politique foncière de l’Allemagne coloniale constitue le premier pas d’une longue liste de mesures que devra affronter le système coutumier. C’est exactement l’investissement de l’Empire du Reich dans la question foncière qui fait de l’année 1884 une référence, un point de recueillement pour les autochtones du Cameroun. Roger-Gabriel Nlep disait qu’« est autochtone [. . .], au plan de la réalité historique, sociologique, géographique, celui qui était quelque part en 1884. Il est autochtone à cet endroit. Même si ses arrière-grands-parents ont vendu les terrains, même s’ils ont aliéné les terres tout ce qui a été donné à Douala aux européens, tout ce qui a été arraché à Njombé, à Edéa, à Bafoussam, au Nord, cela ne veut pas dire que cela n’a pas été donné ou arraché à quelqu’un »Footnote 52. La doctrine semble d’ailleurs s’accorder sur la qualification d’autochtone comme peuples ayant « suivi les établissements des populations venues d’Europe qui les ont dépossédés et expropriés de leurs terres ancestrales »Footnote 53. Dans l’espèce, le premier point d’interrogation est le fait du Traité germano-duala du 12 juillet 1884 signé entre, d’une part, les firmes commerciales allemandes Woermann (représentée par Edouard Schmidt) et Jantzen et Johannes Thormählen (représentée par Johannes Voss), et, d’autre part, les rois Bell Ndoumbe Lobe et Akwa Dika Mpondo. On peut notamment y lire :
Nous soussignés, les rois et chefs du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun, entre les rivières Bimbia au Nord et kwakwa au Sud, et jusqu’à 4° 10’, de longitude Nord, avons aujourd’hui, au cours d’une assemblée tenue en la factorerie allemande sur le rivage du roi Akwa, (pour le roi Deido : sur le ponton allemand Luise)Footnote 54 volontairement décidé que : Nous abandonnons totalement aujourd’hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l’administration de notre territoire à MM. Edouard Schmidt, agissant au nom de la firme C. Woermann, et Johannes Voss, agissant au nom de MM. Jantzen et Thormählen, tous à Hambourg, et commerçant depuis des années dans ces fleuves. Nous avons transféré nos droits de souveraineté, la législation et l’administration de notre territoire aux firmes sus-nommées avec les réserves suivantes :
1- Le territoire ne peut être cédé à une tierce personne.
2- Tous les traités d’amitié et de commerce qui ont été conclus avec d’autres Gouvernements étrangers doivent rester pleinement valables.
3- Les terrains cultivés par nous, et les emplacements sur lesquels se trouvent des villages, doivent rester la propriété des possesseurs actuels et de meurs descendants.
4- Les péages [impôt versé par les commerçants aux monarques locaux pour l’exploitation des terres] doivent être payés annuellement, comme par le passé, aux rois et aux chefs.
5- Pendant les premiers temps de l’installation d’une administration ici, nos coutumes locales et nos usages doivent être respectésFootnote 55.
Certains auteurs estiment que le Traité « passe pour avoir livré le Cameroun dans sa totalité à l’Allemagne »Footnote 56. « Rien d’aussi faux »Footnote 57, rétorquent d’autres. La querelle traduit les préoccupations liées à la nature juridique du Traité de 1884. Ce qu’on pourrait dire est que le Traité a contribué à la dévaluation du Native Title. Avant de nous y pencher, il convient sans doute de marquer un bref arrêt sur la qualification du Traité du 12 juillet afin de relever deux ou trois points en relation avec la notion de souverains de la terre mais surtout de la souveraineté du pays tout entier dont le destin fut embarqué dans l’aventure coloniale suite à une interprétation du Traité qui ne saurait prospérer dans une lecture autre. Le texte lui-même mérite certainement une résurrection au moment où la question de la définition des peuples autochtones ou précisément le point de départ de l’antériorité dans les régions du pays, les désormais repères de gains politiquesFootnote 58, se poseFootnote 59 avec acuité.
La « capacité de conclure des traités est un attribut essentiel de la souveraineté externe », disait Isabelle Schulte-TenckhoffFootnote 60. Il ressort nettement de l’étude d’Alfonso Martinez que de tels Traités conclus « entre peuples autochtones et États » relèvent « du droit international »Footnote 61. Cette qualité de souverain s’accompagne dans la littérature du premier auteur d’une personnalité juridique longtemps occultée et aujourd’hui encore niée en Afrique. Il s’agit de reconnaître aux autochtones la qualité de peuple au sens du droit international ce qui, au sein des nations définitivement constituées en États, est loin d’être la chronique d’un long fleuve paisible parsemé de roses. Le droit à l’auto-disposition redoutéFootnote 62 dans cette entreprise n’interdit pour autant pas une requalification du principe des nationalitésFootnote 63 dans le sens d’une active participation à la vieFootnote 64. Mais cela est une autre problématique qui ne rentre pas dans notre propos. À l’inverse, la question de la souveraineté transférée ou précisément le postulat de l’aliénation de la souveraineté du Cameroun mérite une attention soutenue. Nous ne pourrons la creuser profondément de peur de nous éloigner de notre trajectoire. Il sera donc nécessairement mis en avant la question très discutée de la qualité de souverain de la partie allemande à la quelle est attachée la qualification juridique du Traité sous étude. Les firmes allemandes jouissaient-elles des prérogatives de la souveraineté de leur État de rattachement ? C’est la question qui mérite d’être posée, malgré les difficultés qu’éprouve le juriste d’aujourd’hui dans l’analyse du droit inter-temporel dont certains actes semblent avoir été mis « sous scellés ».
S’il paraît de fait que la capacité de conclure des Traités atteste de la qualité de souverain des peuples autochtonesFootnote 65 et appelle aujourd’hui leur re-personnalisationFootnote 66, les qualités plénipotentiaires des firmes commerciales, malgré la protection dont elles bénéficient de la part de l’Empire, ne vont pas de soi. Le texte précise clairement qu’Edouard Schmidt et Johannes Voss agissent au nom des firmes Woermann et Jantzen et Thormählen. Une « parade » consiste à associer le Consul Gustav NachtigalFootnote 67 ou exclusivement Edouard WoermannFootnote 68 à l’entreprise en qualité de plénipotentiaires. Cette contradiction ne contribue-t-elle pas à renforcer le doute sur la qualité juridique du texte retenue quasi-unanimement ? Il en est ainsi notamment lorsqu’un certain Edouard Woermann—frère cadet du directeur de la firme hambourgeoise—qu’on disait en visite à Douala et dont le rôle dans la politique allemande au Cameroun n’a jamais été établi est consigné dans les Mémoires du Reichstag au détriment du Consul général NachtigalFootnote 69. Certains auteurs ont tranché net : le Traité du 12 juillet n’est pas le fait de « deux autorités politiques »Footnote 70. On peut de cet avis prétendre que la supposée présence de l’un ou de l’autre entend donner au document la nature juridique d’un Traité international au sens moderne du terme quand bien même il est certain qu’une qualification autre—à l’exemple d’une « colonisation commerciale » (italique dans l’original) dont parlait l’historien Engelbert MvengFootnote 71—n’aurait pas dispensé le Cameroun d’une annexion programméeFootnote 72. La distance entre la clause principale du texte et les réserves laisse dans tous les cas perplexe tout observateur de la question.
Comment comprendre qu’un acte qui entend le transfert total de la souveraineté—ce qui suppose, dirait Alain Pellet, la complète aliénation juridique de son titulaire originaireFootnote 73—protège en même temps les Traités d’amitié et de commerce antérieurs ou encore de manière plus sérieuse le territoire national ? A-t-on transféré la souveraineté sans territoire et vice versaFootnote 74 ? Non-sens logique. Tel pourrait finalement être le qualificatif du Traité de 1884. Traité qui dit une chose (abandon de la législation) et son contraire (continuité du commerce juridique par le paiement de l’impôt « Coumi » aux souverains supposés déchus). « Traité d’annexion » du Cameroun dans toute sa splendeur qui indique pourtant, avec précision, la référence ratione loci des compétences en jeu : le pays nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun—dérivé du Camarões, le nom religieux donné, comme on l’a vu, à l’estuaire du Wouri par les explorateurs portugaisFootnote 75—, entre les rivières Bimbia au Nord et kwakwa au Sud. Le moins qu’on puisse dire est que les notions énoncées dans le Traité signé par un après midi à la factorerie allemande étaient complètement étrangères au vocabulaire indigène. Il faut même préciser que la version la plus répandue du document est celle publiée en allemand dans le Mémoire du Reichstag en 1914 et traduite par le Pasteur Brutsch. Or la version originale, mystérieusement disparue, était en anglais, « langue parlée par la population de Douala »Footnote 76. Tout porte donc à croire que les dignitaires locaux « espéraient pouvoir suivre sans dommage pour leur société, l’évolution d’un commerce auquel ils étaient fondamentalement liés »Footnote 77. Mais très tôt, ils seront conviés à l’évidence.
Deux ans après l’entrée en vigueur du Traité, les firmes allemandes entendent s’émanciper du paiement du Coumi Footnote 78. Le divorce semble programmé. La nomination en mai 1895 de Jesco Von Puttkamer y apportera une note décisive. Le nouveau Gouverneur interdit aux autochtones, par un arrêté en date du 19 juin 1895, « d’exercer tout commerce sur la Sanaga, la voie fluviale qui ouvrait l’accès aux pays Bassa et Yaoundé », l’actuelle capitale politique du Cameroun. De constat général, on est bien éloigné des clauses du Traité du 12 juillet 1884.
Plus sérieusement, et c’est aussi le plus important, le 15 juin 1896, le Reich promulgue une ordonnance impériale instituant la notion de terres vacantes et sans maîtres pour « identifier » les terrains inoccupés. Son Titre I dispose notamment que :
Sous réserve de droits de propriété ou d’autres droits réels que les particuliers ou d’autres personnes morales, que des chefs ou des collectivités indigènes pourraient prouver (accent ajouté), de même que sous réserve des droits d’occupation de tiers fondés sur des contrats passés avec le gouvernement impérial, toute terre à l’intérieur du territoire de protectorat du Kamerun est de la couronne comme étant sans maître, sa propriété échoit à l’empireFootnote 79.
L’ordonnance de 1896 donne ainsi un sens à la politique allemande de l’Hinterland. Elle ambitionne surtout d’introduire le droit moderne dans la gestion des terres. Mais par quels moyens une société marquée par l’oralité Footnote 80 pouvait-elle « prouver » des droits aux membres d’une société dans laquelle l’écrit constitue le moyen irréfutable de preuveFootnote 81 ? Les enjeux semblent clairement définis. Alexandre-Dieudonné Tjouen rapporte que, malgré les oppositions des indigènes pour qui les terres inoccupées sont peut-être vacantes mais appartiennent « aux ancêtres et à leurs lignages », l’administration allemande classe les terrains visés dans le domaine impérialFootnote 82 : on parle sans titre de terres de la CouronneFootnote 83, du domaine du territoire et plus tard des domaines public et privé de l’État. La souveraineté passe de l’autochtone à l’allochtone par défaut de preuve du premier et sans besoin de preuve pour le second. Le problème de fond réside dans l’appréhension de la notion de terres vacantes et surtout sans maîtres. Dans la stricte tradition africaine, tentèrent d’expliquer les monarques locaux, « toutes les terres d’une communauté appartiennent à l’ensemble des individus, chacun n’ayant sur la parcelle qu’il occupe qu’un droit d’usufruit. Ces terres sont généralement placées sous la tutelle d’un chef et ne sont limitées que par les terres des tribus voisines. Même temporairement inoccupées, elles ne sauraient être considérées comme terres vacantes et sans maîtres »Footnote 84. Face aux réticences du colonisateur se dressent alors les résistances des collectivités coutumières. En 1910, l’administration allemande exproprie, de force, les riverains du plateau Joss au mépris du Traité de 1884. Les autochtones, les duala, dirigés par le roi Rudolph Douala Manga Bell, protestent courageusement contre cette mesure. Trois ans plus tard, Manga Bell est démis de ses fonctions puis pendu quatre jours après en compagnie de son cousin Ngoso Din. Voilà qui donne le sens de recueillement, de point de référence de l’identité autochtone au Cameroun, à l’année 1884. On sait en effet, à la suite de Norbert RoulandFootnote 85, que la culpabilité du passé colonial est en général le creuset de la question autochtoneFootnote 86.
On retiendra ainsi que le premier acte de la désacralisation de la terre est le fait d’un rapport de force par lequel on entend inscrire le droit moderne dans la sociologie des natifs au mépris du droit lui-même. Du moins, c’est ce qui ressort de la mesure, manifestement illicite, d’expropriation dont ont été victimes les autochtones du plateau Joss. Illicite parce que violant les clauses du Traité du 12 juillet 1884 ; illicite surtout parce que, dans un strict plan de la technique juridique, la mesure d’expropriation se conçoit, disait le doyen Maurice Hauriou, à la fois comme une mesure administrative prise suivant une procédure précise et comme le résultat d’une dépossession opérée suite au paiement d’une indemnité préalableFootnote 87. Or, dans le cas sous étude, ni la procédure, et encore moins le paiement, au préalable, d’une indemnité n’a été respecté. L’Empire du Reich va simplement étendre sa pratique d’attribution des territoires locaux aux firmes commerciales étrangères et bientôt, le Cameroun tout entier passera pour être une colonie allemande. La conséquence directe est l’aliénation, par l’évincement du système coutumier, de la civilité des peuples autochtones fortement attachés à la terre.
2° L’immatriculation foncière ou l’évincement du système coutumier
La politique de constatation, par écrit, développée par l’administration allemande sera relayée par les gouvernements anglais et français. Les Décrets français du 21 juillet 1932 et du 12 janvier 1938 instituent un « régime d’immatriculation applicable aux droits réels définis par le Code civil sans distinction du statut de leurs titulaires »Footnote 88 et une « constatation des droits fonciers sur les terres détenues par les autochtones ou par une collectivité suivant les règles du droit coutumier »Footnote 89. Dans le Cameroun sous administration britannique, les vastes superficies classées « sans maîtres » sont divisées en deux catégories. La première, constituée des Freehold lands, anciennes possessions allemandes, octroie à ses bénéficiaires le Certificate of Occupancy qui s’accompagne d’une jouissance sur les terres acquises pendant quatre-vingt-dix-neuf ans. La seconde catégorie concerne les terres des indigènes (the native lands) régies par l’autorité villageoise. Les autochtones qui possèdent ces chétives parcelles constituées de « petits flots », de « petites réserves malsaines, stériles et dispersées au milieu ou en bordure des domaines européens » doivent présenter le Customary Right of Occupancy comme titre de possessionFootnote 90. La notion d’immatriculation sera nettement formulée par les Français bien que tenant compte du Livre foncier crée par les AllemandsFootnote 91. Il s’agira à l’évidence de la consécration de la propriété individuelleFootnote 92. Un auteur averti disait de l’immatriculation qu’elle est « un procédé subtil d’introduction et de consolidation de la propriété individuelle, dans la mesure où le système du colonisateur, notamment la transcription de la loi française de 1855, se révèle comme peu compatible avec les conditions locales »Footnote 93. Cette mesure instaure, disait Stanislas Méloné, en évinçant le droit coutumier qui n’était pas écrit et « avait pour règle principale le principe de l’inaliénabilité des terres nécessaires à la vie de tous les jours »Footnote 94, « de nouveaux rapports terres-hommes »Footnote 95. Il est désormais décidé qu’être propriétaire n’était pas nécessairement « un droit pour les seuls membres du lignage ; [. . .] que ce pouvait être un droit contre le lignage »Footnote 96. Il était tout aussi question de rendre la terre aliénable, « l’intégrer dans le circuit économique ». C’est ainsi que les Freehold lands dans le Cameroun britannique seront aliénées par vente directe, dons ou legs aux missionnaires, aux sociétés européennes ou aux particuliers. Les terres occupées par les indigènes n’en sont d’ailleurs pas épargnées, malgré leur opposition. L’Affaire D. C. Johny qui connut un heureux dénouement pour le requérant n’en est pas moins une illustration.
Dans l’espèce, une terre coutumière appartient par succession à D.C. JOHNY dans le village MANKON. L’église presbytérienne qui l’occupe par autorisation du chef du village Mankon, obtient, malgré l’opposition soutenue de JOHNY, un Certificate of Occupancy signé du Directeur des Domaines. L’église presbytérienne a émis un chèque au profit de JOHNY et le lui a fait transmettre par le Préfet. Johny l’a refusé. Le Gouverneur Général l’a forcé à accepter le chèque. Il a refusé parce qu’il s’opposait toujours à l’occupation et à la vente de son terrainFootnote 97.
En 1970, Johny poursuit l’Église au Tribunal de première instance de Bamenda pour empiètement sur son terrain. Le juge dira que « Johny a été à l’égard de ces autorités, courageux et tenace ». Le requérant eut gain de cause et 60 000 francs CFA (92.30 euros) de dommages-intérêts. On dira ainsi qu’entre « la conception pré-coloniale ignorant la propriété de la terre et la conception coloniale, post coloniale qui consacre la vision du capitalisme marchand »Footnote 98 se trouve entraînée la destinée des natifs. L’autochtonie doit être entendue à partir de l’antériorité sur un territoire dont l’invasion occidentale constitue le repère par excellence, et non strictement comme « la première occupation d’une terre vacante par une collectivité migrante »Footnote 99, ainsi que l’a écrit Robinson Tchapmegni dans une définition qui a le défaut de faire des Allemands, Français et Anglais des autochtones au Cameroun dans les terres qu’ils ont eux-mêmes qualifiées de vacantes.
Il semble dès lors possible de retenir que le droit moderne qu’imposait le principe d’immatriculation des terres devait faire reculer le droit coutumier, le reléguer au second rang au point où, pour la nation indépendante du Cameroun, il sera appliqué parmi les citoyens un système juridique hiérarchisé et optionnelFootnote 100. L’option de législation et de juridiction perpétue elle-même dans le Cameroun indépendant le Code discriminant de l’indigénat. On distinguait nettement, pendant l’administration française, « les gens de français ou d’européen (tout Français ou non-Africain blanc), l’assimilé (Africain pouvant s’adapter au genre de vie européenne) et l’évolué (Africain instruit et très francisé) »Footnote 101. L’option consisterait alors, quelque temps plus tard et même aujourd’hui, pour les « autochtones de renoncer à leurs coutumes pour se placer volontairement sous la juridiction française [de droit commun] »Footnote 102. L’option apparaît, disait plus savamment Paul-Gérard Pougoué, « comme une affirmation du caractère non obligatoire des règles du droit traditionnel appelées à disparaître au profit de celles du droit dit “moderne”. En effet—précise l’auteur—elle est univoque : les personnes régies par la coutume peuvent faire option en faveur du droit dit “moderne,” mais l’option inverse, celles que feraient les personnes régies par le droit “moderne” pour le droit traditionnel, est niée dans son principe même »Footnote 103. Le nouveau système d’énonciation du droit n’est pas anodin. En 1962, la Cour suprême du Cameroun oriental rend une décision dans laquelle le juge évoque l’argument du statut du droit moderne imposé au défendeur « en raison de son mode de vie à l’occidentale »Footnote 104. C’est la nouvelle civilité qui succède ainsi à la primitivité. C’est le règne de l’individualisme, de la propriété individuelle qu’impose une logique exogène de la gestion des terres proclamées communautaires dans le système coutumier.
B – La dé-communautarisation du droit à la terre
Le système ibo de tenue foncière est basé sur trois principes fondamentaux : que la terre, au dernier ressort, dépend de la communauté et ne peut être aliénée sans son consentement, qu’à l’intérieur de la communauté. Chaque membre a droit à une étendue correspondant à ses divers besoins, terrain de construction, jardin ou champ ; enfin que nul ne restera sans terreFootnote 105.
Le propos traduit la conception communautaire camerounaise et africaine du droit à la terreFootnote 106. Paul-Gérard Pougoué disait à ce propos que « le système foncier des Ibos de la Nigéria peut être étendu à celui de tous les groupements ethniques existant au Cameroun »Footnote 107. Et donc chez les agriculteurs Bamileké à l’OuestFootnote 108, Beti au Sud et au CentreFootnote 109 ou encore chez les agro-pasteurs du NordFootnote 110, l’évidence est que « la permanence d’un groupe, même nomade est inconcevable sans cette interprétation du milieu naturel et humain, sans cette articulation à des assises terriennes »Footnote 111. Il en ressort que le droit à la terre est un droit d’essence communautaire puisque celle-là est, dirait Stanislas Méloné, un bien collectifFootnote 112. C’est en d’autres termes ce que dit pour droit le juge administratif dans l’Affaire Fouda Mballa c/ État fédéré du Cameroun orientalFootnote 113. Cette conception de la propriété met en avant l’idée de la famille lignagèreFootnote 114 ou encore d’une communauté plus large : le clan, le canton comme en Côte d’IvoireFootnote 115 ou la collectivité coutumière au CamerounFootnote 116. Le droit à la terre est ainsi administré, disait Michèle Fark-GrüningerFootnote 117, par un chef de famille, un chef de canton ou de village. C’est donc logiquement que le lien entre la collectivité parentale et la communauté foncière sera distancé par l’avènement de la propriété individuelle. La fragmentation théorique de la communauté (1) emporte aussi logiquement l’aliénation identitaire qui sera appuyée dans la pratique par les mouvements de déportation et de déterritorialisation des natifs dans certaines régions du pays (2).
1° La « fragmentation » de la collectivité foncière et naturelle
Il apparaît clairement que les communautés parentale et foncière sont liéesFootnote 118. Tout lecteur de la Bible le sait, et nous l’avons dit, le partage de l’héritage par Josué s’est fait au profit des familles (les douze tribus). Dans notre contexte, le rapport hommes-terre s’apprécie dans une double influence. D’abord la terre impacte sur ses propriétaires, puis, c’est le droit de la parenté qui a influé sur le droit de la terre. Dans le premier cas on retiendra à la suite de Stanislas Méloné que la communauté naturelle a, en tout temps, modulé son espace au point où les rapports entre l’homme et la terre sont de plusieurs ordres : la terre s’identifie par l’ethnonyme de ceux qui y habitent. On peut encore aujourd’hui dresser un rapport entre les Priso et « leur » terre dans les quartiers tels que Bonapriso (ceux de… priso) à Douala. Au Congo-Brazzaville, les villages Iphoundou et Mosende correspondent aux terres Asoni et OlembeFootnote 119. En Afrique du Sud, la Province du Natal (kwazoulou), malgré son hétérogénéité façonnée par l’histoire, ne rappelle pas moins l’épopée de Shaka (1787–1828) et les Zoulou, une composante bantou autochtone sur ces terresFootnote 120. On peut encore citer le cas des États régionaux éthiopiens de Tigré, Afar, Amhara ou Oromia dont les noms se reportent directement à une communauté indigèneFootnote 121. La terre elle-même a fini par influencer ses propriétaires au point où on a tout simplement dit qu’elle produit des hommesFootnote 122. Ainsi attribue-t-on la physionomie des camerounais par rapport à leur région d’origine : les peuples des grassfields en général seraient corpulents du fait des terres particulièrement généreuses alors que ceux riverains à l’océan Atlantique le seraient moins à cause d’un sol sableux et salé. Il est certainement inutile d’insister, en seconde occurrence, sur l’influence de la collectivité sur la terre ; puisque nous savons que celle-ci est un immobilier, au sens du droit romain, commun à ceux-là. C’est donc au rebours de cette conception communautaire du droit à la terre que s’inscrivent les politiques foncières coloniales. La conséquence immédiate est que la communauté parentale s’effondre avec la disparition du droit collectif à la terre.
Que ce soit avec le Décret impérial du 15 juin 1896, les Décrets français du 11 avril 1920, du 5 juillet 1921, du 21 juillet 1932 ou du 21 octobre 1938, la collectivité foncière va perdre de sa superbe. Allemands, Français et même Anglais vont mettre sur pied des techniques visant à écarter les natifs de la propriété collective et même individuelleFootnote 123. L’organisation du domaine privé à partir de 1938 (Décret du 21 octobre 1938) et la création de la conservation foncière et des droits fonciers en 1921 (Décret du 15 septembre 1921) complètement ignorés des indigènes poursuivent cette ambition en imposant à ceux-ci le droit moderne contre qui ils ne peuvent faire valoir aucun argument. Tous les textes suscités opposent ainsi les domaines public et privé de l’administration coloniale « aux droits fonciers coutumiers qui ne peuvent devenir des droits de propriété qu’après immatriculation des terres ». Or la procédure d’immatriculation est non seulement ignorée du système coutumier mais n’intéresse pas exclusivement les seules collectivités, puisqu’elle peut également être le fait d’un particulier. Cette politique n’est pas allée sans dommage. Elle a même sérieusement affectée la communauté Bakweri, une composante du grand ensemble Sawa (peuples riverains des côtes de l’océan Atlantique) :
Le fait d’être relégués dans les réserves, conclut un Rapport internationalFootnote 124, a incontestablement fait perdre aux Bakweri beaucoup de l’intérêt qu’ils portaient à la vie, ainsi que le montre l’état lamentable de leurs maisons et la façon dont ils négligent la plupart des mesures d’hygiène, en dépit des années de contact qu’ils ont eues avec la civilisation européenne. Même si les terres qui leur ont été louées semblent d’une superficie suffisante pour subvenir à leurs besoins, elles sont invariablement peu fertiles, car les meilleures terres ont été attribuées aux étrangers. Il n’est pas surprenant non plus qu’ils aient perdu tout intérêt à la vie lorsqu’ils ont vu leurs organisations et leurs institutions autochtones impitoyablement brisées pour faire place aux idées et aux entreprises étrangères.
Au droit individuel de jouissance reconnu au sein de la famille succède désormais un droit de propriété au sens complet du terme. Le droit à la terre ne s’exerce plus au sein de la collectivité, mais contre celle-ci qui s’en trouve logiquement fragilisée.
On a parlé de la dégradation du dirigisme parental pour illustrer le déclin du rôle autrefois dévolu au chef ; d’une interprétation restrictive des liens de parenté qui s’accompagne de l’émergence de la famille nucléaire, pour relever les possibilités de conflits fonciers au sein d’une même unité parentale du fait du déchirement du tissu socialFootnote 125 parmi les membres de la collectivitéFootnote 126. Il en ressort nécessairement que l’avenir de l’individualisme et de l’indifférence urbaine était promise à la structure villageoise. Or celle-là va avec la mixité socialeFootnote 127 qui met en déperdition les titres de natifs ou d’autochtones.
2° La déterritorialisation des groupes et la spoliation de la sociologie « originelle »
Ce qu’on nomme aujourd’hui, suite à l’histoire contemporaine, le Cameroun est le carrefour des grands groupes ethnolinguistiques d’Afrique. Le pays fait la jonction de trois aires culturelles de Herskovits ; c’est ici, précise l’historien américain Victor Levine, le point d’ancrage des complexités ethnoculturelles du pays. On y trouve des branches des peuples nigritiques de la côte de Guinée, les Fulani et les arabes du Soudan occidental mais aussi les peuples de langue bantou du Bassin du CongoFootnote 128 repartis sur quatre zones de peuplement qui constituent le repère de l’autochtonie au Cameroun :
• Dans la zone fortement peuplée autour de Dschang [. . .] vivent les Bamileké, et celle qui entoure Bamenda est le centre de la population tikar.
• Vers le Sud, se regroupent les Bantou équatoriaux et les Bété-pahouins
• Au Nord-ouest également l’on dénombre d’autres Bantou, à l’instar des Bassa-Bakoko.
• Enfin, au Nord et au Sud des zones montagneuses, nous compterons les peuples nigritiques (soudano-nigritique) et les groupes assez isolésFootnote 129.
Le processus de sédentarisation ne débute donc pas, ainsi que le démontre aussi l’historien Engelbert MvengFootnote 130, avec l’invasion occidentaleFootnote 131. Il s’avère que l’administration coloniale a simplement procédé à un retraçage de la figure sociale du Cameroun en pratiquant d’autres types d’immigrationFootnote 132 dont le seul justificatif se trouve dans le principe bien connu des milieux politiques depuis la nuit colonialeFootnote 133: divide ut imperes. On constate deux phénomènes en rapport avec notre propos : la déterritorialisation des groupes qui dérive logiquement des émigrations forcées pratiquées ici et là et l’assimilation identitaire qui naîtra des nouveaux brassages issus des réinstallations ou plus exactement des recasements forcés.
La pratique de déportation a été inaugurée au Cameroun par l’administration allemande. Pour des besoins officiels de main d’œuvre, l’Empire colonial a, à titre illustratif, provoqué le déplacement en masse des Bamiléké vers le Sud. Il est régulièrement écrit que « the Bamileke, an enterprising business class, were encouraged by the Germans to migrate to the coast in order to work in the plantations. The Germans established friendly ties with some fondoms in order to have steady supply of labour »Footnote 134.
Événement apparemment bénin, cette émigration constitue aujourd’hui l’une des grandes causes de la revendication identitaire. « L’émigration bamiléké vers le Mungo devait avoir des répercussions économiques et politiques importantes », prédisait déjà Richard JosephFootnote 135. On observera ainsi la déterritorialisation—des natifs—ou si on veut la dépossession qui résulte « d’une hospitalité prolongée qui finit par se transformer en un droit foncier au profit de l’occupant » dont parlait Robinson TchapmegniFootnote 136. Cette curieuse mutation de la propriété ne se fait pas sans heurts ; elle fera même du Département du Moungo région au confluent des ex-provinces de l’Ouest et du Littoral un pôle de contestationFootnote 137, une véritable « poudrière ethnique », suivant l’expression que nous empruntons à Maurice KamtoFootnote 138. Cette situation n’a d’ailleurs pas pu être corrigée par la politique d’assimilation pratiquée par l’administration française, bien au contraire.
En encourageant l’émigration des Bamiléké vers le Sud, les Français poursuivaient pour leur part la politique d’assimilation identitaire qu’ils maîtrisent parfaitement et qui consiste, en paraphrasant Constance Grewe, à « nier les spécificités » pour créer un espace public uniformeFootnote 139. Le propos de Dugast est suffisamment éloquent : « Il ne fait aucun doute qu’ils [les Bamiléké] sont la race de l’avenir du Cameroun que, bientôt, ils tiendront serré dans les fils de leur toile »Footnote 140. Le déplacement forcé de cette composante sociologique du Cameroun par la puissance occidentale a alors renforcé les foyers de tensions, notamment en matière foncière, entre « les étrangers »Footnote 141 et les autochtones. L’historien Richard Joseph rapporte :
Très vite, cette colonisation du Mungo par les Bamiléké se généralisa puisque ces derniers acquirent une grande partie des terres de la région. C’est d’ailleurs ce qui, entre autres, fit du Mungo un centre d’agitation politique et sociale du Cameroun : les Bamilékés essayaient en effet d’obtenir, le plus souvent avec succès, un droit légal sur les terres qu’ils occupaient, alors que les autochtones continuaient de croire qu’ils leur en avaient simplement cédé la jouissance et non la possessionFootnote 142.
Et comme le disait Ernest Menyomo, « la mobilité ethnique n’aura pas seulement bouleversé l’ordre naturel des choses, elle peut être également cause des perturbations linguistiques et généalogiques » au point où la différence entre autochtone et allochtone est devenu aujourd’hui « superfétatoire »Footnote 143. Jean Njoya constate à son tour que « les mouvements croisées d’immigration et d’émigration engendrent une inversion de la sédentarité et des pratiques foncières restrictives et répulsives »Footnote 144. Guillaume Ekambi Dibonguè en apporte une parfaite illustration tirée de la physionomie actuelle de la Région du Moungo dans laquelle l’assimilation a remporté des succès notables : l’évolution ethno-démographique de la ville de Nkongsamba (chef-lieu du département du Moungo)—dit-il au détail près—« a totalement muté en une génération à un tel point qu’il est aujourd’hui courant de parler de Nkongsamba comme d’une ville bamiléké »Footnote 145. La confusion est totale. Les abus caricaturaux.
Dans l’affaire Njana Marie Joseph (MDP) c/ État du Cameroun (MINATD)Footnote 146, le requérant, candidat aux élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription électorale du Moungo Sud, évoque entre autres que « le bulletin de vote pour le RDPC aux législatives pour le Moungo Sud, porte en n° 2 un candidat qui n’ a pas été investi par son parti et qui s’appelle Mbappe Jean Baptiste alors que le candidat investi par le RDPC au n° 2 dans le Moungo Sud s’appelle Mbapte Jean Baptiste. Le nom MBAPPE aurait été mis sur le bulletin pour contenter les autochtones qui boudaient déjà les allogènes, on a aussi mis le nom MBAPPE, poursuit-il, pour voler les suffrages des autochtones et passer la liste du RDPC dans le Moungo Sud ». La Cour statuera sur cette irrégularité en annulant l’électionFootnote 147. Dans l’affaire Enandjoum Bwanga et autres c/ État du Cameroun (MINAT)Footnote 148, il est établi que les Banéka sont exclus des listes électorales alors que l’ensemble de la Commune a pour ressort territorial la zone rurale du canton Banéka. Voilà un court Kaléidoscope des incidences sociales des politiques foncières coloniales qu’auraient hérité les autorités politiques de la première République.
II– Continuité et rupture : de la déconstruction identitaire au gré de l’affirmation du droit moderne à une (re)construction de l’identité autochtone à la faveur de la démocratisation du pays
Lorsqu’en 1959, la Loi n° 59/47 du 17 juin affirme « les droits coutumiers exercés individuellement ou collectivement sur toutes les terres à l’exception de celles qui font partie des domaines public et privé »Footnote 149, on croirait à un renversement des politiques foncières coloniales. Mais l’évidence semble toute autre. Les terres arrachées aux autochtones puis incorporées au domaine impérial n’ont jamais été rétrocédées. C’est la tendance générale dans l’Afrique indépendante. Au Gabon, les ethnonymes seront simplement et purement remplacés par des hydronymes dans la nominalisation des Régions du pays de sorte à distancer le rapport hommes-terreFootnote 150. En Côte d’Ivoire, le mot d’ordre est que « la terre est à celui qui la cultive »Footnote 151. Elle n’appartient pas au premier occupantFootnote 152. Au Zimbabwe, les « terres les plus fertiles du Nord et de l’Est du pays (aujourd’hui Mashonaland Nord et Est) » sont détenues par les populations de race blancheFootnote 153. Le moins qu’on puisse dire est que les réformes foncières motivées par l’idéologie de l’unité nationale n’ont pas permis un repositionnement des collectivités coutumières dans la gestion de la terreFootnote 154. Les Ordonnances camerounaises du 6 juillet 1974 n’apportent, pour ainsi dire, que l’unification de la législation foncière en compilant les différents textes qui régiront désormais la question. La protection spéciale des populations autochtones impose tout de même une lecture de ces textes (A). Il en va de même du régime spécifique des forêts institué précisément à l’orée de la démocratie naissante, et qui, malheureusement, ne fait pas un tour complet de la question foncière dans le Cameroun démocratique (B).
A – Les ordonnances de 1974 : la division foncière et la continuité de la politique de déconstruction identitaire
Le 6 juillet 1974 marque le début de l’harmonisation et surtout de l’autonomie du droit foncier camerounais. Les textes promulgués à l’occasionFootnote 155 consacrent une triple domanialité : les domaines public et privé qui relèvent de la gestion exclusive de l’État et accessoirement de ses collectivitésFootnote 156, et le domaine national qui continue à nourrir les débats, tant le concept prête à équivoqueFootnote 157. Les Ordonnances de 1974 élèvent ainsi le droit foncier camerounais au rang de la modernité, par l’importation du système TorrensFootnote 158. Et bien sûr, l’avènement du Titre foncier inscrit la question au seuil de la citoyenneté ; ce qui, en d’autres termes, achève en Afrique la déconstruction identitaire dont la nouvelle version est entretenue par le droit constitutionnel de la Révolution de 1789Footnote 159. On passe de la collectivité à l’individu, être dépouillé de toutes attachesFootnote 160 (1). Cette modalité de gestion des droits proclamés communautaires ne va pas sans heurts (2).
1° La propriété individuelle ou l’affirmation de l’individualisme au sein de la communauté
La réforme foncière de 1974 est innovante pour plus d’une raison. D’un point de vue structurel, les textes du 6 juillet achèvent la mutation institutionnelle amorcée par le droit colonial. De fait, les anciennes « terres vacantes et sans maîtres » furent incorporées en 1963, par un Décret-loi du 9 janvier, dans le « patrimoine collectif national ». Avec la réforme de 1974, le patrimoine collectif national, « expression chargée de connotation affective, destinée à faire croire à chaque citoyen camerounais qu’il est propriétaire d’une parcelle de ce patrimoine »Footnote 161, sera immergé dans le domaine national qui au demeurant est géré par l’État. Aloys Mpessa souligne dans ce sens que « [l]’État utilise les terres du domaine national, en aliène des parcelles à l’occasion de l’octroi des concessions définitives, et perçoit des redevances lors de l’octroi des concessions provisoires »Footnote 162.
Cette gestion des terres ancestrales s’effectue au détriment des collectivités coutumières. Il est écrit à cet égard que « [l]es droits coutumiers sur les vastes terrains qui existaient avant la grande réforme n’existent plus, sinon en simple jouissance »Footnote 163. La communauté en tant qu’unité historique et sociale n’est plus gestionnaire du patrimoine foncier ; il ne faut surtout pas croire qu’elle est mise en tutelle comme un incapable suivant les exigences du droit civil. Elle est complètement fragmentée. Dès lors, est-on en droit de croire que la réforme de 1974 est une continuité, sous d’autres motifs, de la politique foncière colonialeFootnote 164. Le retrait des collectivités coutumières de la gestion de la terre, cette matière qui cristallise en tout temps les passions humainesFootnote 165, produit des conséquences non négligeables.
Ce qu’il y a à noter pour notre propos est, comme nous l’avons annoncé dès l’introduction de cette étude, l’instauration d’un Titre foncier comme unique attestation de propriétéFootnote 166. Celui-là emporte une logique individualiste des droits fonciers par la division foncièreFootnote 167 et, naturellement, l’individualismeFootnote 168 au sein des sociétés qui se veulent fondamentalement communautairesFootnote 169. C’est là une reprise de l’aliénation identitaire autrefois opérée par les méthodes que nous avons citées plus haut. La gestion de la terre par l’État, au mépris du système coutumier, oppose ainsi d’une part les membres d’une même collectivité. D’autre part, elle oppose les autochtones et les non-autochtones à partir d’une logique protectrice du patrimoine ancestral par les premiers et une méconnaissance des us et coutumes par les seconds devenus nouveaux propriétaires par concession définitive attestée par l’obtention d’un titre foncier. Il faut bien se faire à l’idée que l’autochtonie est une donnée culturelle qui s’illustre parfaitement dans le rapport « hommes-terre ». Dans le département de l’Océan à Kribi, Région du Sud, on présente généralement le Rocher du loup, cet immense récif corallien qui disparaît et réapparaît, se transforme tantôt en gigantesque miroir ou encore en un village d’algues le long des côtes locales, comme le repère de l’autochtonie dans cette région. Tous ceux qui s’y aventurent sous d’autres titres, citoyenneté ou même touriste, s’y engloutissent. Des aéronefs, des hors-bords et même de simples cameras ont ainsi disparus dans cet objet dont l’identité demeure un mystère. C’est dans la même perspective (socioculturelle) que le Comité des droits de l’homme de l’ONU conclut dans l’affaire Sandra Lovelace que « refuser à une indienne le droit de résider dans la réserve tobique, au Canada, en raison de son mariage avec un non indien, revenait à lui dénier le droit garanti par l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’avoir sa propre vie culturelle “en commun avec les autres membres” de son groupe »Footnote 170. Le rapport à la terre est ainsi un rapport collectif et ancestral. En somme, la réforme de 1974 dénie la pleine propriété foncière aux populations autochtones au mépris de l’article 11 de la Convention relative aux populations aborigènes et tribales (Convention n° 107) de 1957 qui requiert, pour les populations intéressées, un droit de propriété au sens complet du terme collectif ou individuel sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. L’évidence est que la terre est désormais un bien marchand, et donc susceptible d’appropriation privée. Cela suppose que toute une base identitaire pourrait passer de l’autochtone à l’étranger. De la sorte, celui-ci deviendrait, dans un siècle ou deux, l’autochtone et celui-là l’étranger dans un terroir qui est pourtant le marqueur de son identitéFootnote 171.
2° Le caractère vénal de la terre ou « le bien d’appel » d’une sédentarité subversive
Les textes de 1974 reconnaissent des droits accessoires aux collectivités autochtones. Il s’agit essentiellement des droits d’usage, de chasse, de pâturage et de cueillette, bref des droits usufruitiers reconnus à tous les camerounais du fait de l’exploitation du domaine nationalFootnote 172. La réforme de 1974 a ainsi ôté aux collectivités coutumières leur droit naturel et exclusif sur le patrimoine ancestralFootnote 173. La terre est devenue, disait Philippe-Jean Hesse, un patrimoine commun à l’humanitéFootnote 174. Bien plus, elle est aujourd’hui une matière première, mieux d’ailleurs que celles qu’elle regorge. C’est dans cette perspective que les Chutes de la Lobé dans le Sud camerounais, mieux que les nombreuses crevettes et la diversité de poisson qu’on y trouve, représentent aux yeux des membres de l’UNESCO un bien d’appel en vue de leur patrimonialisation. Et comme toute matière première, la terre est un bien marchand. Michèle Fark-Grüninger parlait déjà de « marchés fonciers en constitution »Footnote 175. Ce qui ouvre à « l’étranger », l’allochtone, une voie à l’autochtonieFootnote 176 dans un siècle ou deux comme c’est le cas dans les Régions du Cameroun aujourd’hui, quelques cinquante ans seulement après l’indépendance. Tout cela peut paraître bénin en zone ruraleFootnote 177.
En région urbaine, l’octroi de la propriété foncière aux étrangersFootnote 178—nationaux ou non—est source de tensions sociales notamment lorsque la question de l’autochtonie et des gains modernes qu’elle procure sont en jeu. La question foncière constitue, disait le doyen Léopold Donfack Sokeng, la pomme de « discorde quotidienne entre les populations autochtones et celles prétendument appelées allogènes dans les cités de Douala et de Yaoundé pour s’en tenir aux deux villes les plus importantes du Cameroun »Footnote 179. « Ce qui se passe à Douala aujourd’hui est la remise en cause de la loi foncière de 1974 et ses décrets d’application de 1976 que nous n’avons cessé de dénoncer », renchérit à titre illustratif Douala MoutomeFootnote 180. Jean Ava est plus précis, lui qui affirme que « nous constatons que dans la ville de Yaoundé et ses environs, les autochtones n’ont plus de terre, la terre de leurs ancêtres »Footnote 181. Les Bakweri, autochtones de la zone anglophone du Sud-ouest se sont quant à eux ouvertement opposé à la privatisation de la CDC une des rares industries coloniales encore en place au Cameroun du fait que l’opération emporterait leur lien, tout au moins en tant que camerounais, aux vastes terres qui abritent cette corporationFootnote 182.
Le fait est que la politique foncière de l’État n’est pas soucieuse de l’intégrité des autochtones, si fortement attachés à la terre :
L’État—rapporte à titre illustratif un auteur avertiFootnote 183—(par arrêté n° 230/MINUH de 1980) a exproprié pour cause d’utilité publique, plusieurs domaines fonciers faisant jusqu’alors partie des réserves des clans duala. Il s’agissait pour les pouvoirs publics de se doter d’une importante réserve foncière en vue de ses projets d’aménagement. Cependant, la crise du Trésor Public à partir du milieu des années 80 sonna le glas des ambitions étatiques. Une politique de rétrocession fut engagée au profit des collectivités périphériques (à Douala-Nord et à Douala-Est) tandis que les terrains du Centre-ville, ceux de loin les plus convoités, furent vendus par l’État (selon les méthodes décriées par les duala, pour cause d’opacité entourant cette opération) à de nouveaux acquéreurs nantis, donc détenteurs du pouvoir économique.
Cet acte est éloquent lorsqu’à l’examen des parcelles concédées, plus de la moitié des terres du Plateau Joss, de Bonadouma, Bonanjo . . . qui constituent le fonds ancestral de ce peuple, autochtone dans cette partie du pays, revient officiellement aux autochtones de la Région de l’OuestFootnote 184. Il apparaît une déstabilisation des autochtones de Douala qui pourrait conduire à une réplique brutale ainsi qu’il est constaté ici et là. À titre d’exemple, le 28 avril 2008, des « affrontements interethniques [ont fait] trois morts, une dizaine de blessés et une vingtaine de maisons incendiées à Akwaya, dans le Sud-ouest frontalier du Nigéria. Un différend domanial opposant les autochtones de la tribu Olidi vivant au Cameroun d’une part et les “allogènes” de la tribu Yive habitant à la fois au Cameroun et au Nigéria, serait à l’origine de ces actes de violence »Footnote 185. Le moins qu’on puisse dire est que le caractère marchand de la terre produit une dynamique identitaire à rebours. Prétendent désormais à l’autochtonie, du fait du lien avec la terre, les allochtones d’hier nantis du pouvoir économique.
L’État camerounais en dépossédant l’autorité coutumière de la gestion de la terre a désormais l’obligation de gérer les querelles foncières qui font le quotidien des cités du pays. Les nouveaux propriétaires des terres concédées par l’État ne resteront pas passifs. Tel fut le cas avec la dénonciation des arrêtés n° 170, 171, 172, 173 et 174/Y. 26/MINUH/D210 du 8 juin 1993 qui annulent dans certains quartiers de Yaoundé des Titres fonciers « sous la pression des autochtones », ainsi que le rapporte Léopold Donfack SokengFootnote 186.
Il ne convient donc pas de conclure que les communautés nationales ont définitivement capitulé face à l’hégémonie étatique en matière foncière et domaniale. Aloys Mpessa écrit que « [l]es collectivités coutumières et leurs membres, pugnaces, continuent de résister au droit importé et de défier l’État en appliquant un droit parallèle, le droit coutumier conforme aux mœurs sociales »Footnote 187. Cela explique-t-il la prise en compte des autochtones dans la gestion du patrimoine forestier par le législateur en 1994 ?
B – La loi de 1994 ou la renaissance de la collectivité foncière. Vers une reconstruction identitaire ?
En 1994, l’État est revenu, certainement motivé par la Communauté internationale dont les actions en faveur de la (bio)diversité y compris les populations vulnérables n’ont cessé de s’améliorer depuis les années 1990, sur l’épineuse question du domaine national disputé entre les personnes morales de l’État et les populations riveraines. Ainsi, dans le souci de concilier par exemple les exigences économiquesFootnote 188 avec les revendications des autochtones, le législateur camerounais a-t-il mis sur pied une nouvelle logique institutionnelle : une sorte de conjuration de la réforme foncière de 1974.
Le droit foncier est dès lors régi par deux univers juridiques. Au principal, le droit civil d’obédience romano-germanique et accessoirement le droit coutumier. La dualité suppose dans la pratique l’application du second à l’absence du premier. On assiste là à un revirement de la promesse faite par les politiques coloniales et même les textes de 1974 qui ont évincé le système coutumier (2). Mais cette réforme, à tout le moins formelle, n’emporte pas un repositionnement définitif des autochtones sur le domaine national, constitué des ex-terres « vacantes » qui, nous l’avons vu, furent les possessions des natifs. Ceux-ci ne bénéficient pas moins aujourd’hui de droits fonciers consistants (1).
1° La proclamation des droits fonciers communautaires
La Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche est complétée par les Décrets n° 95-531 du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts et n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités du régime de la faune, sans oublier le Décret n° 95/678/PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre indicatif d’utilisation des terres en zone forestière méridionale. Cet important dispositif met fin aux spéculations et abus en matière d’exploitation des ressources forestières biologiques et halieutiquesFootnote 189. Il s’agit d’un cadre innovant du point de vue fonctionnel en ceci que, la gestion du domaine national, hier placée sur l’absoluité de l’État, est aujourd’hui partagée avec l’entrée en scène des communautés villageoises. Sylvestre Naah Ondoua, alors ministre de l’environnement et des forêts au Cameroun, présentait cette nouvelle donne institutionnelle en ces termes : « La nouvelle politique forestière exprime clairement le souhait du gouvernement du Cameroun d’augmenter la participation des populations locales à la conservation et à la gestion de nos forêts »Footnote 190. La participation des communautés locales à la gestion du domaine national s’entend comme une réponse aux frustrations engendrées par les Ordonnances de 1974 qui, il convient de le rappeler, ont exclu les autochtones de la gestion de la terre. Il s’agit également d’une réaction face à la braderie villageoise du couvert forestier qui s’illustre généralement par des coupes anarchiques et des feux de brousse criminels. Elle est, dans la pratique, sous-jacente à la proclamation des forêts communautaires et donc des droits fonciers collectifs (Art. 37-38 de la Loi de 1994).
La prise en compte des populations locales peut en outre s’entendre comme une exigence de la société internationale qui impose une péréquation entre les impératifs économiques et la protection des droits de l’homme, notamment le respect de l’environnement, de la biodiversité et donc de la vie durable. C’est dans cette optique que l’ex-ministre en charge des forêts camerounaises déclare que « [l]es populations locales devraient par conséquent être considérées comme des partenaires essentiels dans le processus de définition d’actions et de moyens visant à assurer une gestion durable de nos forêts dans l’intérêt de tous les Camerounais et Camerounaises »Footnote 191. Le partenariat ainsi établi permet une reconsidération des droits fonciers des populations autochtones, en tant que communautés.
2° Vers une redynamisation de la collectivité foncière, un redéploiement de l’identité autochtone et une résurrection du système coutumier en la matière ?
La Loi de 1994 consacre la notion de forêts communautaires. Il s’agit, suivant l’article 3-11 du Décret n° 95/531 du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, « du domaine forestier non permanent, faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et l’Administration chargée des Forêts. La gestion de cette Forêt, insiste-t-on, relève de la communauté villageoise concernée, avec le concours ou l’assistance de l’Administration chargée des forêts ». Cette nouvelle catégorie juridique indique clairement que l’État n’est que le gestionnaire du domaine national, et nécessairement que la mise en valeur de celui-ci n’exclut pas les communautés riveraines. C’est du moins l’expression de l’article 3-16 du Décret du 23 août 1995 : « Une convention de gestion d’une forêt communautaire [est] un contrat par lequel l’Administration chargée des Forêts confie à une communauté, une portion de forêt du domaine national, en vue de sa gestion, de sa conservation et de son exploitation pour l’intérêt de cette communauté »Footnote 192. Il va de soi que ces mesures seront réalisées suivant le système coutumier.
La forêt communautaire serait ainsi une victoire, un trophée pour les communautés coutumières. La Loi de 1994 reconnaît précisément aux populations riveraines le droit d’usage, à savoir un droit « d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle »Footnote 193. Cette reconnaissance s’étend, elle-même, jusqu’aux produits issus des forêts domaniales et communales pourtant affectées, qui au domaine privé de l’État et qui d’autre au domaine privé de la commune concernée. L’article 26 de la Loi de 1994 est particulièrement saisissant. Le texte subordonne le classement d’une forêt domaniale à la prise en compte « de l’environnement social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d’usage ». Et lorsque ces droits sont contraires aux objectifs assignés à la forêt classée, « les populations autochtones bénéficient d’une compensation selon des modalités fixées par décret »Footnote 194.
En somme, la réforme forestière de 1994, mieux que la foncière de 1974, octroie plus de droits fonciers aux populations autochtones. L’article 55 de la Loi relative au régime des forêts, de la faune et de la pêche indique clairement que l’exploitation d’une forêt communautaire se fait au profit de la communauté concernée. Mieux encore, « [l]es clauses particulières concernent les charges financières, ainsi que celles en matière d’installations industrielles et de réalisations sociales telles que les routes, les ponts, les centres de santé, les écoles, [seront] au profit des populations riveraines ». L’on pourrait postuler que le législateur camerounais s’est conformé à la Recommandation (n° 104) de l’Organisation internationale du travail relative aux populations aborigènes et tribales de 1957, d’après laquelle « [d]es mesures législatives ou administratives devraient être prises pour réglementer les conditions, de fait ou de droit, dans lesquelles les populations intéressées utilisent la terre »Footnote 195. La Loi de 1994 résout-elle pour autant la question foncière au Cameroun ? La reconnaissance des droits collectifs suppose-t-elle, pour l’espèce, une protection des titres de propriétés, une possible restitution ou compensation en cas de dépossessionFootnote 196 ? Voilà autant de questions qui méritent, indépendamment de celle liée à l’effectivité des droits proclamés, une attention soutenue. Sans en apporter satisfaction, nous pouvons au moins dire trois choses qui résument cette étude.
Primo, la forêt communautaire et les droits reconnus aux autochtones reconstituent la communauté parentale et la civilité « originelle » à partir de la communauté foncière. Le chemin est simplement inversé. Deuxio, la dualité juridique dans la gestion de la terre déjoue les pronostics qui laissaient entendre que le droit moderne s’imposerait sans concurrence. Il est ainsi conseillé aujourd’hui de parler de pluralisme institutionnel dans l’organisation du droit à la terre au Cameroun, et nécessairement d’infirmer, comme l’a fait le doyen Victor Emmanuel BokallyFootnote 197, la thèse de l’absolue suprématie du droit moderne en la matière. Tertio, la question de l’effectivité des droits ainsi proclamésFootnote 198 apparaît certainement inutile du moment où la justiciabilité des droits socioculturels semble bien établieFootnote 199. Jacques Mourgeon ne voyait-il pas en général la valeur d’un droit à « l’aspiration de l’homme »Footnote 200 ? Il en ressort nécessairement que la positivité du renouveau des droits des autochtones est toute offerte à leur détermination juridiqueFootnote 201.
Conclusion
Quoi qu’il en soit, la protection constitutionnelle des populations autochtones relance la réclamation des terres jusqu’ici gérées par l’État au détriment de ces dernières. Il ressort en effet au terme de cette étude que les politiques foncières ont reconfiguré l’ethno-géographie originaire au Cameroun à partir de la négation de la souveraineté foncière, la déportation et donc de la déterritorialisation des groupes. Le caractère désormais marchand de la terre qui illustre l’évincement du système coutumier au profit du droit moderne s’avère être, dans le même ordre d’idées, le facteur contemporain de l’inversion de la sédentarité du simple fait que les étrangers nantis du pouvoir économique se substituent aux natifs dans les régions du pays. Un auteur convoqué à plusieurs reprises a certainement mieux décrit le processus croisé « d’autochtonisation des allogènes et d’allogénisation des autochtones » en présentant la propriété foncière comme le ferment de l’implantation des premiers et de la déshérence des secondsFootnote 202. La formule semble particulièrement éloquente. Elle marque d’un trait frappant le brouillage identitaire qui suscite des interrogations au moment où le Conseil régional, conformément à l’article 57 de la Constitution, doit être présidé par une personnalité autochtone élue en son sein. Des repères peuvent pourtant aider à minimiser l’identification des autochtones dans chaque région du pays. L’année 1884 qui se réfère à un Traité dit germano-duala et par lequel le phénomène d’expropiation apparaît pour la première aux indigènes est l’un d’eux. Et comme l’a écrit en toute simplement mais non moins pertinnement Roger-Gabriel Nlep, est autochtone au Cameroun celui qui, en 1884, se trouvait dans une région précise. Comment contester aujourd’hui l’autochtonie des duala à Douala après l’expropriation dont ils ont été victimes en 1884 ? Comment méconnaître celle des Batanga à Kribi eux qui ont été déportés par les Allamends à Moliko dans le Sud-ouest anglophone ? Comment nier celle des Bamiléké à l’Ouest malgré la déterritorialisation qu’ils ont subie par les mêmes Allemands qui les ont réinstallés dans le Moungo pour des besoins de la main d’œuvre ? Que dire de celle des Bakweri, des Mbo, des Bgaya, des Boum, des Bikele ? La démocratisation du pays ayant favorisé avec l’avènement des domaines forestiers communautaires (Loi de 1994) le repositionnement de la collectivité foncière, les droits exercés dans ce cadre innovant et rompant avec les mesures édictées par les Ordonnances de 1974 permettraient également de préciser qui est autochtone de tel ou tel espace. Il serait en effet surprenant de voir par exemple la communauté Bakweri dans le Littoral revendiquer une forêt communautaire au Nord du pays. Cela n’est pour autant pas une mince affaire.
Le contexte démocratique suppose dans tous les cas une relecture des questions sociales. Et la sagesse africaine enseigne que le véritable remède provient de la racine même du mal. Tel pourrait se résumer l’intérêt (en le supposant) de la présente étude. L’avenir demeure, disons-le ainsi, incertain pour les natifs, si du moins le présent—qu’on sait profondément brassé ou métisséFootnote 203—n’est pas repensé. Il est sans doute grand temps de formuler de nouvelles synthèses, d’instituer par exemple une double autochtonie : une de fait et l’autre de droit. Toutes deux récompensées comme telles, afin que les souverains naturels des terroirs et les nouveaux propriétaires terriens aient une lisibilité sur leur devenir sociopolitique. Qui peut de fait apporter l’évidence de ce que les descendants de tous ceux qui ont acquis la terre à titre de droits réels immobiliers à Douala ou ailleurs y demeureront des allochtones dans un siècle ou deux ? La question garde tout son sens aussi longtemps que l’autochtonie se réfèrera à l’occupation ancestrale de la terreFootnote 204. Il est donc question de tirer la sonnette d’alarme et d’indiquer une trajectoire dans la recherche d’ « une technologie de gestion pragmatique des sociétés plurales »Footnote 205 dont le Cameroun se trouve être une référenceFootnote 206.