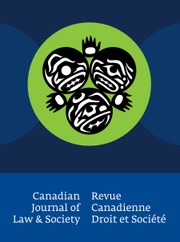L’ouvrage réalisé par Pascale Cornut St-Pierre a une double ambition : formellement, l’auteure se livre d’abord à une analyse juridique des contrats financiers qui enrichit la compréhension souvent délicate qu’en ont les juristes; substantiellement, l’auteure révèle ensuite les enjeux majeurs de pouvoir qui s’immiscent dans la gouvernance et l’encadrement juridique des swaps.
Assez peu évoquée en doctrine, la thématique revêt donc une importance majeure dans la compréhension des flux mondialisés qui construisent le monde économique global. L’ouvrage est particulièrement clair et bien construit, alliant théorie du droit (p. 55 et s.) et approche pragmatique du droit (notamment par l’étude de la jurisprudence, p. 171 et s.), ce qui permet au lecteur de se faire une idée intelligente des swaps, tant dans leur dimension théorique que contextuelle.
L’ouvrage démontre que les instruments dérivés ont révolutionné l’économie et la finance par la diffusion d’une « nouvelle culture du risque » (p. 41) qui a reconfiguré les savoirs, les espaces et les pratiques de la finance. En effet, l’émergence des swaps a offert un instrument de couverture favorable au développement du financement des entreprises par les marchés financiers, à un moment où, en parallèle, les méthodes de mesure du risque se renouvelaient profondément en accordant une place croissante aux informations produites par ces mêmes marchés et en délaissant celles produites par les entreprises. De l’industrie à la finance, de l’entreprise aux marchés financiers, d’une approche conceptuelle à une approche quantifiée, de l’échelon national à l’échelon mondial, les swaps auraient initié puis accompagné l’émergence d’une économie financiarisée. Dès lors, le calcul règnerait en maître au sein d’une finance qui imprègne désormais l’ensemble des agents économiques.
Mais l’auteure ne s’en tient pas à ce seul constat : elle s’interroge sur les forces souterraines qui sont à l’œuvre. Or, cette interrogation est très éclairante car elle met en lumière les non-dits du droit : les juristes ont adapté leurs pratiques et leur pensée à la nouvelle culture du risque, de sorte que l’approche institutionnaliste du droit financier qui prévalait jusqu’alors s’en serait trouvée fragilisée (p. 55). La prise en compte du risque a ouvert la voie à une « norme par le calcul » d’origine privée, reprise et légitimée par les pouvoirs publics, sous l’influence de l’ISDA, association dont les travaux de standardisation auraient largement contribué au développement des swaps.
L’auteure décrypte le rôle et l’influence de l’ISDA qui a élaboré un cadre juridique uniforme à diffusion mondiale. Le travail de l’ISDA s’est organisé autour d’un exercice de définition, avec, en particulier, l’élaboration d’un contrat-type largement repris par la pratique, le Master Agreement, qui doit être complété par des annexes dont la vocation est de préciser les termes économiques de la relation et qui ne revêtent aucune dimension juridique (p. 109 et s.). Ainsi, l’ISDA a érigé une véritable frontière entre l’encadrement juridique du contrat de swap et ses termes économiques.
C’est donc le droit qui est l’artisan innomé du succès des swaps. Ainsi, les juristes ont-ils défini la forme juridique des swaps en les considérant comme des objets sui generis, insusceptibles de qualification juridique (p. 144 et s.). Paradoxalement, la qualification juridique des swaps s’en trouverait neutralisée, alors qu’elle conditionne pourtant le régime qui leur est applicable (les swaps ne sauraient être qualifiés d’opérations de banque, ni de valeurs mobilières ou de paris, ni de contrats forwards, ni, enfin, de futures).
Si le rôle du droit est décisif au stade de l’élaboration du contrat de swap, il l’est tout autant au stade de sa mise en œuvre. L’étude de la jurisprudence révèle en effet l’usage et les manifestations économiques des swaps qui ont été utilisés comme des outils de contournement des réglementations (p. 175 et s.), dépassant largement la seule question de la gestion des risques.
Pour finir, l’auteure s’interroge sur les effets de la pénétration d’un modèle financier fondé sur la maîtrise du risque par le calcul dans la pensée juridique (p. 259). La prise en compte du risque systémique a opéré une reconfiguration en parfait accord avec les nouvelles aspirations globales et mathématiques d’un droit financier aux prescriptions quantifiées et quantifiables. Finalement, à travers l’exemple des swaps et en soulignant leur rôle dans la construction du droit – et le rôle du droit dans leur construction –, Pascale Cornut St-Pierre prend position contre les dernières évolutions de la réglementation financière, dont elle critique le cloisonnement au seul impératif de la gestion des risques par le calcul. De notre point de vue, l’ouvrage constitue ainsi un apport majeur à la compréhension de la globalisation financière sous l’effet du droit et d’un gouvernement par les nombres.