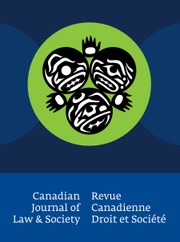Intérêt et domaine de l’étude. Au lendemain du divorce, les époux sont rarement dans une situation économique équivalente tant dans leur patrimoine que dans leurs revenus disponibles.
Quant aux revenus du travail et aux droits qui y sont directement attachés (retraite, assurances sociales etc.), la disparité au jour du divorce tient beaucoup au fait que chacun des époux ne dispose pas des mêmes atouts pour faire fructifier sa carrière professionnelle. Certains diplômes offrent davantage de perspectives de gains que d’autres. Si les qualités ou aptitudes personnelles des conjoints jouent un rôle variable dans l’acquisition de ressources, la progression d’une carrière professionnelle dépend aussi du degré de priorité qu’on lui consacre. Quant au patrimoine, le régime juridique appliqué aux biens acquis pendant ou même avant l’union est très variable selon les droits étudiés. Dans les pays de droit civil, le choix du régime matrimonial applicable aux biens et revenus acquis au cours du mariage peut également avoir des conséquences non négligeables sur la situation patrimoniale respective des époux lors du divorce, au contraire du droit anglais qui ignore la notion de régime matrimonial.
Au sens de la présente étude, la notion de « prestation compensatoire » recouvre les mécanismes juridiques visant à corriger les inégalités économiques auxquelles sont confrontés les époux au lendemain du divorce, en dehors de la liquidation des biens à proprement parler. Elle implique un transfert pécuniaire par l’un en faveur de l’autre, en capital ou sous forme de rente ou encore d’un transfert de propriété. La notion de « pension alimentaire » reste présente dans la plupart des législations, sauf en France et en Espagne où lui a été substituée celle de « prestation compensatoire ».
Ces transferts consécutifs à la rupture de l’union conjugale posent la question de leur justification : est-il juste qu’un ancien conjoint compense toute inégalité économique, quelle qu’en soit l’origine? On perçoit d’emblée que le mariage et les droits et obligations qu’il implique permettent de justifier la compensation de certaines inégalités économiques survenues en raison même du mariage ou durant celui-ci, mais d’autres justifications sont-elles possibles?
Tandis que de nombreux États européens ont profondément réformé le droit de la prestation compensatoire ces dernières décennies, nous nous sommes interrogés sur les raisons qui justifient encore l’allocation d’une prestation financière entre anciens conjoints, d’autant que pendant la vie commune, l’autonomie entre époux semble généralement valorisée plutôt que leur interdépendance, ce qui vaut a fortiori entre ex-époux.
Le débat sur les logiques à l’œuvre dans ces prestations paraît ainsi plus que jamais d’actualité, alors que les législateurs européens ont progressivement clarifié leur régime juridique. Les questions relatives à la transmissibilité, la variation, l’indexation ou la possibilité d’une saisie du débiteur en cas de non-paiement sont assez bien identifiées et font l’objet de règles précises. Celle du fondement peut dès lors à présent être posée pour elle-même, d’autant que dans la plupart des droits ayant subi des réformes législatives assez récentes, un élément commun reste la dissociation des torts et des effets du divorce. Il est ainsi particulièrement opportun d’étudier les incidences de la notion d’indemnisation autrefois réservée à l’époux innocent qui perdait le bénéfice des effets du mariage et principalement celui du devoir de secours.
Méthodologie. Neuf États ont fait l’objet de cette analyse comparée : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse qui, bien que soumis à des influences réciproques en raison de leur proximité géographique et de l’intensité de la circulation des personnes en Europe, présentent des droits et des traditions différents (français, germaniques, ou de Common Law). Outre l’étude de la législation et quelques études doctrinales qui seront référencées au cours de ces lignes, la comparaison se fonde principalement sur les réponses fournies par des chercheurs Footnote 1 de chacun des États visés à un questionnaire relatif au droit de la prestation compensatoire afin de mieux révéler la logique des rapports économiques entre ex-époux lors du divorce, hors liquidation des biens. Ces questionnaires visaient tant l’explicitation de la législation en vigueur – objectifs du droit, portée, critères d’évaluation – que les applications jurisprudentielles du droit à la prestation financière après divorce. Les résultats détaillés de ces rapports nationaux sont repris de la recherche COMPRES qui sert de base au présent article.
Pour pouvoir comparer les droits applicables, il faut s’entendre sur la méthode, ce qui revient à s’interroger sur des définitions, des modèles et des qualifications. Comme point de départ, il apparaît que si chaque législation examinée dans le cadre de cette étude prévoit la possibilité d’un transfert financier entre les anciens conjoints, aucune n’identifie précisément quelles inégalités économiques elle entend compenser ou atténuer. Nous avons par conséquent élaboré des modèles à partir d’une démarche externe au droit (I), qui nous ont permis ensuite de comparer les différentes législations (II).
1 La recherche de modèles de classification des prestations
1.1 L’insuffisance du modèle alimentaire vs indemnitaire
Une première comparaison a été opérée entre les législations européennes concernées par la recherche sur la base de leur terminologie juridique : prestation alimentaire d’un côté, compensatoire de l’autre. Dépassant les qualifications formelles (« pension alimentaire » ou « prestation compensatoire »), nous avons d’abord tenté de dégager un modèle théorique basé sur cette dichotomie, en travaillant sur les critères d’attribution de la prestation versée à un ex-époux en raison du divorce, ainsi que sur ses modalités de paiement.
Les différents critères auxquels les droits ont été confrontés ont été choisis pour leur pertinence à servir un objectif soit alimentaire, soit compensatoire. Une prestation de type alimentaire vise à répondre aux besoins du conjoint créancier. Pour évaluer ses besoins, il faut examiner différents facteurs tels que les ressources personnelles du créancier et ses charges, notamment l’hébergement des enfants, pondérées le cas échéant par l’existence d’une vie maritale. Une prestation de type compensatoire a pour objectif de compenser une disparité entre les niveaux de vie respectifs des conjoints après le divorce, ce qui suppose d’avoir égard aux ressources des deux conjoints, au train de vie avant le divorce, aux droits à la retraite. Sa fixation repose sur des critères tels que la durée du mariage ou les investissements du conjoint créancier dans la vie domestique ou la carrière de son conjoint.
Lorsqu’on confronte ces critères, issus de la loi et de la jurisprudence, on ne peut que constater que le droit à la prestation compensatoire en Europe ne se laisse pas appréhender selon une division entre critères alimentaires et critères compensatoires, mais qu’au contraire, les uns se combinent avec les autres.

Lorsque les critères que le juge est invité à prendre en compte sont appréhendés de manière linéaire, sur un pied d’égalité, ils ne permettent de révéler aucune différence notable entre ces législations, et la comparaison devient vaine. Cependant, cette apparente mixité des droits sur le plan de la justification – à la fois alimentaire et compensatoire – ne résulterait-elle pas d’une confusion entre des logiques compensatoire et indemnitaire? En d’autres termes, n’a-t-on pas opéré un amalgame entre deux logiques distinctes, la compensation et l’indemnisation? N’a-t-on pas associé des critères de type indemnitaire à une justification compensatoire et vice-versa, de telle sorte que des modèles a priori alimentaires semblent emprunter des caractéristiques compensatoires bien qu’ils prennent en réalité des accents indemnitaires et qu’on puisse en conclure que le modèle alimentaire vs indemnitaire n’est pas le cadre le plus pertinent pour comparer les législations?
1.2 L’élaboration d’un modèle à partir de la notion de compensation
1.2.1 Ce qu’il faut entendre par compensation : compenser n’est pas indemniser
L’origine latine du terme compensation, « compensare », implique l’idée de peser pour comparer. En droit civil, la compensation peut être présentée comme l’extinction totale ou partielle de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes ayant pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de même espèce. La notion de compensation est donc liée à celle de comparaison et sous-entend l’existence d’un déséquilibre entre ex-époux, dont l’origine est diverse.
Premièrement, le déséquilibre peut résulter de l’incapacité ou de la difficulté à devenir autonome sur le plan économique une fois le divorce prononcé. C’est une approche alimentaire de la compensation qui prédomine alors : une certaine redistribution des richesses est mise en œuvre, au nom d’un principe de solidarité au profit de personnes plus démunies qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas pourvoir seules à leurs besoins. Cette redistribution s’opère sur le constat de l’existence d’un besoin et sur la désignation d’un débiteur, privé ou public, pour y faire face.
Deuxièmement, le déséquilibre constaté peut suggérer un droit à réparation d’un préjudice subi par le créancier, même sans faute du débiteur. Si une indemnisation peut se concevoir sans faute, il faut que le dommage se situe dans une relation de causalité avec un événement générateur de responsabilité. Dans le cas de la prestation financière après divorce, cet événement pourrait être la rupture du mariage, ou l’organisation des époux durant la vie commune.
Enfin, troisièmement, le déséquilibre peut être l’expression d’un risque subi de type assurantiel. L’affiliation et la cotisation à un régime offrent la garantie de recevoir une compensation financière lorsque survient un évènement qui entraîne une baisse ou une perte de revenus ou de niveau de vie. Dans le droit des assurances sociales, on parle ainsi de compensation à propos des mécanismes de mutualisation destinés à supprimer des inégalités, notamment en matière de charges de famille. Dans le système de retraite, les différents régimes prévoient ainsi des avantages familiaux destinés à la compensation « du handicap professionnel, résultat de la naissance et de l’éducation des enfants » Footnote 3 .
1.2.2 Nécessité de distinguer la compensation de l’indemnisation
L’analyse amène à distinguer des fondements différents dans la prestation post-divorce selon qu’elle constitue une forme de compensation ou un mode d’indemnisation.
Ainsi, lorsqu’on examine plus particulièrement la prestation compensatoire française, son caractère délibérément forfaitaire plaiderait pour lui conférer un fondement indemnitaire plutôt qu’alimentaire ou assurantiel. Cependant, une indemnisation ne se conçoit que comme une forme de réparation d’un dommage qui peut être consécutif aux investissements d’un des conjoints dans la carrière professionnelle de l’autre ou dans l’éducation des enfants et qui se traduit généralement par une dévalorisation de son propre potentiel professionnel (absence ou manque d’expérience, absence d’actualisation des compétences, absence ou faiblesse de cotisation personnelle à un régime de retraite, etc.). L’objectif d’une telle indemnisation consiste à réparer tout le dommage, mais uniquement le dommage. En outre, l’engagement de la responsabilité en droit, et donc l’obligation d’indemniser, ne naît que si le dommage découle d’un fait générateur dont le débiteur est tenu pour responsable. Il faut donc a minima un lien causal entre le dommage et le fait générateur, même si une faute n’est pas requise. Le droit connaît en effet le concept de la responsabilité sans faute ou pour risque, en vertu duquel la loi désigne ceux qui seront tenus d’indemniser les dommages survenant dans le cadre de l’exploitation de l’activité considérée comme risquée.
Ne pourrait-on pas dès lors se fonder sur un concept plus large de responsabilité sans faute des époux, les obligeant à indemniser tout dommage subi par l’un d’eux en raison de la seule rupture de l’union conjugale pour fonder ce type de compensation économique post-divorce? Si le droit français de la prestation compensatoire – à l’instar d’autres droits comme le droit espagnol – prévoit que la prestation doit compenser la disparité née de la dissolution du mariage, on pourrait soutenir que le mariage génère une obligation réciproque d’assumer le risque d’une perte de niveau de vie suite au divorce. Le dommage serait alors la perte de revenus consécutive au divorce et le fait générateur résulterait de la rupture du mariage, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si une autre cause – un état de santé défaillant, par exemple – pourrait également être à l’origine de la disparité entre les revenus respectifs des ex-conjoints. Selon cette conception, il suffirait de constater la survenance du risque – le divorce – et le dommage financier qui s’en suit – la perte de niveau de vie qu’offrait la vie commune.
Toutefois, le droit de la responsabilité ne permet pas d’appréhender toutes les situations qui sont rencontrées par la prestation compensatoire. Il faut en effet constater que les prestations compensatoires, rapidement cataloguées d’indemnitaires, ne répondent pas complètement à cet objectif, qu’il s’agisse de la prestation compensatoire telle qu’elle est définie et appliquée en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne. En réalité, ce qui fait l’objet d’une « compensation », dans ces trois régimes, n’est pas le dommage personnel d’un conjoint en tant que tel, mais la disparité entre les situations économiques respectives des anciens conjoints, sans rechercher l’origine de celle-ci. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, l’existence d’un lien causal n’est pas requise entre l’origine de la disparité et la rupture du mariage pas plus que la preuve d’un dommage, qu’au surplus, elle ne viserait pas à indemniser intégralement. De surcroît, il faudrait refuser de compenser la partie du dommage dont le créancier porterait lui-même une part de responsabilité, par exemple lorsque le couple a décidé de commun accord que l’un d’eux renoncerait à toute activité professionnelle, ce qui n’est évidemment pas le choix des tribunaux. Dommage et disparité ne peuvent donc être confondus. Hors des traditions de droit civil, le raisonnement pourrait être transposé, comme on le voit en droit anglais qui n’examine pas l’origine, et donc le lien causal, de la disparité des situations économiques pour fonder le droit du conjoint créancier. Footnote 4
Ainsi, même à pousser le mécanisme de la responsabilité dans ses retranchements les plus objectifs, comme dans les cas de responsabilités sans faute, dans aucun des systèmes étudiés, la compensation post-divorce, quelle que soit son appellation et ses composantes tantôt alimentaires tantôt « purement compensatoires », n’est conditionnée à la recherche d’un lien causal entre la disparité – considérée comme le dommage – et le fait générateur de responsabilité – le mariage.
C’est pourquoi, dépassant le droit positif, dans l’objectif d’identifier les logiques possibles des prestations financières après divorce, il paraît plus adéquat de faire une nette différence entre les termes « indemnitaire » d’une part et « compensatoire » d’autre part, ce dernier étant expurgé de toute logique d’indemnisation d’un dommage mais incluant des logiques tantôt alimentaires tantôt « purement compensatoires » et qu’on qualifiera d’assurantielles.
1.3 La construction de modèles d’analyse des prestations compensatoires
1.3.1 La description des modèles retenus
-
1°) Tendance alimentaire
Dans un modèle alimentaire, l’objectif est de pourvoir à l’entretien de l’ex-conjoint. La loi crée une obligation de solidarité entre les conjoints du seul fait de leur mariage. Après le divorce, cette obligation ne disparaît pas. Selon les législations, elle se perpétue ou est muée dans une autre obligation alimentaire, de portée alors plus restreinte. Cette obligation de solidarité entre les anciens conjoints repose sur la notion de besoin qui sert à la fois de critère d’admissibilité au droit et d’évaluation du montant de la prestation. Elle est toutefois conditionnée par la circonstance que le débiteur dispose de ressources suffisantes pour en assumer la charge.
-
2°) Tendance assurantielle
En tant que statut, le mariage comporte, par le fait de sa célébration, un ensemble de droits et de devoirs pour les époux. Au-delà du régime matrimonial choisi par eux, il suppose une certaine communautarisation des ressources, à tout le moins le partage d’un même niveau de vie au cours de la vie commune. L’état des patrimoines et le niveau des revenus peuvent demeurer sensiblement différents entre les conjoints; il n’en demeure pas moins qu’ils partagent ce que l’on désigne fréquemment par « une communauté d’existence ». Les deux époux s’impliquent ensemble et s’investissent mutuellement dans cette communauté de vie et d’existence considérée sur un long terme, dans l’espoir de la perpétuer.
Sur le modèle économique de l’assurance, il est prévu qu’en cas de survenance du risque – à savoir la rupture de l’union conjugale – une prestation financière soit versée pour compenser la perte de cette communauté d’existence consécutive au divorce.
La « compensation » se distingue de l’indemnisation en ce que, d’une part, elle n’est pas fonction du dommage subi et que, d’autre part, il ne faut pas rechercher de lien causal entre le dommage et un fait générateur, fût-ce le mariage en tant que tel. Elle se distingue également d’une obligation de type alimentaire car son objectif n’est pas de combler les besoins du bénéficiaire, de sorte que l’évaluation de son montant n’est pas orientée par la seule nécessité d’y pourvoir.
La seule existence préalable du mariage, donc l’affiliation à un statut, et la survenance du risque, en l’occurrence le divorce, suffisent à justifier le droit à la prestation de type assurantiel.
-
3°) Tendance indemnitaire
Pendant le mariage, un époux peut avoir réalisé des investissements spécifiques dans la vie domestique (il met de côté sa vie professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants : temps partiel, cessation d’activité, pas de progression de carrière…) ou avoir participé à l’ascension professionnelle du conjoint (il finance ses études en travaillant, ou s’occupe de la vie domestique pour lui permettre de progresser professionnellement). Ces investissements sont rentables pour celui qui les réalise dès lors que le mariage dure et que l’époux les ayant réalisés bénéficie des revenus du couple, abondés notamment par ceux du conjoint. Si le mariage est rompu, ce type d’investissements s’avère en revanche coûteux pour l’époux qui les a réalisés et qui subit un dommage : du fait du divorce, le rendement attendu ne peut pas être honoré. Ce type de prestation aurait alors une fonction réparatrice du dommage généré par l’investissement en nature d’un des conjoints dans les charges du mariage. Afin d’opérer une distinction claire avec le type assurantiel, seule la contribution asymétrique aux charges et tâches conjugales et familiales sera considérée comme fait générateur de responsabilité.
1.3.2 Le choix des critères de répartition des législations dans les modèles retenus
Alors que dans une première démarche, les différents droits avaient été classés dans un modèle soit alimentaire, soit indemnitaire ou assurantiel sur la base de la présence dans ces droits de critères qui paraissaient pertinents pour chacun des modèles, le choix a été posé dans cette seconde démarche de recourir à des critères transversaux.
Ainsi, chaque prestation est analysée à la lumière de critères retenus comme caractéristiques des modèles proposés.
Ces critères sont les suivants : la période examinée par le juge (1°), l’admissibilité à la prestation (2°), les critères d’évaluation de son montant (3°) et son régime juridique (4°).
-
1°) La période de temps examinée par le juge
Le premier critère retenu est celui de la période de temps examinée par le juge. Ce critère de temporalité peut se comprendre de deux manières différentes. D’une part, le temps peut jouer un rôle sur le plan de la justification de l’allocation d’une prestation financière après le divorce. Dans cette perspective, il convient de déterminer quelle période de temps permet de donner sa légitimité à la prestation. D’autre part, après avoir franchi l’étape de l’admissibilité à la prestation, on peut s’intéresser à la période de temps que le juge prendra en compte pour évaluer le montant qui correspond à l’objectif fixé.
Selon la première dimension temporelle, celle qui assoit la légitimité du droit à la prestation, on constate que chaque type de prestation se fonde sur une période de temps spécifique. Pour une prestation de type indemnitaire, il s’agit de la période antérieure au divorce. En effet, c’est au cours du mariage qu’auront été réalisés les investissements et sacrifices qui donneront ensuite à un époux le droit de réclamer l’indemnisation corrélative. Dans une logique assurantielle, c’est la disparité économique apparue au moment du divorce qui justifie un certain équilibrage. Enfin, dans une justification de type alimentaire, c’est l’état de besoin survenant postérieurement à la rupture qui rend nécessaire le paiement d’une prestation financière.
Selon la seconde dimension temporelle, à savoir la période de temps que le juge examine pour apprécier l’étendue des droits du bénéficiaire de la prestation, les périodes de temps ont davantage tendance à se confondre, ou du moins à se superposer.
Dans une logique indemnitaire, la prestation après divorce est à la mesure du dommage encouru par le conjoint qui s’est investi dans le mariage sans en retirer les bénéfices escomptés. Ce dommage correspond à la perte économique encourue par lui en raison de son manque d’investissement dans sa propre carrière professionnelle. Il prend certes sa naissance pendant le mariage, mais il pourrait aussi s’étendre au-delà de la rupture lorsque la renonciation antérieure à des opportunités professionnelles continue à provoquer un manque à gagner ultérieur, sous la forme de revenus moindres en raison d’une expérience réduite, ou de promotions manquées, ou encore d’une durée d’occupation professionnelle réduite.
Conformément à une justification assurantielle, la disparité que le juge est invité à évaluer s’apprécie de manière dynamique, c’est-à-dire en anticipant l’évolution probable des forces économiques de chacun. Si la disparité doit exister au moment du divorce, son ampleur dépend aussi des perspectives économiques de chacun des conjoints au-delà du divorce.
Enfin, dans une perspective alimentaire, l’ampleur de l’état de besoin du conjoint bénéficiaire de la rente est appréciée par le juge au moment de la demande, ce qui correspond généralement au moment du divorce. Contrairement au modèle de type indemnitaire, les événements passés n’ont pas d’influence sur l’évaluation du montant de la prestation. Contrairement aussi au modèle de type assurantiel, seul l’état de besoin existant est rencontré par la prestation financière après divorce. L’évolution favorable ou défavorable de cet état de besoin pourrait faire l’objet d’ajustements successifs qui seront toujours effectués en considération du moment présent.
Dès lors que l’objectif principal de la présente recherche menée en droit comparé consiste à comprendre et à mettre en évidence les justifications des prestations financières après divorce prévues dans différentes législations européennes, nous retiendrons à titre de critère temporel la période de temps qui permet d’asseoir ou de conforter la légitimité du versement de la prestation.
-
2°) L’admissibilité à la prestation
La justification indemnitaire de la prestation financière après divorce repose sur le principe de la réparation d’un dommage économique dont l’existence constitue donc la cause. N’importe quel dommage économique n’entre cependant pas en ligne de compte pour obtenir une prestation financière après divorce. Le dommage doit résulter d’un investissement temporel important, par le conjoint qui réclame la prestation, dans le soin et l’éducation des enfants ou dans la carrière de son conjoint, au détriment de sa propre carrière professionnelle. Une indemnisation n’est possible que si l’un des époux a réduit ses activités professionnelles pour se consacrer au ménage, aux enfants ou à son conjoint. L’autre a d’ailleurs généralement tiré profit de cet investissement, car il lui a permis de développer plus aisément sa propre carrière. On peut donc en déduire que les deux époux ont investi ensemble dans une seule activité professionnelle, sans doute celle qui leur paraissait la plus rentable, alors qu’au moment de la rupture conjugale, l’un seulement en conservera le profit. L’enrichissement de l’un, consécutif à l’appauvrissement de l’autre, justifie a minima l’indemnisation de l’appauvrissement.
De son côté, la prestation de type assurantiel vise à compenser une disparité économique qui apparaîtrait entre les conjoints alors qu’ils ont partagé pendant une longue période de leur vie une communauté de sort et de niveau de vie. La compensation de la disparité se fonde non seulement sur l’existence même d’une disparité, mais encore sur une certaine durée de mariage. A l’instar du modèle économique de l’assurance, il convient d’avoir adhéré un certain temps au statut, d’y avoir cotisé dans une certaine mesure, pour pouvoir prétendre à certains droits acquis, en l’occurrence l’atténuation de la disparité économique qui subsisterait au moment de la rupture conjugale.
Le seul état de besoin suffit pour ouvrir le droit à la prestation financière de nature alimentaire. Il n’est pas nécessaire de justifier l’origine de cet état de besoin ni de l’ancrer dans la durée du mariage. Il suffit qu’il soit présent au moment de l’examen de la demande.
-
3°) Les critères d’évaluation du montant de la prestation
Dans une perspective indemnitaire, le montant de la prestation après divorce doit être à la mesure de l’ampleur du préjudice subi. Le juge devrait dès lors examiner la perte de revenus subie par le conjoint concerné tout au long du mariage. Idéalement, il faudrait que le juge puisse calculer la perte économique résultant de la mise en retrait du marché du travail du conjoint demandeur de la prestation. Ce préjudice pourrait résulter, d’une part, de la comparaison entre le potentiel professionnel de ce conjoint au début du mariage en tenant compte de l’évolution prévisible de sa carrière s’il avait continué à travailler à temps plein et à bénéficier de l’avantage de promotions et, d’autre part, le potentiel qu’il a éventuellement pu conserver au moment du divorce. Plus le mariage a duré longtemps, plus la carrière de l’autre conjoint a été exigeante, plus le nombre d’enfants est élevé, plus lourde sera la perte économique de celui qui a assuré pendant toutes ces années la tenue du foyer.
Ce calcul est évidemment complexe parce qu’il suppose l’évaluation de la perte de chances : chances de maintien de l’emploi à temps plein, de promotions, etc. Par ailleurs, le préjudice ne s’arrête pas au jour du divorce car le manque à gagner, dont l’origine se situe pendant le mariage, se poursuit tout au long de la suite de la carrière professionnelle et même au-delà, le conjoint n’ayant pas droit à une pension de retraite complète s’il a mis sa carrière entre parenthèses. Enfin, le conjoint qui, au cours du mariage, a déjà investi davantage dans le soin aux enfants que dans sa propre carrière, sera celui-là même qui continuera bien souvent à assurer la prise en charge principale des enfants après le divorce.
Lorsque l’objectif est plutôt assurantiel, la prestation doit compenser la disparité entre les situations économiques respectives des époux qui apparaîtraient au moment du divorce. Le calcul du montant de la prestation suppose la prise en compte des revenus et patrimoines des deux époux après la liquidation de leur régime matrimonial, de leurs perspectives respectives d’accès à des revenus et, dans ce cadre, de la répartition entre eux de la charge des enfants après le divorce, cet élément étant susceptible d’affecter les perspectives professionnelles de l’un d’eux. Puisqu’il convient de tenir compte des perspectives financières des deux époux, il faudra nécessairement avoir égard à leurs droits personnels aux régimes de retraite.
Les critères pertinents pour une prestation à tendance alimentaire sont ceux qui permettent d’éclairer le juge sur la situation financière actuelle du conjoint demandeur. Il sera cependant aussi amené à vérifier que la situation financière du débiteur de la pension alimentaire lui permettra d’en supporter le paiement régulier. Dans cette perspective, le juge devra prendre en compte les revenus et les besoins du conjoint créancier. Ceux-ci sont susceptibles d’être tributaires de la répartition de la charge des enfants du couple après le divorce. Exactement comme pour les autres types de prestations, le conjoint qui se chargera de l’hébergement principal des enfants subira généralement une diminution de son potentiel à bénéficier de revenus suffisants ou un frein au développement optimal de sa carrière professionnelle. Lorsque la vocation de la prestation est alimentaire, les revenus pris en considération par le juge pour évaluer l’ampleur du besoin s’entendent des revenus mobilisables par le créancier, autrement dit de sa capacité à dégager des revenus. Or celle-ci pourrait être entravée par un marché de l’emploi défavorable, un âge avancé, un état de santé défaillant et, bien entendu, l’éducation de jeunes enfants après le divorce.
-
4°) Le régime de la prestation
Que la prestation soit indemnitaire ou assurantielle, elle vise à compenser soit un dommage certain et déterminé, ou au moins prévisible, soit une disparité entre deux situations économiques à un moment donné. Dans les deux hypothèses, l’objet de la prestation doit être fixé à un moment précis. Il s’agit de faire les comptes au lendemain du divorce, de manière définitive. A propos du régime juridique, il en résulte que la prestation ne peut être révisée postérieurement à la décision qui la fixe. Logiquement, elle devrait être versée sous la forme d’un capital. Enfin, rien ne la distinguant d’une créance de droit commun, les voies d’exécution sont celles du droit commun des obligations.
A l’opposé, par sa nature, le modèle alimentaire ne permet pas de clore les comptes entre les époux au lendemain du divorce. L’obligation alimentaire née de cette rupture perdure un certain temps, soit le temps du besoin, soit le temps raisonnable dans lequel le besoin devrait avoir cessé. La prestation a donc vocation à évoluer au gré de l’état de besoin qui peut diminuer ou augmenter. Afin d’y correspondre au plus près, la prestation prend idéalement la forme d’une rente mensuelle, indexée chaque année. Destinée à pourvoir à l’entretien et à la subsistance de personnes, la prestation bénéficie d’un régime d’exécution favorable par rapport aux obligations de droit commun, permettant au créancier de saisir les biens et revenus du débiteur par des voies simplifiées et privilégiées.
2 L’application de la grille d’analyse aux législations étudiées
On trouvera ci-dessous un tableau récapitulatif détaillant les critères de répartition des législations dans les trois modèles retenus. Il est suivi d’une analyse État par État.
Tableau récapitulatif

2.1 Droit allemand
Le droit allemand se situe assurément dans une optique alimentaire, même si plusieurs critères pourraient inviter à penser que cette prestation aurait aussi, à titre secondaire, un objectif assurantiel Footnote 6 .
Le législateur allemand a en effet pris soin d’identifier les causes d’accès au droit à la prestation alimentaire après divorce, parmi lesquelles figure le manque d’autonomie d’un des conjoints causé par son investissement dans l’éducation des enfants Footnote 7 . Comme c’est le cas en droit suédois, l’énoncé dans le Code civil allemand des causes de l’état de besoin visé relève davantage de la justification de la persistance d’une obligation de solidarité de type alimentaire au-delà du divorce, plutôt que d’un critère d’admissibilité propre à un objectif indemnitaire.
Ces critères permettent au conjoint dans le besoin de bénéficier d’une pension alimentaire pendant le temps nécessaire pour trouver un emploi ou accomplir une formation qui lui permettrait d’en trouver un Footnote 8 . Le fait d’héberger les enfants à titre principal après la séparation aura même pour conséquence de le dispenser d’exercer une activité professionnelle tant qu’un enfant commun est âgé de moins de trois ans et il ne devra rechercher un emploi qu’à temps partiel ensuite Footnote 9 . Par ailleurs, comme dans le droit néerlandais ou suisse, de tradition germanique, la notion de besoin est appréciée sur la base du train de vie des époux au cours de la vie commune en mariage.
2.2 Droit anglais
En droit anglais, la prestation compensatoire doit être comprise comme un correctif dans le cadre de la répartition de l’ensemble des biens et revenus des conjoints après le divorce. Elle fait partie de la liquidation des avoirs des époux qui, à défaut d’existence d’un régime matrimonial, obéit à un principe de répartition égalitaire Footnote 10 . Cette répartition doit aboutir à corriger les inégalités économiques entre les conjoints constatées au moment de la dissolution du mariage Footnote 11 . L’objectif assurantiel paraît bien net. La répartition de type égalitaire de l’ensemble des patrimoines et ressources des époux permet de compenser les éventuels investissements ménagers effectués par l’un d’eux au détriment de son enrichissement personnel. Leurs contributions respectives aux tâches familiales reçoivent ainsi une même valorisation lorsque les comptes entre eux doivent être établis.
Le régime compensatoire adopté par le droit anglais constitue donc un outil d’indemnisation du conjoint qui s’est plutôt investi dans le ménage, mais sans passer par l’évaluation du dommage réel. Il s’agit en quelque sorte d’une évaluation forfaitaire du dommage compensée par une prestation fondée sur une répartition égalitaire des ressources Footnote 12 .
Cet objectif larvé d’indemnisation resurgit lorsque la répartition des biens et des revenus ne suffit pas à combler le dommage économique subi. Dans cette hypothèse, le juge peut compléter par une rente le partage des biens et des revenus acquis au jour du divorce Footnote 13 , de manière à permettre au bénéficiaire de participer à l’enrichissement à venir du conjoint, enrichissement permis par ses investissements en nature antérieurs.
2.3 Droit belge
Le droit belge a clairement opté pour le principe alimentaire, ce terme ayant été expressément ajouté à celui de “pension” lors de la réforme du 27 avril 2007 et le critère d’admissibilité étant devenu celui du besoin plutôt que celui du maintien du niveau de vie des époux au cours de la vie commune.
En revanche, la diversité des critères d’évaluation du montant de la pension alimentaire Footnote 14 démontre la difficulté rencontrée par le législateur belge à opter pour l’une ou l’autre logique.
En effet, si un état de besoin suffit pour permettre au bénéficiaire de percevoir une pension, ce qui indique une justification alimentaire, le juge peut lui accorder un montant supérieur à ce seul état de besoin eu égard à la dégradation significative de sa situation économique. Celle-ci peut provenir tant du mariage que du divorce Footnote 15 et résulter de l’âge ou de l’état de santé du bénéficiaire, de la longue durée du mariage, ou « du comportement des conjoints durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune et après celle-ci ». Elle peut donc justifier une augmentation du montant de la pension alimentaire qui peut aller jusqu’au maintien du niveau de vie des conjoints pendant la vie commune Footnote 16 . Lorsque cette dégradation résulte de la longue durée du mariage, de l’âge ou de l’état de santé du bénéficiaire Footnote 17 et que, sur cette base, ce dernier peut réclamer une pension conforme à son niveau de vie antérieur, on peut se demander si la pension ne traduit pas alors aussi une justification assurantielle. De même, lorsqu’elle résulte de l’organisation des époux quant à leurs tâches ménagères et parentales, on glisserait vers un fondement indemnitaire.
Cependant, tout comme en droit suisse, néerlandais ou allemand, le critère de la dégradation de la situation économique intervient non au titre de l’admissibilité, mais au regard de la détermination du montant de la pension. Néanmoins, à la différence de ces droits, l’organisation des époux au cours du mariage constitue un critère d’appréciation du montant en tant que tel, alors qu’en droit suisse, néerlandais ou allemand, il n’intervient que pour expliquer une capacité amoindrie de gains professionnels.
2.4 Droit espagnol
Malgré un régime qui s’apparente à la typologie alimentaire et l’emprunt au modèle indemnitaire de certains critères d’évaluation du montant, le droit espagnol semble se lover davantage dans une perspective assurantielle. Il n’est pas question ici de situation de « besoin ». En effet, c’est à l’aune du niveau de vie des époux, tant au cours du mariage qu’au lendemain du divorce, qu’il faut apprécier de manière dynamique une disparité entre eux : le conjoint qui la subit doit mettre toutes ses facultés en œuvre pour parvenir lui-même au niveau de vie considéré.
Cependant, plusieurs critères d’évaluation du montant de la prestation compensatoire s’apparentent davantage à une justification de type indemnitaire Footnote 18 . Bien qu’il ne soit pas nécessaire de rechercher l’origine de la disparité pour prétendre au bénéfice d’une prestation compensatoire, on a le sentiment, comme en droit français, que les circonstances qui l’ont forgée interviennent dans l’appréciation par le juge du montant de celle-ci. C’est aussi le cas en droit anglais, la doctrine anglo-saxonne justifiant le principe du partage égalitaire des biens et des revenus au moment du divorce par la nécessité d’apprécier de manière équivalente des contributions de nature différente aux charges du mariage.
2.5 Droit français
A la lecture de l’article 270 du code civil, le choix pour une prestation de type assurantiel ne fait pas de doute. Pourtant, les critères énoncés à l’article 271 ébranlent cette certitude. Dans une justification assurantielle, il ne devrait pas être nécessaire d’examiner les besoins du bénéficiaire ni les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, puisque seule la disparité constatée au jour du divorce, à l’exclusion des besoins, devrait déterminer le montant de la prestation sans avoir égard à son origine. Il paraît dès lors incongru de tenir compte des choix professionnels, puisqu’il devrait suffire de rechercher quelles sont les perspectives de gains futurs. A l’instar du droit belge, le droit français a consacré en apparence un type précis, sans parvenir à éviter d’emprunter quelques critères, voire des modes de raisonnement propres à d’autres modèles.
2.6 Droit néerlandais
Le droit néerlandais Footnote 19 adopte une justification assez proche du droit allemand ou du droit suisse : le régime juridique et l’objectif de la prestation sont aussi alimentaires. De même encore, les besoins sont identifiés à partir du niveau de vie des époux au cours de la vie commune et le temps consacré à l’éducation des enfants par l’un d’eux à titre principal justifie l’incapacité de celui-ci à assumer seul son entretien Footnote 20 . Le droit néerlandais s’inscrit néanmoins plus fidèlement encore dans la lignée du type alimentaire puisque la répartition des tâches parentales au cours de la vie commune n’intervient pas dans ce débat Footnote 21 .
2.7 Droit portugais
Le droit portugais connaît depuis 2008 deux régimes différents de prestations après divorce, dualité qui reflète la difficulté des législations à choisir entre différentes logiques.
Une rente alimentaire. La dualité des prestations financières après divorce instaurée récemment par le droit portugais devrait révéler des régimes cohérents par rapport aux types respectifs dans lesquels ces prestations s’inscrivent. Ainsi, dès lors qu’il existe une prestation spécifique dont l’objectif semble de type indemnitaire, la prestation alimentaire peut être délestée de toute origine ou de toute justification de type indemnitaire.
Il en résulte une prestation sous forme de rente, qui s’aligne presque parfaitement sur la typologie alimentaire et dont l’objectif consiste à répondre aux besoins du bénéficiaire Toutefois l’article 2016-A du code civil portugais prévoit la possibilité pour le juge de prendre en compte, pour déterminer les besoins du conjoint, la durée du mariage et la collaboration des époux à l’économie conjugale. Dès lors que le code civil ne définit pas la notion de « besoin » à combler par une pension alimentaire et qu’elle n’est pas non plus interprétée de manière univoque par la jurisprudence ou la doctrine, on peut penser que le critère de la durée du mariage pourrait avoir une influence sur le niveau de besoin pris en compte par le juge. Contrairement au droit belge, le code civil portugais exclut expressément la possibilité d’apprécier le besoin au regard du niveau de vie des époux au cours de la vie commune.
Une prestation compensatoire. La prestation compensatoire prévue par l’article 1676 (3) du code civil répond de façon adéquate à une justification de nature indemnitaire. Il s’agit d’un cas unique parmi les droits visés dans la présente recherche. Bien qu’il ne soit pas clairement précisé dans le code civil, l’objectif semble la compensation d’une contribution inégale sur le plan économique aux charges du mariage, et notamment dans le soin et l’éducation des enfants. Les critères et le régime de la prestation revêtent un profil cohérent. Il s’agit en effet de se retourner vers la période de la vie commune et d’examiner l’importance des pertes financières subies par l’un des époux. Néanmoins, il n’existe pas de méthode de calcul ni même d’indication de principe permettant de déterminer des critères précis pour évaluer de telles pertes. Compte tenu de la jeunesse de la disposition (2008), la jurisprudence n’a pas encore pu dégager de tels principes d’interprétation.
2.8 Droit suédois
Tandis que le droit suédois se situe nettement dans une logique alimentaire en ce qui concerne le montant alloué, on peut se demander si les critères d’admissibilité ne découleraient pas à la fois du type alimentaire puisque seul l’époux qui prouve un réel état de besoin peut y prétendre, et du type indemnitaire puisqu’il ne sera fait droit à une demande de pension que s’il existe un lien causal entre l’état de besoin et le mariage Footnote 22 . Pourtant, la tentation d’associer le droit suédois à un type indemnitaire ne résiste pas à l’analyse : premièrement, la prestation de nature indemnitaire, telle que nous l’avons préalablement décrite, ne vise que les investissements au profit des enfants ou du conjoint, alors que le droit suédois permet d’allouer une pension après divorce lorsque l’état de besoin découle d’une dépendance financière au sein d’un mariage de longue durée sans exiger qu’elle soit le résultat d’un investissement au profit du ménage Footnote 23 . Le critère d’admissibilité requis ne correspond donc pas exactement à celui qui caractérise la justification indemnitaire que nous avons retenue. De plus, l’exigence d’un lien causal particulier entre l’état de besoin et le mariage ne nous paraît pas constituer un critère d’admissibilité en tant que tel, mais davantage une justification rhétorique du maintien d’une obligation alimentaire entre les ex-conjoints. Alors que, pendant le mariage, l’obligation alimentaire repose sur l’engagement des époux au moment de leur union, celle qui existe après le divorce résulte d’une dépendance économique créée au cours du mariage Footnote 24 . Par conséquent, s’il est vrai qu’aucune pension ne sera accordée lors du divorce lorsque l’état de besoin d’un époux n’a pas sa source dans le mariage, c’est avant tout pour justifier l’existence de cette obligation de type alimentaire, et non pour indemniser des pertes économiques que l’époux aurait subies au cours du mariage.
2.9 Droit suisse
Le droit suisse est assez proche du droit allemand. Le droit à la prestation après divorce est assurément alimentaire dans son principe, sa justification et son régime, même si certains critères énoncés dans le code civil peuvent évoquer une préoccupation assurantielle ou indemnitaire. En effet, la notion « d’entretien convenable » Footnote 25 qu’il sied d’appliquer au montant de la pension alimentaire tend à la rapprocher d’une justification assurantielle et la prise en compte de l’organisation des époux durant la vie commune donne l’impression que le législateur aurait eu le souci d’indemniser le conjoint qui s’est investi dans le ménage en nature plutôt qu’en apports en argent issus d’une activité professionnelle Footnote 26 .
Mais l’impact de ce dernier critère sur l’octroi d’une pension alimentaire est limité. Il ne semble pas conditionner l’admissibilité du droit, ni en influencer le montant qui, en tout état de cause, doit si possible être fixé au regard du niveau de vie du couple au cours de la vie commune.
On peut sans doute soutenir que, comme en droit allemand, le type alimentaire domine : bien que l’éducation des enfants, très majoritairement par leur mère, constitue un critère déterminant dans le débat relatif au montant et à la durée de paiement de la pension alimentaire, l’idée n’est pas de compenser un niveau de vie acquis pendant le mariage, ni d’indemniser une mise en parenthèses de la carrière du conjoint bénéficiaire, mais plutôt d’apprécier le délai au terme duquel il paraît équitable d’exiger du conjoint dans le besoin qu’il assume seul son entretien. C’est dans le cadre de cette appréciation que le juge tient compte de l’éducation de jeunes enfants. Il admet que la mère qui assume l’entretien et l’hébergement des enfants à titre principal n’est pas tenue d’exercer une activité professionnelle tant que le plus jeune n’a pas atteint l’âge de dix ans et qu’elle ne doit exercer une activité professionnelle qu’à mi-temps avant que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de seize ans Footnote 27 .
Analyse et conclusion : quelles appréciations porter sur les justifications apportées par les droits étudiés?
En premier lieu, la comparaison des neuf législations sélectionnées pour la présente recherche offre un tableau des prestations financières après divorce en deux teintes majeures : une teinte alimentaire et une autre assurantielle. Le type indemnitaire n’est apparemment assumé que par le droit portugais au moyen d’une prestation bien spécifique et aux côtés d’une autre prestation de type alimentaire. La justification de type indemnitaire ne doit cependant pas être trop rapidement écartée. Sans apparaître au grand jour, le souci d’indemniser le conjoint qui s’est principalement investi dans le ménage plutôt que dans son activité professionnelle, d’où une perte économique, plane comme une ombre sur de nombreux droits. Ainsi en est-il assez nettement du droit anglais, dans lequel le partage égalitaire des biens et revenus constitue une manière d’indemniser le conjoint qui aurait négligé sa carrière professionnelle au profit de sa famille. Le droit belge et le droit français, alors même que le premier s’inscrit dans une ligne alimentaire et le second dans une ligne assurantielle, poursuivent ce même objectif, mais sans l’exprimer clairement puisque le montant de la prestation peut s’avérer plus généreux lorsque le conjoint potentiellement bénéficiaire s’est investi en temps pour son conjoint et leurs enfants. Dans le droit suédois et surtout dans le droit allemand, le fait d’avoir consacré les années de mariage à l’éducation des enfants constitue une justification parmi d’autres du maintien de l’obligation alimentaire après le divorce. En revanche, le droit néerlandais et le droit portugais ne semblent pas prendre en compte les soins donnés aux enfants durant l’union conjugale, mais uniquement leur impact sur la capacité de gains du conjoint qui les assumera à titre principal après le divorce. La justification de type indemnitaire semble ici résolument absente.
En second lieu, la question semble se recentrer sur l’étendue du droit à la prestation après divorce. Alors qu’une prestation à vocation alimentaire suppose a priori que son étendue se limite aux besoins du bénéficiaire, il apparaît que cette notion recouvre une portée économique particulièrement variable. Bien que l’on s’interroge toujours sur sa portée dans certains droits, portugais et belge notamment, dans d’autres, la référence au niveau de vie est habituelle comme en droit néerlandais, allemand, suisse, et elle est inversement tout-à-fait exclue en droit suédois. Ces différences dans le montant alloué par le juge s’expliquent au moins en partie par des facteurs externes au droit à proprement parler et qui peuvent être culturels, économiques ou sociaux. La nécessité de prolonger la solidarité après le divorce dépend en effet de l’offre de garde d’enfants en bas âge, des droits sociaux accordés aux personnes sans emploi, du type de régime matrimonial dominant ou du pouvoir du juge de garantir l’équité dans la liquidation de ce régime matrimonial, etc. La portée d’une prestation assurantielle paraît moins évidente encore, puisqu’une garantie apportée contre la création de disparités manifestes entre les niveaux de vie avant et après divorce n’implique pas nécessairement leur disparition, ce qui est particulièrement net par exemple en France et en Espagne mais doit être nuancé en droit anglais.
En troisième lieu, la justification patrimoniale du droit à la prestation bien que commune à l’ensemble des droits étudiés est d’importance variable et surtout relative. Par patrimoine on envisage ici l’ensemble des biens productifs ou non de revenus, échus à l’un et l’autre des ex-époux. On remarque ainsi que le droit à la prestation apparaît de manière directe ou indirecte dans l’ensemble des droits étudiés comme étant lié à la situation patrimoniale des époux après divorce soit par la convention passée entre époux soit par le juge appelé à trancher. Ainsi, il est généralement tenu compte de la liquidation patrimoniale pour fixer les droits qui reviennent au conjoint créancier de la prestation après divorce et en déterminer le montant. Toutefois, cette considération est généralement insuffisante à elle seule pour justifier la fixation d’une telle prestation, ce qui permet d’en relativiser l’importance par rapport à d’autres facteurs tels que les revenus, les droits au logement ou à la retraite par exemple.
Ces trois réflexions finales nous conduisent à penser que l’ensemble des prestations financières après divorce dans les droits étudiés se rejoignent autour d’une justification commune : celle de prévoir un mécanisme financier propre à éviter une chute importante et brutale de niveau de vie d’un époux consécutive au divorce. La prestation servirait ainsi à aménager la transition entre la solidarité conjugale qui caractérise le mariage et le retour à une autonomie financière pour chacun des ex-conjoints. En ce sens, on constate que les prestations à visées tant alimentaires qu’assurantielles ou indemnitaires tendent à limiter autant que possible la durée dans le temps de leur versement. Dans chaque législation analysée, le juge examine au terme de quelle période de temps le créancier sera capable de retrouver son autonomie financière. Les différences entre les systèmes juridiques ne seraient en définitive que des correctifs aux éventuelles spécificités de leurs contextes économiques et sociaux respectifs. Une telle approche permettrait non seulement de reconsidérer les dispositifs existants et de mieux apprécier leur efficacité et leur pertinence, mais aussi de questionner l’exclusivité matrimoniale en la matière. Dans nombre de pays étudiés en effet, le mariage est concurrencé par d’autres formes d’union dont la rupture pourrait justifier sans doute un mécanisme comparable fondé sur des situations objectives similaires à celles qui ouvrent le droit à des mécanismes compensatoires post-divorce. C’est également le cas en Amérique du nord, et tout particulièrement au Canada. A cet égard, la réflexion québécoise sur le devenir de la prestation compensatoire Footnote 28 pourra être utilement mise en perspective dans des recherches comparées sur les dispositifs mis en œuvre pour régler les compensations économiques lors de la séparation ou du divorce.