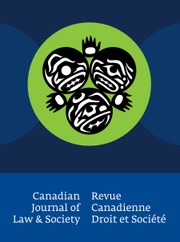Introduction
En 1975, la loi française, à la faveur d’une refonte complète du droit du divorce, a abandonné l’octroi de la traditionnelle pension alimentaire entre ex-époux au profit du versement d’une « prestation compensatoire ». Dorénavant, l’expression « pension alimentaire » ne concerne donc plus ce type de versement entre époux, contrairement à ce qui se passe au Canada notamment. Cette prestation compensatoire française ne doit donc pas être confondue avec la « prestation compensatoire » québécoise (art. 427, Code civil du Québec) dont l’équivalent, en France, est l’enrichissement sans cause. Footnote 1 La loi française s’est alors inscrite à rebours des solutions retenues par la plupart des droits européens, demeurés fidèles au maintien d’une obligation alimentaire entre ex-époux, expression d’un devoir de secours maintenu au-delà du divorce.
A partir de cette innovation et des débats qu’elle a suscités, tant chez les parlementaires que parmi les juristes français, le présent article entend mettre en lumière les justifications apportées par les acteurs du système juridique français à l’existence même d’une compensation financière après divorce. En effet, malgré l’importance des enjeux politiques et sociaux des conséquences économiques du divorce, la question n’est pas réglée par le droit positif français et elle reste peu débattue : quarante ans après l’insertion de la prestation compensatoire, le principe d’une compensation financière après divorce n’a pas trouvé de justification univoque.
Au-delà des incertitudes du droit positif, cet article apporte des éléments de réponse, grâce à l’étude des discours parlementaires et doctrinaux français. Cependant, l’analyse des débats politiques qui ont accompagné la réforme fondatrice de 1975 et les évolutions successives de la prestation compensatoire confirme cette incertitude : les parlementaires n’ont pas opté pour une justification plutôt qu’une autre, même si l’argument de l’investissement différencié de l’époux créancier dans les activités domestiques s’affirme progressivement. Les débats parlementaires montrent en effet une évolution du discours, sans pour autant choisir véritablement entre les différentes justifications possibles de la prestation. Quant à la littérature juridique de tous ceux appelés à appliquer, expliquer, commenter ou critiquer l’œuvre législative, elle se caractérise surtout par la place centrale offerte à l’analyse du régime juridique de la prestation compensatoire, notamment à l’aune de son interprétation jurisprudentielle. La doctrine civiliste française, positiviste, tout entière préoccupée à décrire le régime d’application d’une telle prestation, n’a finalement prêté qu’une attention très discrète à la question du « pourquoi » une prestation compensatoire. Il n’en reste pas moins que ces écrits illustrent, en filigrane, les enjeux politiques et sociaux des conséquences économiques du divorce, enjeux que l’on retrouve au sein des droits européens Footnote 2 et qui est d’actualité au Québec Footnote 3 . On remarquera cependant que le débat en France n’a pas dépassé la question du mariage et des conséquences économiques du divorce, laissant la question de la rupture des conjoints de fait « hors champ » : alors même que les raisons qui militent, au Québec, pour l’assimilation des situations juridiques des couples de droit et des couples de fait mériteraient d’être analysées pour la France, le débat n’y existe pas – ou très peu Footnote 4 . Cela revient à respecter la volonté prêtée aux couples en union libre Footnote 5 et à la faire prévaloir sur l’extension de la protection économique des conjoints – et notamment du plus vulnérable d’entre eux Footnote 6 .
1 Les enjeux des conséquences financières du divorce
Comment régler les conséquences financières d’un divorce? A cette question, les droits européens de tradition civiliste apportent généralement une réponse duale.
Il s’agit, en premier lieu, de partager entre les ex-époux les biens acquis et les dettes contractées pendant le mariage, les droits européens oscillant alors entre deux grands modèles de répartition, le modèle communautaire et celui de séparation de biens Footnote 7 . La communauté de biens entre époux permet aux conjoints d’unir leurs destinées patrimoniales : pendant le mariage ou à l’heure de la séparation, chacun des époux pourra profiter de l’enrichissement du patrimoine commun, fut-il alimenté uniquement par son conjoint, ou devra à l’inverse supporter le poids de ses errements financiers et participer de concert au paiement du passif de la communauté. Ce risque d’appauvrissement est d’ailleurs l’un des attraits du régime matrimonial concurrent, le régime séparatiste. Il permet aux époux de gérer leurs relations patrimoniales entre eux et avec les tiers sur le mode du chacun pour soi, celui du « chacun ses biens, chacun ses dettes », même si la vie de couple peut conduire à se défaire de cette stricte séparation des patrimoines. Mais quel que soit le choix ainsi opéré par les époux lors de leur mariage, et les difficultés que le partage et la liquidation du régime matrimonial peuvent parfois entraîner, le règlement de ces opérations complexes n’épuise pas à lui seul la question des conséquences financières du divorce. En effet, les droits européens ne se contentent pas d’organiser la liquidation des liens patrimoniaux noués dans le passé par les époux, ils offrent également la possibilité à l’un des ex-conjoints de bénéficier d’une créance contre son ex-époux, créance qui doit permettre à son bénéficiaire de se projeter plus sereinement dans l’avenir.
En effet, et c’est le second aspect de la réponse, le divorce peut fonder un lien d’obligations entre les ex-époux, l’un devenant débiteur au profit de celui qui subit le plus durement la rupture du train de vie habituel du ménage nécessairement entraînée par le divorce. En effet, si les inégalités de ressources entre époux sont masquées pendant le mariage, chacun contribuant en nature aux charges du ménage, elles deviennent visibles lors de la séparation et parfois difficiles à supporter pour le conjoint le moins bien loti financièrement. Certains époux divorcés ne sont tout simplement pas en mesure de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, que nous qualifierons d’alimentaires. Est-ce alors à l’ex-conjoint de lui apporter son concours? A cette question, les droits européens répondent tous par l’affirmative Footnote 8 . En effet, et bien que ce lien d’obligation prenne des formes et des terminologies diverses (pension alimentaire, prestation compensatoire, pension d’entretien, somme forfaitaire), il existe dans tous les droits romanistes la possibilité pour le futur divorcé, économiquement fragilisé par la rupture, soit de négocier à l’amiable avec son ex-époux, soit de solliciter du juge la création d’un rapport d’obligations à son profit, le paiement de cette créance pesant alors sur les épaules de l’ex-conjoint dans les limites de ses propres ressources. La « pension alimentaire » versée au profit de l’ex-conjoint constitue alors la figure emblématique de l’après divorce, figure dont le droit français a cherché à s’extraire en 1975 Footnote 9 . Cette convergence des droits européens s’explique largement par des raisons historiques et par le phénomène des transplants juridiques, le Code civil français de 1804, consacrant le premier dans la loi la pension alimentaire, ayant servi de modèle à de nombreux droits de la famille romano-germanique Footnote 10 . Depuis la période napoléonienne, les droits européens se sont détachés du modèle originel, les interprétations jurisprudentielles et doctrinales, les réformes législatives ponctuelles ou d’envergure étant autant d’étapes à l’autonomisation nécessaire de ces droits. On peut toutefois relever une direction générale commune à ces évolutions, inspirée par le souci de voir consacrer les principes de liberté et d’égalité au cœur des relations matrimoniales. De plus, en dépit des différences substantielles de régime pouvant être relevées entre les droits européens de l’après divorce Footnote 11 , l’idée de faire survivre « un petit quelque chose » du devoir de secours des époux après la dissolution du lien matrimonial demeure dans de nombreux droits, le principe du versement d’une pension alimentaire n’ayant pas été abandonné. Le droit français s’est révélé en ces matières l’un des moins fidèles au maintien de la pension alimentaire, une importante réforme du divorce du 11 juillet 1975 ayant substitué à la traditionnelle obligation alimentaire entre ex-époux, une indemnité nouvelle, nommée prestation compensatoire. Cette prestation, en principe forfaitaire et qui doit prendre la forme d’un capital, était à l’origine non révisable. Le législateur français a ainsi entendu, dans un même mouvement, libéraliser le divorce en ajoutant de nouvelles causes de rupture au seul divorce pour faute, et rompre avec le règlement traditionnel des conséquences pécuniaires du divorce, destiné avant tout à assurer un minimum de subsistances aux épouses désargentées. Mais cette prestation compensatoire s’éloigne-t-elle véritablement de l’idée d’assurer les besoins alimentaires des ex-épouses sans emploi et sans ressource? La nouvelle direction prise par le législateur entendait-elle vraiment rompre définitivement avec toute logique alimentaire au profit d’une seule logique compensatoire destinée à compenser les inégalités économiques constatées au moment du divorce? Les justifications du maintien d’une compensation après divorce ont-elles jamais été discutées? En effet, comment justifier le maintien d’un tel lien d’obligation, alors même que le lien matrimonial est dissout?
Le droit positif français, en multipliant les critères de décision du juge, est d’un secours limité et fait peser des incertitudes sur la logique à même de justifier cette compensation. Parmi les textes qui prévoient la prestation compensatoire, les articles 270 et 271 du Code civil sont fondamentaux sur la question qui nous occupe : ils fixent les circonstances qui ouvrent droit à une prestation compensatoire. Ils indiquent que, si « [l]e divorce met fin au devoir de secours entre époux » (al. 1 Art. 270 C. civ), il n’en reste pas moins que « [l]’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives […] » (al. 2 Art. 270 C. civ), cette prestation étant fixée à la fois « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (al. 1 Art. 271 C. civ) et en tenant compte d’une liste non limitative de critères qui sont la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et enfin leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits due aux choix professionnels liés à l’éducation des enfants ou à la carrière de l’autre conjoint (al. 2 art. 271 C. civ.).
Les différents critères retenus pas la loi renvoient à plusieurs justifications possibles du maintien d’une obligation entre époux divorcés, en mêlant ce qui ressort de l’indemnisation directe de l’investissement dans les activités domestiques ou dans l’activité professionnelle de l’autre, ce qui ressort de la compensation des différences de fortune, qu’elles soient ou non nécessairement liées à un retrait du marché du travail (faiblesse des droits à la retraite, qualification et situation professionnelles, patrimoine et droits estimé ou prévisibles) et ce qui ressort de la difficulté à acquérir une autonomie économique (âge et état de santé, éventuellement durée du mariage), sans oublier le mariage lui-même qui serait au fondement d’une obligation d’autant plus importante qu’il aurait duré plus longtemps. Cette profusion ne permet pas d’identifier une justification qui fonderait, plus que d’autres, le droit à une prestation compensatoire.
L’évolution des textes depuis 1975 est plus éclairante. Alors que la loi de 1975 mentionnait, sur le terrain de l’indemnisation de l’investissement dans les activités domestiques, « le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants », le texte issu de la loi de 2004 vise désormais « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière antérieure de son conjoint au détriment de la sienne », tandis que la loi du 9 novembre 2010 a ajouté au critère de la « situation respective en matière de pensions de retraite » l’estimation de la diminution des droits à la retraite causée par ces circonstances. Dans le même sens, la loi de 2000 a remplacé « la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion » Footnote 12 par le critère de la situation respective des époux en matière de pension de retraite, admettant ainsi que l’épouse puisse avoir des droits propres à la retraite, mais des droits diminués du fait de la faiblesse de son investissement professionnel, comme ce sera explicitement introduit par la loi de 2010. Ainsi, le caractère indemnitaire de la prestation semble se renforcer progressivement, sans jamais que la loi ne le dise expressément. Cependant, la loi continue à proposer aussi des critères relevant d’une autre logique, de sorte que cette évolution vers un renforcement progressif du rôle joué par l’investissement différencié sur le marché du travail est contrebalancée par d’autres évolutions : en 2000, la loi insère dans les textes le critère supplémentaire de la durée du mariage, semblant tirer à nouveau cette prestation du côté d’une obligation issue du mariage conçu comme une institution; les lois de 2000 et 2004 ont également renforcé la possibilité de réviser (seulement à la baisse) le montant de la prestation compensatoire, possibilité qui devait avoir, dans la conception initiale de la prestation, un caractère très exceptionnel et qui renforce le caractère alimentaire de la prestation en se fondant sur les capacités contributives du débiteur. Ce faisant, la loi admet la prise en considération de l’évolution des situations des ex-époux et s’écarte de la fixation du prix du sacrifice.
Les justifications du versement d’une somme d’argent entre les ex-époux, au-delà de la liquidation de leurs éventuels biens communs sont, brièvement décrits, de trois ordres : une obligation qui résulterait directement du mariage et qui fonderait le droit de ne pas être laissé dans le besoin par son ex-époux, au nom d’une solidarité familiale continuée; une obligation qui résulterait directement du mariage et qui aboutirait à la prolongation pour un temps, au moins en partie, du niveau de vie préalablement partagé; une obligation qui résulterait de l’organisation domestique pendant le mariage et qui fonderait le droit d’obtenir la réparation du préjudice matériel né de cette organisation.
Les enjeux sociaux des conséquences économiques du divorce croisent ces trois justifications possibles. En premier lieu, on notera que, malgré la neutralisation des législations qui désignent indifféremment « les époux », cette obligation a pour objectif de pallier les difficultés économiques des épouses divorcées dans une société où, si les femmes exercent plus souvent une activité professionnelle qu’autrefois, elles travaillent cependant moins souvent, pour des revenus inférieurs, et suspendent souvent leur activité professionnelle à la suite des naissances, pour un temps plus ou moins long. La prestation compensatoire peut donc être considérée comme une forme de compensation des inégalités de genre, compensation assurée par la sphère privée – en l’occurrence l’ex-époux –, avec des relais possibles dans la sphère publique, dès lors que le débiteur n’est pas en mesure de verser une compensation suffisante ou que la loi limite cette compensation à un niveau insuffisant.
On notera également que les deux premières justifications exposées rattachent expressément la compensation à l’existence d’un mariage, offrant aux femmes relevant de cette forme d’union une protection spécifique et excluant les ex-concubines. La situation est différente dès lors que la compensation est fondée sur l’organisation domestique de la famille, spécialement en présence d’enfant(s), dès lors que le préjudice subi par les femmes est comparable et trouve sa source dans cette organisation domestique. Certes, on peut considérer que le versement de cette somme d’argent entre les ex-époux constitue l’une des rares différences encore existantes entre mariage et concubinage Footnote 13 , le statut des enfants étant dorénavant identique, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Mais on peut aussi avancer qu’offrir aux concubins des droits comparables aux époux revient non pas à faire disparaître la spécificité du mariage mais à faire entrer les concubins en mariage Footnote 14 . En outre, rapprocher le statut civil des époux et des concubins pourrait mettre un terme aux débats sur la disparité de la définition de la famille selon que l’on se situe sur le terrain du droit civil ou sur le terrain des droits socio-fiscaux. Surtout, cette assimilation des conséquences de la rupture permettrait de prendre acte de l’équivalence fonctionnelle de ces deux modes de vie, et d’étendre la protection accordée au conjoint économiquement vulnérable Footnote 15 , en faisant prévaloir cet impératif de protection sur la volonté conjointe présumée des membres du couple Footnote 16 .
Si l’on veut bien dépasser la question de l’opposition entre mariage et concubinage, il reste alors à se demander si la protection accordée par le droit civil aux membres du couple, en raison de leur vie en couple, mérite d’être maintenue ou écartée, au nom de l’autonomie de la volonté, dans une conception libérale des relations sociales. Le rapport Roy illustre très bien cette problématique, en se fondant sur la protection de l’autonomie de la volonté pour permettre aux concubins d’adopter un statut juridique modélisé (opting-in) et aux époux de sortir d’un droit matrimonial pourtant essentiellement construit sur un modèle séparatiste (opting-out). Mais la neutralisation des législations, qui désignent indifféremment « les époux », ne doit pas faire oublier que permettre l’abandon de la protection qu’apporte le statut civil (protection pour l’heure limitée aux époux au Québec comme en France) au nom de l’autonomie de la volonté revient à supprimer la compensation dont les épouses bénéficient et qui peut, pourtant, être lue comme une compensation des inégalités de genre. En d’autres termes, la disparition de la protection des époux revient à la disparition de la protection des femmes divorcées. Certes, nos sociétés évoluent et la protection de la femme mariée peut être regardée comme un combat d’arrière-garde qu’il convient d’écarter au nom de l’égalité formelle. Sauf à constater qu’une discrimination positive peut efficacement compenser des inégalités bien réelles.
2 Les justifications de la prestation compensatoire dans les travaux parlementaires Footnote 17
La lecture des travaux parlementaires consacrés à la prestation compensatoire depuis son instauration en 1975 montre que les parlementaires se sont avant tout préoccupés de la situation matérielle des femmes divorcées, supposées économiquement dépendantes, avant de se préoccuper du sort ainsi fait aux maris débiteurs. La volonté d’indemniser un préjudice subi par des femmes ayant consacré une partie de leur vie à leur famille est plus récente. Si elle s’affirme progressivement, les débats récents montrent qu’elle ne justifie cependant pas, à elle seule, le versement d’une prestation.
2.1 La nécessité de venir en aide aux femmes divorcées dans le besoin
Les travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 11 juillet 1975 instaurant la prestation compensatoire s’attelaient avant tout à la tâche de réformer un droit du divorce. La discussion sur les situations devant autoriser le divorce était alors essentielle et la présentation du projet de loi par le Rapporteur de la commission des lois se centre presque exclusivement sur les causes du divorce. Le débat porte sur la libéralisation du divorce et son lien avec le mariage conçu comme institution, au fondement de la famille et de la société : malgré la libéralisation du divorce présentée comme nécessaire pour suivre les mœurs et ne plus assister à la comédie judiciaire imposée par le seul divorce pour faute, la loi doit conférer à l’union conjugale une signification durable dès lors qu’elle a existé dans le temps et modifié la situation respective des époux. C’est une responsabilité du législateur qui découle de « l’état même de mariage conjointement assumé ».
Dans cet ensemble, la prestation compensatoire était une notion « absolument nouvelle », détachée de la faute et fondée sur la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. Supprimer la pension alimentaire entre époux divorcés qui prévalait jusqu’alors revenait à mettre un terme au devoir de secours, c’est-à-dire à rompre le lien qui perdurait entre les époux, bien que divorcés. Pourtant, la lecture des travaux parlementaires montre que la conception d’un mariage institution, qui survit au-delà du divorce, est encore puissante, de sorte que la prestation compensatoire est souvent présentée comme fondée directement sur le lien matrimonial et l’engagement qu’il suppose et dont il faut assurer le sérieux. Ainsi peut-on lire que « A travers ce projet de loi, il nous faut réaffirmer que le mariage est beaucoup plus qu’un contrat, qu’il est un engagement vécu dans la durée. C’est ce qui fait la valeur de notre forme de civilisation qui repose sur la responsabilité et la liberté » Footnote 18 ou encore que « le mariage est une union perpétuelle, sinon indissoluble […] c’est une union de vie » Footnote 19 , un « lien contractuel majeur puisqu’il porte non pas sur les biens mais sur les personnes elles-mêmes et sur toute leur vie » Footnote 20 . Sur cette même logique d’un mariage qui comporte « des devoirs de beaucoup supérieurs aux droits qu’il crée » et qui « reste le fondement même de la famille » Footnote 21 , la commission des lois insistera d’ailleurs sur le rôle à donner à la durée du mariage dans la fixation de ce montant.
On note également que la prestation compensatoire n’est jamais évoquée comme bilatérale, malgré le libellé des textes discutés : la discussion porte seulement sur les femmes délaissées par leur mari, et qui vont se trouver dans une situation économique et humaine difficile après avoir consacré leur vie à leur foyer. Ainsi, le manque de ressources des femmes divorcées est-il clairement évoqué, de même que son lien avec l’organisation familiale qui a prévalu pendant le mariage, mais elle n’est que très exceptionnellement Footnote 22 rapportée à une question générale de l’égalité entre les hommes et les femmes : il s’agit de leur permettre de faire face à leurs besoins, alors qu’elles n’auront pas les moyens d’y pourvoir seules, certains parlementaires relevant également qu’elles n’auront pas non plus les moyens de trouver un nouvel époux, les charmes des femmes se fanant plus vite que ceux des hommes, d’autres regrettant que l’on bâtisse la société sur les seuls rapports de production, aboutissant à proposer comme idéal « à la femme », « de produire dans une usine et non de dispenser la tendresse dans un foyer où règne l’amour et où les époux peuvent vivre l’un par l’autre et, ensemble, construire une meilleure société ».
Dans les années qui suivront le vote de la loi, la question de la « nature » de cette prestation sera le seul sujet des six questions parlementaires posées de 1981 à 1993 par les élus au gouvernement : à chaque fois, c’est le caractère « indemnitaire » de la prestation qui sera mis en avant, mais jamais à propos de l’investissement différencié des époux dans la vie domestique. Cette nature dite indemnitaire est opposée à la nature alimentaire de la pension et justifie le caractère non révisable de la somme fixée à l’occasion du divorce : puisqu’il ne s’agit pas de pourvoir aux besoins de l’épouse divorcée – ni de s’adapter aux ressources de l’époux créancier, mais de verser une somme constitutive d’une forme d’indemnisation de la disparité des ressources, évaluée au moment du divorce, alors la révision de cette somme n’est pas possible alors même qu’elle peut être versée dans la durée. Ce caractère non révisable, au centre des débats, sera rappelé par le Garde des sceaux à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi (1984) visant à autoriser le débiteur de la prestation versée sous forme de rente à la racheter par le versement d’un capital. Il indique que la prestation vise à réparer « le préjudice que le divorce cause à un conjoint au moment où se produit la dissolution de l’union », en laissant comme précédemment la question de l’organisation domestique dans l’ombre.
2.2 La nécessaire protection de l’homme débiteur (et de sa nouvelle famille)
Le débat parlementaire sera relancé à l’occasion de la réforme de la prestation compensatoire par la loi du 30 juin 2000. Cette réforme met un terme à un long processus qui a vu le dépôt de quelque sept propositions de loi (donc d’origine parlementaire) successives, issues de différentes familles politiques, dont la dernière a finalement été mise à l’ordre du jour du parlement par le gouvernement. Lors de cette discussion, les objectifs poursuivis par la prestation compensatoire instaurée en 1975 seront rappelés, et dès ce moment, l’ambigüité qui prévaut apparaît : selon les différents locuteurs, il s’agit de régler en une seule fois les conséquences pécuniaires du divorce afin de mettre fin au contentieux, d’éviter de perpétuer des versements entre époux et de retarder la sortie effective du mariage Footnote 23 , de maintenir une certaine égalité dans les revenus des ex-conjoints Footnote 24 ou, plus modestement, de remédier à l’abaissement du niveau de vie Footnote 25 , voire d’assurer des moyens de subsistance à l’ex-conjoint, le temps qu’il s’adapte à sa nouvelle situation Footnote 26 .
Les débats font également apparaître les justifications prêtées à la prestation. Le mariage reste considéré en lui-même comme créateur d’obligations, devant assurer la perpétuation d’un statut Footnote 27 ou, a minima, un devoir d’assistance Footnote 28 . Il engage la responsabilité des époux et justifie de compenser le préjudice causé par la rupture Footnote 29 ou encore d’indemniser la disparité créée par la seule rupture Footnote 30 . L’idée que le mariage a pu conduire une épouse à des renoncements, en termes de carrière, pour suivre son époux et élever les enfants est présente et elle s’articule avec celle de « responsabilité » : celui pour qui l’épouse a fait ces renoncements doit assurer le maintien de son niveau de vie. Mais s’il est juste que l’époux verse une prestation à la femme démunie, cette exigence devient injuste dès lors que l’ex-épouse travaille ou est entretenue par un nouveau conjoint, ou que l’époux débiteur se trouve au chômage Footnote 31 .
Les solutions retenues en 1975 sont présentées comme un échec, parce que la prestation reste souvent attribuée sous forme de rente, ce qui lui donnerait un caractère alimentaire, et que le caractère exceptionnel de la révision serait source d’injustices en cas d’évolution favorable ou défavorable des situations économiques respectives du créancier ou du débiteur, conduisant parfois à des « situations humainement intolérables » : elle doit pouvoir s’adapter à la précarité de l’emploi Footnote 32 , ne pas empêcher l’époux débiteur de refaire sa vie Footnote 33 ou provoquer un sentiment d’iniquité de l’ex-époux au chômage, en charge d’enfants d’un deuxième lit ou même des secondes épouses contraintes de verser une rente à une première épouse inconnue disposant parfois de ressources supérieures Footnote 34 . Elle ne serait plus adaptée aux évolutions contemporaines Footnote 35 . Ces critiques aboutiront à l’ouverture des possibilités de révision de la prestation compensatoire, qu’elle soit fixée sous forme de capital versé en plusieurs annuités ou sous forme de rente, mais révision à la baisse exclusivement. Une loi du 3 décembre 2001 renforcera encore le mouvement en donnant aux époux divorcés par consentement mutuel, soumis aux termes de leur convention homologuée par le juge, et qui pouvaient jusqu’alors demander l’homologation d’une nouvelle convention prévoyant une révision de la prestation, la possibilité de recourir également aux textes autorisant la révision dans le cadre des divorces contentieux. Pour eux, la révision devient donc possible sur décision judiciaire, indépendamment de leur accord préalable, et toujours à la baisse.
Ces solutions montrent que l’on est loin du seul terrain de l’indemnisation de l’investissement domestique : la logique de compensation des disparités créées par la rupture prévaut, détachée des causes de cette disparité et sous réserve qu’elle soit appréciée à l’aune de la capacité contributive actuelle et à venir du débiteur, qui peut choisir de faire prévaloir d’autres obligations. Le caractère forfaitaire de cette compensation sera également amoindri, dans cette même réforme, par les limites apportées à la transmissibilité passive de la dette.
2.3 D’une obligation née du mariage à la répartition du risque économique pris par les femmes mariées?
La dernière réforme de la prestation compensatoire est inscrite dans la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Intervenue seulement quatre ans après le texte précédent, les débats auxquels elle a donné lieu montrent pourtant une assez nette évolution, malgré un partage toujours présent entre l’idée d’un devoir de solidarité issu du mariage et celle d’une responsabilité de réparation liée à un investissement différencié des époux dans les activités domestiques.
Le débat sur l’équité se focalise sur la possibilité de refuser la prestation à l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé et qui remplirait par ailleurs les conditions pour en bénéficier : ce refus devient très exceptionnel et doit être justifié par l’équité. Il reste cependant, dans la suite des débats de 2000, des évocations de l’iniquité qui consisterait à imposer au débiteur d’enrichir l’époux créancier Footnote 36 . L’essentiel reste cependant un débat, parfois implicite, entre la prestation comme une obligation née du mariage et la prestation comme une manifestation de la responsabilité de l’époux qui doit assumer les conséquences des choix réalisés au cours du mariage. On peut lire que la famille est « l’élément naturel et fondamental de notre société » Footnote 37 et qu’elle doit continuer d’assumer son rôle structurant Footnote 38 ; que le mariage ne doit pas devenir qu’un simple contrat mais qu’il est une institution républicaine fondamentale qui fonde des devoirs réciproques des époux Footnote 39 et que de l’engagement matrimonial, source de responsabilité Footnote 40 , naît des responsabilités particulières Footnote 41 , de sorte que « le divorce ne tire pas un trait définitif sur le passé et le couple, même séparé, doit continuer à assumer les conséquences de ses choix de vie » Footnote 42 . Et lorsque le mariage est présenté comme un contrat, il n’en reste pas moins qu’il comporte « des engagements, des obligations et des droits qui créent des devoirs, notamment à l’égard de l’ex-épouse qui, après s’être consacrée à sa famille, est hospitalisée, malade, et n’a pas de possibilité de retrouver un emploi » Footnote 43 . Mme Geneviève Levy, rapporteur pour la Délégation aux droits des femmes affirme également que la solidarité entre époux doit encore prévaloir au stade des conséquences du divorce Footnote 44 .
Parallèlement à ces arguments apparaît un discours qui s’appuie explicitement sur les engagements différenciés des époux pendant les années de mariage et les inégalités économiques qui en résultent, le plus souvent sous l’idée générale de “responsabilité”. Par conséquent, il est affirmé que les critères d’attribution et de fixation de la prestation doivent prendre en compte plus largement les conséquences résultant des choix faits pendant la vie commune sur le plan professionnel, afin de compenser une différence de niveau de vie qui résulte de la répartition des rôles pendant la vie commune, au-delà du simple moyen d’assurer un équilibre économique à la suite du divorce.
Ainsi est-il fait référence « à la détresse des premières épouses » qui ne tiennent « leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d’une famille plutôt que de celui d’une carrière ». Elles ont donc pris « un risque économique individuel » que l’ex-époux est « seul à pouvoir indemniser » Footnote 45 : le fait de prendre en compte, dans l’évaluation de la prestation, les choix professionnels faits par un époux pour favoriser la carrière de l’autre, montre cette place faite aux conséquences économiques des décisions prises pendant la vie commune, dans l’intérêt de la famille, dans une perspective de responsabilité Footnote 46 . Et cette justification de la prestation est dorénavant explicitement rattachée aux inégalités économiques de genre. En effet, au moment du divorce, ces inégalités « placent les femmes dans une situation vulnérable et, en tout état de cause, vont entraîner presque automatiquement une baisse de leur niveau de vie, en raison notamment de leur dépendance économique Footnote 47 . L’époux est, le plus souvent, la « partie économiquement la plus forte » Footnote 48 et l’idée selon laquelle la prestation serait destinée à disparaître avec le développement du travail des femmes serait fallacieuse, parce que la maternité freine leur carrière et qu’elles assument le plus souvent la vie familiale Footnote 49 .
L’analyse chronologique des débats montre donc une évolution du rôle de la notion d’inégalité de genre dans le raisonnement, même si, une fois encore, l’ensemble des critères toujours proposés par la loi ne prend pas partie et laisse le juge choisir ceux qui lui semblent devoir prévaloir. L’association des deux argumentaires dans les discours des parlementaires montre aussi que l’assimilation des conséquences de la rupture entre les époux et les concubins est encore loin : certes, la vie de famille peut construire des inégalités économiques, mais seul le mariage semble, dans ces discours, pouvoir justifier une compensation au moment de la rupture. Il resterait donc à s’interroger sur les conséquences qu’il faudrait tirer du développement et de l’affirmation de familles qui ne sont plus fondées sur le mariage mais qui s’inscrivent dans les mêmes modes de vie.
De même que le discours parlementaire a progressivement intégré la question des investissements différenciés des époux dans l’organisation familiale, la doctrine civiliste, sous couvert d’un discours qui se veut technicien, objectif et neutre, fonde très nettement la prestation sur le seul mariage et les obligations qui en naissent, tout en dressant le portrait des bénéficiaires « idéaux » et des débiteurs « nécessaires » de la prestation compensatoire.
3 Les justifications de la prestation compensatoire dans le discours doctrinal Footnote 50
La prestation compensatoire destinée selon la loi « à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », apparaît dans le discours doctrinal français Footnote 51 comme un dispositif technique (1), irrésistiblement lié au mariage (2), afin d’indemniser les conséquences des choix d’organisation familiale effectués en commun par les époux dans l’intérêt de la famille (3).
3.1 L’approche technicienne des juristes français
Il est important de le relever d’emblée, les discours doctrinaux français sont marqués par leur approche technicienne de la prestation compensatoire. En effet, qu’il s’agisse de discours rédigés par des professeurs d’université ou des praticiens du droit, que ces productions soient à destination d’un public savant, estudiantin ou professionnel, les développements des auteurs s’articulent pour l’essentiel autour des exigences posées par la loi et des directions prises par la jurisprudence, afin de disposer d’une vision complète, ordonnée et synthétique du droit positif. Car c’est bien cela l’objectif premier des discours étudiés, se faire le canal de systématisation de la loi et de la jurisprudence, s’attacher à « faire connaître » Footnote 52 la prestation compensatoire, cette entreprise de connaissance étant le passage préalable à l’énoncé d’éventuelles analyses critiques et/ou de contre-propositions doctrinales. Ces discours « sur le droit » se veulent donc une réplique fidèle du discours « du droit », sorte de tableau clinique de la prestation compensatoire, sans qu’il ne soit besoin d’accompagner cette présentation de réflexions critiques sur les méandres de l’interprétation jurisprudentielle ou de disserter sur les considérations plurielles à même de justifier les choix prétoriens. Il s’agit pour ces auteurs, bercés depuis leurs premières années d’études dans les facultés de droit par une approche dogmatique de la matière juridique Footnote 53 , de faire – pour paraphraser J. Carbonnier – d’un « magma confus une source claire » Footnote 54 , afin de décrire le droit applicable à un moment donné. Ces discours doctrinaux, tout entiers concentrés sur cette opération de mise en ordre des mots du législateur et des attendus des arrêts de principe de la Cour de cassation, prennent donc la forme d’une description neutre et technique du matériau collecté. Et ce constat peut être fait sur toute la période étudiée, qu’il se soit agi de commenter la suppression de la pension alimentaire, de discuter des interprétations jurisprudentielles pourtant parfois bien éloignées de l’esprit de la loi ou encore de présenter les ajustements techniques apportés à la prestation compensatoire après les réformes de 2000 et de 2004.
Depuis 1975 et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs se sont donc avant tout attachés à rendre compte de la mise en œuvre pratique de la prestation compensatoire, et non pas à livrer des propositions théoriques quant à son bien-fondé. Il s’est agi pour eux, grâce à leurs descriptions des règles de droit, d’offrir à leurs lecteurs une sorte de guide de bonne mise en œuvre, et non de discuter des logiques alimentaires, compensatoires, redistributives ou indemnitaires poursuivies tout à la fois par le législateur et la jurisprudence. On doit même relever que les considérations extra-juridiques à l’œuvre dans l’élaboration de ce droit ne sont jamais l’objet de commentaires circonstanciés, le lecteur devant se satisfaire dans le meilleur des cas de quelques lignes logées dans les propos introductifs. Le doyen Carbonnier lui-même, pourtant père fondateur de la prestation compensatoire Footnote 55 et chantre d’une « sociologie du droit sans rigueur », ne fait qu’entrouvrir la porte de la mise à distance critique de la prestation compensatoire dans son classique manuel de Droit civil. En effet, à l’instar de la majorité des productions doctrinales, la question des justifications de cette compensation est essentiellement abordée sur le mode de son efficience juridique, à l’aune de l’ancienne pension alimentaire. De même, lors de révisions de la loi de 1975, les commentateurs ont cédé à ce même réflexe juridico-centré, s’attachant à souligner les améliorations techniques et contentieuses de la loi nouvelle par rapport au droit antérieur. Le changement de paradigme opéré par le législateur, celui du glissement d’une logique de redistribution et punitive, à une logique compensatoire, progressivement déconnectée de toute idée de sanction du bénéficiaire, a donc été analysé uniquement par le prisme juridique, sans que les analyses économiques ou que les métamorphoses de la famille, du couple et de la place de la femme ne soient envisagées au cœur des réflexions des auteurs. Seuls quelques articles font exception, îlots de réflexions pluridisciplinaires dans un océan juridico-juridique, rappelant à quel point il n’est pas commun pour les juristes français de justifier la loi à l’aune de réflexions métajuridiques, le discours juridique français étant toujours marqué, pour paraphraser P. Bourdieu, par une « rhétorique de l’autonomie, de la neutralité et de l’universalité » Footnote 56 .
Cependant, quand bien même la neutralité du discours est de rigueur, l’énoncé de ces critères et la prévalence de certains d’entre eux révèlent nécessairement en creux une certaine vision de la prestation compensatoire. La doctrine civiliste défend de manière implicite une justification de la prestation compensatoire, qui se dessine par touches successives dans l’ombre de l’examen technique de la prestation compensatoire.
3.2 La prestation compensatoire, conséquence pécuniaire de la rupture du mariage
Selon le droit français, la prestation compensatoire ne peut être obtenue qu’en cas de rupture du mariage, et c’est donc très logiquement que les auteurs étudient la prestation compensatoire dans le cadre de l’examen des conséquences pécuniaires du divorce. Cela ne semble a priori pas devoir mériter de commentaires particuliers, tant ce parti pris semble relever de l’évidence, voire de « l’enfoncement de portes ouvertes », pour s’autoriser une expression triviale. En effet, il s’agit pour eux, d’une part, sur le fond, de rappeler le contenu de la loi et d’autre part, sur la forme, de reprendre l’ordonnancement choisi par le législateur, les auteurs articulant leurs propos selon le plan même du Code civil.
Cependant, présenter la prestation compensatoire sous cet angle dévoile l’adhésion nécessaire à l’équation « couple marié = règlement particulier des conséquences de la rupture » et donc a contrario, exit les couples non mariés d’une telle logique et de toute discussion quant au bénéfice d’un dispositif similaire. Ainsi, en dépit de l’inscription des couples français dans d’autres formes de conjugalités, de la consécration du concubinage et du partenariat civil dans le Code civil, des propositions de certains en faveur d’un droit commun du couple, de l’inscription de certains auteurs dans une approche unifiée des relations patrimoniales des couples mariés et non mariés, s’agissant de l’examen de la prestation compensatoire, l’approche doctrinale demeure cloisonnée. La prestation compensatoire est la seule affaire des couples divorcés. Et ce n’est d’ailleurs que récemment que certains auteurs, en particulier dans le cadre de recherches doctorales, ont pris le parti d’aborder de manière transversale la question du règlement pécuniaire des séparations, sans que ces propositions n’aient pour l’instant eu un effet de contagion. Pourtant, dans bien d’autres matières, la doctrine civiliste n’a pas hésité à s’affranchir du Code civil pour proposer des mises en systèmes de la loi et de la jurisprudence sous forme de théories générales Footnote 57 , restructurant alors en profondeur la présentation et l’analyse de ces questions Footnote 58 . Toutefois, alors même que certains concèdent volontiers que les couples mariés comme non mariés découvrent la teneur exacte de leurs droits et obligations patrimoniaux seulement à l’heure de leur désunion; qu’il est admis que certains ex-concubins peuvent se retrouver tout aussi démunis financièrement que certains futurs ex-époux, et absolument dépassés par le règlement a minima de l’après-union libre Footnote 59 , il reste que la prestation compensatoire est abordée dans les manuels dans les chapitres consacrés au divorce, conformément à la lettre du Code civil. La question de l’extension de son bénéfice aux couples non mariés ou celle de son abandon, à l’instar du règlement financier des séparations des couples non mariés n’est pas même abordée. A l’inverse, l’élargissement du bénéfice de la prestation compensatoire à tous les ex-époux, y compris au profit des époux dont les torts exclusifs étaient à l’origine du divorce, a systématiquement été souligné comme bienvenu par les auteurs. La prestation compensatoire trouve donc sa raison d’être dans la rupture du mariage, c’est ce que dit la loi, et il n’est pas question pour la doctrine civiliste française de se défaire de ce postulat légal. La différence de traitement entre les couples mariés et non mariés procède du choix des intéressés. Ce faisant, il s’agit de rappeler la singularité du mariage, avec l’organisation spécifique des droits et des devoirs des époux, les autres formes d’unions - partenariat civil et concubinage - étant à l’inverse originellement marquées par leur caractère libéral et la primauté de l’individu sur le couple Footnote 60 . Cette association concubinage-précarité, mariage-durabilité est même si forte que certains commentateurs ont pu trouver tout à fait justifiée la position de la Cour de cassation selon laquelle « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire », alors même qu’il s’agissait dans cette espèce d’un concubinage de plus de vingt ans.
Dans le même sens, c’est bien l’entrée dans le mariage qui justifie la prestation compensatoire puisque les auteurs expliquent, à la suite de la Cour de cassation, qu’il est impossible d’écarter le droit à la prestation compensatoire en arguant que la différence de revenus préexistait au mariage. L’idée d’accéder à un statut social par le mariage n’a donc pas encore complètement disparu du droit français moderne de la famille. Et c’est encore le mariage, avec le contrôle social qu’il entraîne, qui permet de mieux comprendre la prestation compensatoire. En effet, puisque les règles du mariage s’imposent aux époux sans qu’ils ne puissent composer avec certaines d’entre elles selon leur bon vouloir, il doit en être de même s’agissant de la prestation compensatoire. La doctrine française relaie avec soin la jurisprudence selon laquelle, en l’absence de procédure de divorce, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, et postérieurement au prononcé du divorce, toute demande en ce sens est frappée d’irrecevabilité.
La prestation compensatoire se justifie ainsi implicitement dans les discours étudiés par la singularité reconnue au mariage par rapport à d’autres formes de conjugalités. Mais si cette justification est nécessaire, elle n’en est pas pour autant suffisante. En effet, pour que la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ouvre droit à une compensation financière, encore faut-il qu’elle puisse se justifier par une juste cause.
3.3 La prestation compensatoire, indemnisation implicite du travail domestique des ex-épouses?
Comme on l’a vu, depuis 1975, la prestation compensatoire s’apprécie selon les besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur, en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considération de divers critères (non limitatifs) énoncés dans la loi. La Cour de cassation a par la suite complété ce texte, et ce sont donc les mots du législateur, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, qui permettent à la doctrine civiliste contemporaine de considérer que la situation des époux doit s’apprécier au moment du divorce et non de la séparation de fait, de préciser ce qu’il faut entendre par droit prévisible, d’énoncer les ressources des époux qui doivent être ou non prises en compte dans l’appréciation d’une éventuelle disparité ou encore de savoir si une disparité de revenus préexistante au mariage peut exclure ou non l’octroi d’une telle prestation. Ces certitudes législatives et jurisprudentielles se combinent toutefois avec une zone plutôt trouble pour certains auteurs, celle de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En effet, s’agissant des critères d’appréciation de la disparité, la Cour de cassation n’a jamais voulu s’immiscer plus avant dans le travail des juges du fond considérant que tant le principe d’attribution de la prestation compensatoire que celui de la fixation de son montant, relevaient de l’exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d’appréciation, leurs décisions devant toutefois être suffisamment motivées. La loi a donc laissé aux juges du fond la tâche de fixer souverainement la prestation compensatoire, de faire ainsi du sur-mesure selon les dossiers particuliers qui leur sont soumis, et ainsi de pouvoir privilégier certains critères légaux, voire d’en retenir d’autres. Cependant, le besoin de prévisibilité n’a pas su se satisfaire entièrement de cette marge de liberté laissée aux juges du fond. C’est ainsi que, si certains ouvrages généraux se contentent d’énoncer un à un les critères d’attribution posés dans la loi, sans davantage de commentaires, d’autres auteurs, en revanche, forts de leurs synthèses de la loi et de la jurisprudence, voire de leur connaissance des pratiques contentieuses, s’appliquent à proposer une grille de lecture commune. C’est ainsi qu’à la question de savoir pourquoi le juge attribue ou non une prestation compensatoire, certains auteurs soulignent la nécessité de faire prévaloir tels ou tels critères d’attribution sans pour autant éclairer leur choix par une conception explicite de la notion de compensation.
La disparité des revenus des époux au moment du divorce doit en particulier se justifier par les choix opérés « en commun » par les conjoints. Et pour expliquer cette formule jurisprudentielle – sans qu’il ne s’agisse jamais pour les auteurs de se livrer à une analyse genrée ou économique documentée –, le travail domestique des épouses est alors mis en avant comme un élément décisif. Ce faisant, il s’agit de prendre acte d’une évidence factuelle : dans la majorité des divorces, c’est l’épouse qui se retrouve fragilisée économiquement par la séparation, ses revenus étant faibles, voire nuls, le plus souvent en raison des sacrifices opérés aux bénéfices de sa famille (soit parce qu’elle s’est arrêtée de travailler ou a accepté un travail partiel pour s’occuper des enfants; soit parce qu’elle a collaboré bénévolement à l’activité de son mari). Et les perspectives d’évolution ne sont pas toujours très favorables pour ces femmes : droit à la retraite minorés et employabilité très faible pour les divorcées âgées; employabilité réduite pour les divorcées plus jeunes sans qualification ou se voyant attribuer la résidence habituelle des enfants en bas âge. Le travail domestique des épouses devient dans l’après divorce un argument de poids en faveur de l’octroi d’une prestation compensatoire, comme en témoignent les arguties des études de cas, la place qu’il occupe dans les propositions de barèmes d’évaluation des prestations compensatoires, et son entrée récente à l’article 271 du Code civil. Ce raisonnement fait évidemment écho aux théories compensatoires de la pension alimentaire bien connues outre-Atlantique, mais, en France, en l’absence de tout amarrage aux sciences économiques, le discours doctrinal se teinte d’approximations.
En outre, quand bien même serait apportée la preuve d’un lien de causalité entre le mariage et la perte de capacité de l’épouse de subvenir elle-même à ses besoins, comment évaluer le montant de cette perte économique? En l’absence de tout travail d’homogénéisation ou d’uniformisation au niveau national ou local au sein des juridictions ou des barreaux, les avocats de terrain se sont tous crées, à titre individuel, leur propre grille d’analyse des critères d’attribution, en tenant compte de loi et de la jurisprudence bien sûr, mais également des décisions de leur juge local. Certes, ces lignes directrices « faites maison » ont récemment été complétées par différents barèmes prêts à l’emploi diffusés depuis une dizaine d’années dans des revues juridiques et régulièrement mis à jour. Ces différents outils sont évidemment très pratiques, voire indispensables pour le travail quotidien des praticiens du divorce, puisque cela leur permet de disposer d’une base d’évaluation et d’être ainsi à même de discuter utilement des évaluations faites par l’adversaire ou par le juge. Cependant, il y a autant de méthodes de calcul que de barèmes proposés, les montants proposés allant parfois du simple au triple, ce qui rappelle que ces barèmes sont loin d’être aussi neutres qu’ils le paraissent de prime abord. On le voit, on est très loin de l’élaboration de lignes directrices, et encore moins d’une véritable théorie de la compensation.
Ensuite, s’il s’agit de permettre aux épouses de voir compenser leur perte de capacité à subvenir elle-même à leurs besoins, et les auteurs n’ont jamais exclu la fonction redistributive de cette prestation. En effet, la prestation a également pu s’envisager au profit d’épouses dont le conjoint ne disposait d’aucun capital, mais seulement de revenus supérieurs à ceux de son ex-épouse, les auteurs accueillant plutôt favorablement la position de la Cour de cassation, qui dès 1980 bouscula la volonté du législateur, en posant en principe une présomption d’insuffisance de capital et en refusant de sanctionner les juges du fond qui octroyaient une rente alors qu’un versement en capital était possible. Or cette rente non révisable versée sur un temps long poursuivait bien une toute autre logique que celle envisagée par le législateur, puisqu’il s’agissait d’assurer un minimum de revenu à sa bénéficiaire et donc de venir « combler le vide laissé par la disparition de la pension alimentaire » Footnote 61 . Et si depuis les dernières réformes législatives, la prestation compensatoire sous forme de rente est devenue exceptionnelle sur le terrain contentieux, la logique de solidarité privée n’a pas complètement disparue des discours, certains auteurs relevant encore l’intérêt de la prestation compensatoire pour maintenir le niveau de vie des ex-épouses, ou pour le moins, leur assurer les moyens de subsister.
De plus, derrière la compensation des disparités de revenus causées par les choix de vie faits en commun par le couple, la figure respectable de l’épouse dévouée à sa famille semble parfois davantage se profiler. La recherche d’un statut social par certaines épouses oisives devient dès lors suspecte. Ont bénéficié, par exemple, d’une large diffusion, les arrêts venant refuser une prestation compensatoire à certaine épouses, en insistant surtout sur les choix de vie égoïstes, voire « incompréhensibles » de l’épouse qui par son comportement nie l’intérêt de la famille, en « rejetant son mari et ses enfant pour une vie exclusivement spirituelle sous l’emprise d’un « guide »; en « ne versant aucune contribution pour l’entretien des quatre enfants entièrement assumé par le père, et en ne rendant que de rares visites; et ne justifiant pas d’efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi ». De même, sous prétexte d’une modeste incursion de droit comparé, il s’agit pour certains de constater avec soulagement la porte fermée par le droit français à l’imposture des gold digger américaines Footnote 62 . Ce bref rappel de droit comparé constitue une manière discrète d’avouer l’hostilité à l’endroit des épouses qui ont pu envisager la prestation compensatoire, et donc le mariage, comme une voie d’enrichissement.
Enfin, au-delà de l’analyse de la prestation compensatoire comme une possible compensation des choix de vie faits en commun par les époux, il y a également un élément plus prosaïque à prendre en considération, très éloigné de toute logique compensatoire : les ressources des époux débiteurs. En effet, le juge doit prendre en considération, selon les termes même de la loi, les « ressources du débiteur » et notamment le « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » (art. 271 C. civ.). Or dans bien des cas, les époux n’ont pas constitué de patrimoine immobilier commun, le mari débiteur ne dispose pas de biens propres, et ce sont donc ses seuls revenus de travail qui sont à prendre en considération. C’est ainsi que, même s’il existe une disparité de revenus causée par les conséquences du travail domestique de l’épouse, si les conjoints ou l’époux concernés n’ont pas d’actifs, une fois déduites du revenu de l’époux les charges courantes et l’éventuelle contribution à l’entretien des enfants, il n’y a souvent plus de place pour une prestation compensatoire. Ces considérations très terre à terre, point d’entrée des praticiens dans toute discussion sur le terrain de la prestation compensatoire, sont relayées dans les propositions de barèmes, mais sont généralement absentes des ouvrages généraux qui envisagent la prestation compensatoire sans relever le lien étroit avec la question des ressources disponibles du débiteur, notamment aux termes du partage et de la liquidation du régime matrimonial. La question de la solvabilité du débiteur n’intervient le plus souvent dans les revues spécialisées que sous un angle assez polémique, certains constatant à regret l’atteinte portée à un droit fondamental du débiteur, le droit de propriété, un mari pouvant se voir imposer d’abandonner un bien propre à son ex-épouse, en guise de paiement d’une prestation compensatoire en capital. La question de la solvabilité du débiteur marque les limites de la recherche de justifications théoriques de la prestation compensatoire : dès lors que cette compensation relève d’une solidarité familiale et non pas d’une solidarité élargie (transferts publics, assurances), elle est par hypothèse soumise aux capacités contributives du débiteur.
Conclusion
Le discours juridique français, qu’ils s’agissent des discours parlementaires ou doctrinaux, laisse de plus en plus apparaître la prestation compensatoire comme l’indemnisation de l’investissement des épouses dans les activités domestiques du couple, même si cet argument reste encore noyé au sein d’autres justifications. La diversité des discours traduit l’absence de choix politiques clairs pour fonder cette prestation. Elle reflète aussi les évolutions considérables de l’organisation familiale et des rapports de sexe depuis 1975, évolutions dont le droit n’aurait pas encore pris la mesure. Le développement considérable des familles hors mariage, dont l’organisation matérielle peut être identique à celle des familles en mariage, devient ainsi le moteur d’une évolution dont la ligne de partage ne serait plus l’existence ou pas d’un mariage mais l’organisation domestique, spécialement en présence d’enfants.
Reconnaître cette répartition des rôles sociaux et en déduire la justification d’une prestation compensatoire ne va pourtant pas de soi. En effet, si la revendication de l’égalité peut justifier la mise en place d’une réparation explicite de l’inégalité liée à l’investissement différencié dans la sphère domestique, elle peut également justifier le refus d’une telle prestation, qui serait indigne de l’égalité revendiquée. C’est plutôt sur ce terrain que se sont placées les féministes françaises Footnote 63 , justifiant ainsi le recul de la prestation compensatoire. Le maintien de ce type de prestation et sa possible extension aux couples de concubins relèvent alors d’un choix politique. Il est possible de prévenir la dépendance des femmes mariées en supprimant la prestation qui la compense, incitant ainsi les femmes prévoyantes et averties à conserver leur capacité économique et en faisant peser sur elles les conséquences de ce mode de vie. Il est également possible de prévenir la dépendance des femmes mariées en fondant explicitement la prestation compensatoire sur cette dépendance, incitant ainsi les hommes prévoyants et avertis à préserver la capacité économique de leurs compagnes et en faisant peser sur eux les conséquences de ce mode de vie. Dans tous les cas, dès lors que l’extension des droits patrimoniaux relève d’une solidarité privée, elle est limitée aux forces du débiteur et ne permet pas de compenser l’appauvrissement des plus pauvres, les prestations sociales pouvant alors prendre le relais Footnote 64 . On est ici très loin des circonstances de l’affaire Lola, même si, dans cette affaire, « un recours élitiste à la rhétorique des droits » aurait pu aboutir à une évolution majeure au bénéfice de l’ensemble des conjoints de fait et a suscité des débats propres à faire évoluer le droit Footnote 65 .