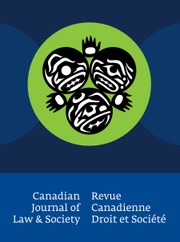Introduction
Nombreuses sont les recherches ayant tenté de problématiser le rapport entre l’opinion publique et le droit criminel. Certaines ont voulu connaître l’opinion publique sur les mesures de prévention du crime Footnote 1 , sur le travail de la police Footnote 2 , sur le processus de libérations conditionnelles Footnote 3 . D’autres se sont intéressées à la perception de l’opinion publique face aux récidivistes, aux délinquants juvéniles ou à différents types de crime dont un individu peut se rendre coupable Footnote 4 . Plusieurs recherches auront aussi problématisé l’opinion publique à l’égard des peines, de leur nature, de leur degré de sévérité ou de leurs fondements Footnote 5 .
Ces recherches se sont généralement appuyées sur un modèle d’analyse privilégiant un même vecteur d’observation : on cherche à connaître l’opinion qu’entretient un public à l’égard de…, à l’égard de l’un ou l’autre des nombreux éléments constitutifs du système de droit criminel (au sens large). Les connaissances accumulées nous permettent ainsi de savoir ce que différents publics pensent de différents aspects du système de droit criminel. Mais que sait-on de ce que le système lui-même « pense » de ce que l’opinion publique « pense » du système? Que sait-on du rôle qu’il lui attribue dans sa prise de décision à l’égard des peines? Que sait-on des structures internes que le système mobilise pour construire les attentes de l’opinion publique de telle façon plus que telle autre?
À la fin des années 1980, Roberts et Doob regrettaient à cet égard qu’il n’y eût encore aucune « systematic empirical research in Canada upon the issue of whether (and to what extent) judges take public views—or their perceptions of public views—into account when sentencing offenders » Footnote 6 . À la fin des années 1990, Tomaino faisait le même constat aux États-Unis : « non-legal factors such as public opinion that impact on the choice of sanction for offenders, have not received the attention enjoyed by other legal factors » Footnote 7 . La récente étude réalisée par Xavier Footnote 8 indique que le problème persiste encore aujourd’hui.
Le présent article propose un modèle d’analyse qui se veut complémentaire par rapport au modèle dominant et susceptible de contribuer au développement de connaissances dans cet univers encore mal exploré des réalités juridiques. Le modèle en question invite le chercheur à déplacer son angle d’observation pour considérer non plus le point de vue d’un public sur le système, mais bien celui du système sur l’opinion publique, sur ses attentes, son rôle et sa fonction dans la prise de décision judiciaire. En ce sens, notre recherche vise moins à connaître l’opinion d’un public à l’égard de… qu’à connaître l’opinion qu’entretient un système à l’égard de ce qu’il considère être les attentes d’un public à l’égard de… Ce modèle d’analyse inverse ainsi la vectorialité de l’observation : non plus de l’opinion publique vers le système, mais bien du système vers l’opinion publique, plus précisément du système vers son opinion publique privilégiée, celle qu’il construit lui-même, par ses propres programmes (au sens luhmannien de « plans » ou de prémisses décisionnelles—nous y revenons en deuxième partie du texte), pour mener à terme ses propres opérations.
Il nous faut sans doute insister davantage sur la portée et les limites de cet article : son objectif n’est pas de diffuser des résultats de recherche. L’objectif visé se situe sur le plan de la problématisation de la polycontexturalité qui caractérise l’opinion publique comme objet de recherche. Par la mobilisation de cette notion—qui sera définie dans la prochaine partie de l’article—nous voulons proposer un modèle d’analyse susceptible de renouveler de façon originale l’étude sociologique et juridique des rapports qui s’établissent entre le judiciaire et l’opinion publique, et de favoriser ainsi le développement de connaissances innovatrices dans ce domaine de recherche.
Notre propos sera développé en deux parties. La première sera consacrée à la notion d’opinion publique comme réalité polycontexturelle. La deuxième portera sur la notion de programme et sur les risques qu’encourent l’autonomie du système judiciaire de même que, plus globalement, l’évolution du droit criminel moderne lorsque le rapprochement entre le judiciaire et l’opinion publique se fait dans les termes d’un programme fondamentalement répressif, favorisant l’affliction et l’exclusion sociale des condamnés.
1 L’opinion publique comme réalité polycontexturelle
La notion de polycontexturalité, qui se veut centrale dans notre conceptualisation de l’opinion publique, est ici empruntée à la théorie des systèmes de Niklas Luhmann Footnote 9 . Il s’agit d’une théorie complexe, hautement abstraite et souvent accusée d’être déployée à travers un vocabulaire inhabituel, voire rébarbatif. Afin d’éviter ces embûches, nous avons choisi d’introduire la notion de polycontexturalité en nous inspirant d’une situation ordinaire de la vie quotidienne. Cette situation est celle d’un entretien télévisé mené par le journaliste québécois Richard Martineau avec le chef des enquêtes à Revenu Québec. L’entretien a été réalisé en 2005 pour le compte de l’émission télévisée « Les Francs Tireurs ». Le journaliste cherchait alors à connaître la position du ministère du Revenu quant à l’applicabilité de la loi du commerce en relation aux biens et services issus du trafic de stupéfiants. À la question de savoir si les trafiquants de drogues sont tenus de prélever les taxes de vente provinciale (TPS et TVQ Footnote 10 ) sur leurs biens et services, l’enquêteur en chef souligne qu’« en fait, toute personne doit percevoir les taxes sur tous les biens et services, incluant les stupéfiants, dans le mesure où ils ne sont pas détaxés par la loi ». Incrédule, le journaliste relance l’enquêteur en chef avec une mise en situation : « un ‘pusher’ pourrait me dire, pour du pot [marijuana], c’est 15 $ plus […] la TPS et la TVQ… il serait requis de faire cela? ». Pour le chef des enquêtes, la loi est claire : « que ce soit 2 $ ou que ce soit 250 000 $, il [le trafiquant] doit remettre l’argent perçu à titre de taxes ». Le journaliste se retrouve alors confronté à la polycontexturalité de la notion trafiquant de drogues : « Donc, aux yeux des policiers, un trafiquant de drogues, c’est un criminel, mais aux yeux du ministère du Revenu, c’est un commerçant ». Réponse de l’enquêteur : « Absolument! ». Une seule et même situation, un seul et même événement, se voit attribuer différentes contextures construites sous l’observation différenciée de différents sous-systèmes observateurs. Pour Luhmann, ceci découle de la différenciation fonctionnelle de la société moderne, de sa « polycentricité ». Il explique :
Modern society is a polycentric, polycontextural system. It applies completely different codes, completely different “frames”, completely different principal distinctions according to whether it describes itself from the standpoint of a religion or the standpoint of science, from the standpoint of law or the standpoint of politics, from the standpoint of pedagogy or the standpoint of economics Footnote 11 .
Dans le cadre de cette polycontexturalité et en fonction des systèmes-observateurs, une même « réalité » peut se voir attribuer différentes contextures, différentes « reality assumptions » Footnote 12 . Le sociologue qui étudie la manière dont ces différents systèmes-observateurs analysent eux-mêmes leurs propres réalités prend épistémologiquement la position d’un observateur de deuxième ordre, c’est-à-dire d’un observateur qui observe comment d’autres systèmes-observateurs observent, comment observent donc des observateurs de premier ordre. De cette position de surplomb, l’observateur de deuxième ordre perçoit les différentes contextures d’un même objet, mais du point de vue de l’observateur de premier ordre, en l’occurrence du point de vue de Revenu Québec, l’objet apparaît doté d’une seule contexture opérationnellement pertinente, soit celle que le système valorise, celle mise en forme à partir de ses propres structures, à partir de ses propres programmes, de façon tout à fait autopoïétique dira Luhmann Footnote 13 . Les autres contextures, celles découlant de distinctions d’observation opérées par d’autres systèmes-observateurs, comme par exemple ici, pour le journaliste, la distinction « criminel/non criminel » du système pénal, sont sans effet et donc d’aucune importance dans les circuits de communication et d’opérations de Revenu Québec. Provenant de l’environnement du système observateur et non de ses éléments internes auto-constitués, ces autres contextures n’irritent Footnote 14 aucune structure interne, ne résonnent avec aucune distinction endogène et ne sont donc investies d’aucune « capacité de connectivité » interne Footnote 15 . D’un point de vue sociologique, on peut ainsi les concevoir comme des différences qui, à l’interne, ne produisent aucune différence opérationnelle. Suivant Bateson, on peut parler de bruit plutôt que d’information Footnote 16 , de quelque chose qui certes peut exister à l’externe, mais qui, de l’interne, apparaît dépourvue de toute signification. C’est ce qu’on pourra retenir des remarques suivantes de l’enquêteur du ministère du Revenu :
C’est vrai qu’on pourrait percevoir cela de différentes façons, mais chez-nous [à Revenu Québec], nous n’avons qu’une seule mission, c’est de percevoir les taxes, car c’est l’ensemble de la population qui est visée par des règles fiscales, et dans ce cadre-là, que tu sois criminel ou non, nous n’y voyons aucune différence.
Ces remarques peuvent a priori surprendre, surtout lorsqu’elles sont analysées dans le cadre d’un modèle qui postule encore une société stratifiée, hiérarchisée, parfaitement intégrée au sein de laquelle différents systèmes sociaux collaboreraient les uns avec les autres dans l’organisation d’un tout cohérent. Pour Luhmann, ce modèle est désuet. Il faut plutôt prendre au sérieux la thèse d’une société fonctionnellement différenciée au sein de laquelle évoluent différents systèmes opérationnellement fermés, voués à leur propre « tout », à leur propre reproduction et à leur propre autonomie par rapport aux exigences et besoins de leur environnement. Ainsi, la thèse de la polycontexturalité est intimement liée à celle de la fermeture opérationnelle des systèmes sociaux. Dans ce modèle d’analyse autopoïétique que nous propose Luhmann, les dernières remarques de l’enquêteur de Revenu Québec ne surprennent aucun observateur, elles illustrent plutôt ce que bien d’autres situations de la vie ordinaire pourraient encore illustrer, soit les différentes contextures que des systèmes fonctionnellement différenciés et opérationnellement fermés peuvent attribuer à un même objet, un même concept, un même « médium ».
Dans ce modèle d’analyse, la notion de hiérarchie comme principe d’organisation de la société est remise en question. En adoptant le point de vue théorique que nous propose le sociologue allemand, nous sommes en effet invités à considérer le fait qu’aucun système n’est à même de contrôler les opérations d’un autre, qu’aucun environnement ne peut opérer à l’intérieur d’un système et qu’aucune hiérarchisation n’autorise un système à revendiquer son autorité épistémique pour affirmer, en l’occurrence, que le trafiquant de drogues est un criminel, qu’il ne peut être qu’un criminel et rien d’autre Footnote 17 . Le trafiquant de drogues est un criminel pour celui ou celle qui observe cette situation à travers les lunettes du pénal et est en même temps un simple commerçant pour celui ou celle qui observe cette même situation à travers les lunettes du système au sein duquel s’inscrit Revenu Québec. Aucune hiérarchie n’est en mesure d’intervenir pour trancher, au sommet d’une autorité épistémique, la question de savoir ce qu’est ou ce que devrait être finalement la vraie nature, la vraie contexture du trafiquant de drogues. Le trafiquant de drogues, comme l’opinion publique et comme bien d’autres objets ou situations de la vie ordinaire, doivent par conséquent être conçus comme des objets polycontexturels.
Appliqué au thème qui nous occupe ici, cela voudra notamment dire que l’« opinion publique » à laquelle font référence les tribunaux, n’est pas une réalité externe qui orienterait de l’extérieur le déroulement des opérations systémiques. Il s’agit plutôt d’une réalité interne, d’une auto-construction opérée par et pour le système, dans le cadre de sa propre fermeture opérationnelle.
En référence à notre exemple, le sens de la fermeture opérationnelle auquel nous renvoyons ici—et duquel découle toute autonomie des systèmes sociaux autopoïétiques—apparaîtra de façon plus claire encore dans la deuxième partie de l’entretien avec l’enquêteur en chef de Revenu Québec. Le journaliste s’étonnera alors d’apprendre qu’en vertu de la loi québécoise, l’information qu’un particulier fournit au ministère du Revenu quant à ses activités professionnelles et commerçantes demeure confidentielle et ne peut donc être communiquée à la police. Richard Martineau, ontologiquement convaincu du caractère en soi criminel des activités en question, cherche désespérément la hiérarchie tout en testant l’étanchéité de la frontière :
J’imagine qu’il y a des limites ici. Si quelqu’un dit […] qu’il a fait 200 000 $ comme tueur à gage l’an passé et qu’il veut payer la TPS et la TVQ… Vous allez [tout simplement] vous asseoir avec lui et calculer?
La réponse de l’enquêteur demeure bien campée dans l’autopoïèse du système fiscal : « Absolument monsieur. C’est ce que nous ferions. En ce qui concerne […] la mission du ministère, l’équité est [ce] qui nous anime, nous, ici » Footnote 18 .
« C’est surréaliste! », s’exclame le journaliste en fin de reportage. Mais pour Luhmann, ce genre de situation ne paraît « surréaliste » que du point de vue de ceux et celles qui opèrent encore « under the illusion of having contact with the environment » Footnote 19 . Et cette illusion, précise Luhmann, sera entretenue « as long as they only observe what they observe and do not observe how they observe » Footnote 20 . Pris dans les mailles d’une épistémologie de la vérité monocontexturelle, un vendeur de stupéfiants, par nature, ne peut être à la fois criminel et commerçant. La double contexture paraît épistémologiquement inconcevable. Dans une épistémologie du « what », l’individu est soit criminel, soit commerçant. Dans une épistémologie du « how », il est criminel pour le système qui l’observe comme criminel et commerçant pour le système qui l’observe comme commerçant.
Si on devait tirer profit de l’épistémologie de la polycontexturalité, la question ne serait alors plus celle de savoir ce qu’est le trafiquant de drogues ni d’ailleurs ce qu’il devrait être, mais plutôt quel système observe et comment (how) il observe, à partir de quelles distinctions ou de quelles différences. Luhmann insiste : « one must always clarify which system is making these differences » Footnote 21 . La question de savoir ce qu’est le trafiquant de drogues ou encore ce qu’est l’opinion publique devient celle de savoir ce que sont ces notions en relation au point de vue qu’adopte un observateur pour les concevoir de telle manière plutôt que telle autre. Cette question met l’observateur d’un système en présence du caractère polycontexturel de la « réalité », du caractère polycontexturel du médium « trafiquant de drogues » ou du médium « opinion publique ». L’observateur accepte finalement qu’il est impossible ou, à tout le moins hautement improbable, que les différents systèmes opérants puissent outrepasser leurs différences (et leurs différends) pour favoriser, en toute collaboration—même dans le cadre d’un agir communicationnel qui se voudrait à la hauteur des expectatives habermassiennes—la création d’un consensus autour de la question de savoir ce qu’est réellement ou ce que devrait normativement être, en vertu de ses propriétés objectives, le trafiquant de drogues, le public ou l’opinion publique.
Quoi qu’en dise notre journaliste, la polycontexturalité des objets qui retiennent l’attention de l’observateur de deuxième ordre n’a dès lors plus rien de « surréaliste », elle apparaît plutôt comme le propre d’une société fonctionnellement différenciée. Au sein d’une telle société, l’opinion publique, comme le trafiquant de drogues, n’est rien d’autre qu’une réalité polycontexturelle, un médium dont différents systèmes sociaux peuvent exploiter différents sens, différentes formes. Ces réalités, comme toute autre réalité, sont toujours, pour le dire comme Luhmann, « a correlate of the system’s own operations, always its own construction » Footnote 22 .
Pour la recherche sur l’opinion publique et l’avancement des connaissances, cette conceptualisation radicalement constructiviste de l’opinion publique impliquera, comme objectifs de recherche, la description, certes, des différentes contextures attribuées à l’opinion publique, mais elle impliquera également la description des différents systèmes-observateurs, de leurs structures internes et des programmes qu’ils mobilisent pour construire et privilégier telles contextures plutôt que telles autres, telles attentes plutôt que telles autres, etc.
Le chercheur, à titre d’observateur de deuxième ordre, se retrouve ainsi face à de nouveaux questionnements et à de nouvelles pistes de recherche. La connaissance ne consistera plus en l’élucidation des propriétés objectives de la réalité « opinion publique », ni d’ailleurs se permettra-t-elle de critiquer les « distorsions » de sens entre cette réalité et la perception du système—« for that would [indeed] presuppose the old cosmos of essences » souligne Luhmann Footnote 23 . Connaître consistera plutôt et plus modestement en la description et en la problématisation des programmes qui, de l’intérieur du système, dans le cadre de sa propre fermeture opérationnelle, thématisent ou « contexturalisent » l’opinion publique et ses attentes de telle manière plutôt que telle autre. La notion de programme fait l’objet de la deuxième partie de ce texte.
2 Programme, rationalité pénale moderne et juridiciarisation de l’opinion publique
2.1 La notion de programme
Chez Luhmann, la notion de programme nous renvoie à des « prescribed ends and constraints (of a factual or normative nature) in the selection of means » Footnote 24 . Seidl s’inscrit dans la même perspective pour concevoir ces programmes—« also called ‘plans’ »—comme des « decision premises that define conditions for correct decision making » Footnote 25 . La pertinence de la notion de programme pour la recherche sur l’opinion publique s’établit sur le principe d’un environnement toujours plus complexe que ce que peut intégrer et gérer le système en termes de possibilités Footnote 26 . De ce principe découle une contrainte, soit celle d’un système devant nécessairement s’auto-constituer par la sélection de certaines possibilités et l’exclusion de certaines autres. En référence à l’opinion publique, à ses attentes et à ses exigences, les possibilités sont multiples pour la justice pénale : certaines opinions appuient la peine de mort, d’autres la dénoncent, certaines sont favorables à la dissuasion, d’autres privilégient la rétribution, d’autres le traitement, certaines le souhaitent en milieu fermé, d’autres en milieu ouvert, etc. L’environnement renferme ainsi d’innombrables possibilités pour le système qui cherche à se rapprocher de l’opinion publique.
Si on tient compte de la totalité des possibilités que comprend l’environnement, on ne peut plus soutenir l’idée d’un système qui s’adapte à l’opinion publique, on doit plutôt rendre compte du processus de sélection et de mise en forme qui permet au système d’exploiter les possibilités de certaines opinions publiques et d’exclure les autres, d’exploiter en d’autres termes certaines contextures et pas d’autres. La question n’est plus celle de savoir ce que sont les attentes de l’opinion publique, mais bien celle de savoir pourquoi ou comment, à travers quels mécanismes, sur la base de quels critères, le système arrive à privilégier certaines contextures et pas d’autres, celles d’une opinion publique plus répressive que clémente, celle des victimes plutôt que celle des experts, celle de certains mouvements sociaux, etc. On le voit concrètement ici, en ce qui concerne l’ensemble des possibilités « possibles », la réduction spécifique de la complexité totale présuppose d’ores et déjà, à l’intérieur du système, une certaine complexité interne, une complexité interne « organisée » Footnote 27 , structurée et structurante qui permet de réduire la complexité externe. Dans ce renversement épistémologique que nous permet d’opérer la théorie des systèmes de Luhmann, c’est cette complexité interne organisée et non plus les attentes réelles et concrètes de l’opinion publique qui suscite l’intérêt du chercheur. En référence aux mises en forme particulières et sélectives de l’opinion publique dans un système comme le système de droit criminel moderne, la question est alors celle de savoir comment un tel système arrive à opérer ses sélections, qu’est-ce qui l’amène à privilégier telle possibilité plutôt que telle autre, à interpréter les attentes de telle manière plutôt que telle autre, à privilégier telle contexture plutôt que telle autre. C’est ici qu’entre en jeu la portée heuristique de la notion de programme.
Au sein des systèmes sociaux, explique Luhmann, les programmes « will divide whatever can be expected as information or remains without an informational value » Footnote 28 . Sous la forme de « si…alors… », les programmes conditionnent sémantiquement les opérations du système, incluant celles qui concernent le rapport du système à son environnement. Ils permettent de déterminer « whether something in the system can be treated as informative or not » Footnote 29 et d’assurer ainsi une certaine cohérence interne au sein du système. Si, comme le soulignait Noreau « tout le travail de définition et d’interprétation du droit est en effet fondé sur cette constante recherche de cohérence interne » Footnote 30 , cette quête, poursuit Noreau, « tient à l’état antérieur du droit, aux contraintes imposées par la forme juridique et à celles que font déjà peser, sur l’univers des possibles, les structures et les pouvoirs déjà consacrés juridiquement » Footnote 31 . Ces contraintes imposées, ces structures déjà consacrées, sont ce qu’incarnent les programmes sous la forme de « si…alors… » : si crime alors peine, si préméditation alors meurtre, si lésion corporelle alors voies de fait graves, si récidive alors prison, etc. Dans les opérations relatives à la détermination de la peine, la cohérence interne du système de droit criminel moderne a historiquement été caractérisée par un penchant répressif quasi identitaire, par une longue tradition d’affliction et d’exclusion sociale, par la survalorisation de la prison, par la marginalisation des alternatives, etc. Derrière cette cohérence interne, derrière ces choix continuellement réitérés, derrière ces préférences inlassablement exprimées et ces possibilités survalorisées, ce qu’on reconnaît n’est ni une nécessité, ni une obligation, mais tout simplement l’effet contingent d’un programme spécifique, celui de la « rationalité pénale moderne » Footnote 32 . Dans un contexte de rapprochement entre le judiciaire et l’opinion publique, lorsque diverses opinions publiques viennent « frapper » à la porte du système, le programme de la rationalité pénale moderne répond et détermine qui entre et qui n’entre pas, à quelles conditions, sous quelles formes et à quelles fins. C’est du moins l’hypothèse que la théorie de la rationalité pénale moderne de Pires nous invite à prendre au sérieux. Nous lui consacrons la prochaine section de nos développements.
2.2 Le programme de la rationalité pénale moderne
Le programme de la rationalité pénale moderne est constitué de l’ensemble des théories de la peine qui ont caractérisé et conditionné l’historicité répressive et « carcéralisante » du droit criminel moderne. Font partie de ces théories la théorie de la rétribution, la théorie de la dissuasion, celle de la dénonciation et celle de la réhabilitation carcérale. Si les différences qui distinguent ces théories les unes des autres ont pu susciter nombre de débats, des points de convergence nous permettent néanmoins de les regrouper sous un seul et même programme punitif.
La cohérence interne de ce programme s’établit autour de la survalorisation de la souffrance ou de l’exclusion sociale du condamné. Toutes ces théories, en dépit de ce qui peut par ailleurs les distinguer les unes des autres, survalorisent comme principe de validation de la peine l’affliction ou l’exclusion sociale. Chez les rétributivistes kantiens, le mal se paie par le mal, par la rétribution d’une affliction. Chez les tenants de la dissuasion, c’est la menace d’une souffrance plus grande que ce que représentent les bénéfices du crime qui freine le passage à l’acte. Pour la dénonciation, le caractère afflictif de la peine doit pouvoir s’élever à la hauteur de l’atteinte portée aux valeurs fondamentales de la société. Pour la réhabilitation, si certaines interprétations ne valorisent pas en soi la souffrance, elles ne problématisent pas celle qu’engendrent les longues périodes de détention destinées à la réhabilitation et au traitement du justiciable.
Sous la forme d’un « si…alors… », ce programme qu’institue conjointement l’ensemble de ces théories agit de façon déterminante sur la sélection et l’éventuelle survalorisation des possibilités répressives, celles qui sont favorables à l’affliction ou à l’exclusion sociale des contrevenants. Son influence dans les opérations relatives à la détermination de la peine a été à maintes reprises démontrée par la recherche empirique Footnote 33 . La question plus spécifique qui se pose pour nous aujourd’hui concerne l’influence de ce programme dans les rapprochements récents que l’on observe entre le judiciaire et l’opinion publique. Le programme cognitif de la rationalité pénale moderne conditionne-t-il en matière de détermination de la peine les formes que prend la juridicisation de l’opinion publique?
2.3 Juridicisation de l’opinion publique
Pour le juriste canadien Jacques Frémont, l’époque où on pouvait encore soutenir que « l’opinion publique [avait] autant à voir avec le processus judiciaire que le poisson avec le vélo » Footnote 34 est révolue. Des transformations récentes au sein du système judiciaire nous obligent aujourd’hui à admettre que « les tribunaux ne sont pas complètement insensibles aux opinions des sociétés au sein desquelles ils évoluent » Footnote 35 . Frémont voit d’ailleurs un lien direct entre cette sensibilité accrue et le « durcissement du droit criminel » Footnote 36 . Dans ce même domaine, Pires ira jusqu’à parler d’une « juridicisation de l’opinion publique et du public par le système pénal » Footnote 37 . Le phénomène est d’autant plus interpellant qu’il s’observe dans un contexte où l’on postule une « crise » de confiance du public dans l’administration de la justice. Comment rétablir cette confiance sans céder à la tentation de déterminer des peines susceptibles de satisfaire ce qu’on croit être les attentes du public en matière de justice pénale? Comment se rapprocher du public, rétablir sa confiance sans laisser le programme répressif de la rationalité pénale moderne déterminer les sélections possibles et les mises en forme admissibles? Comment entrer en relation avec l’environnement sans réduire la « capacité de connectivité » Footnote 38 du système à ce qui conforte les idéaux d’affliction et d’exclusion sociale? Ces questions ne sont ni d’ordre épistémologique, ni d’ordre théorico-hypothétique, elles sont d’ordre bel et bien social et pratique, et concernent concrètement autant l’autonomie du judiciaire que l’évolution du droit criminel moderne.
Avant de considérer les quelques illustrations empiriques nous permettant d’appuyer l’intérêt que représente la polycontexturalisation de l’opinion publique pour le renouvellement de la recherche en matière de sentencing, il importe de préciser, avec quelques considérations méthodologiques, les choix qui ont été opérés pour la constitution des corpus empiriques dont sont issus les énoncés que nous mobiliserons au point 2.5 de cette deuxième partie.
2.4 Considérations méthodologiques
Une partie de notre empirie est constituée d’arrêts tirés de la jurisprudence canadienne, une autre comprend des entretiens qualitatifs réalisés auprès de juges et de procureurs de la Couronne. En ce qui concerne la jurisprudence canadienne, nous n’avons pas procédé à une analyse systématique des arrêts, car le rôle de ce corpus empirique est de venir préciser au besoin certains points soulevés dans les entretiens, de comparer le point de vue des juges et procureurs interviewés sous le couvert de l’anonymat avec le point de vue émanant du discours officiel de la jurisprudence, de les mettre en tension, etc. Ce qui nous intéressait surtout, dans le cadre de cette recherche, c’était d’aller au-delà du discours officiel pour essayer de comprendre les prémisses décisionnelles ou les idées au fondement des décisions rendues dans le cadre d’un arrêt de la cour. L’accès à ces prémisses ou à ces fondements exige très souvent le recours aux entretiens qualitatifs. Entre 2006 et 2016, nous avons ainsi réalisé une cinquantaine d’entretiens qualitatifs semi-directifs d’une durée moyenne de 90 minutes auprès de juges et de procureurs de la Couronne. Ces entretiens ont tous été transcrits et codifiés à partir des catégories d’analyse tirées de la littérature sur l’opinion publique de même que de la théorie de la rationalité pénale moderne de Pires. L’analyse est présentement en cours, mais rappelons que dans ce qui suit, ce n’est pas de l’analyse systématique de ce matériel qu’il s’agira, mais bien de quelques illustrations empiriques permettant plus modestement, en amont, de montrer l’intérêt que représente la polycontexturalisation de l’opinion publique dans les études qui s’intéressent à son influence dans le contexte de la détermination de la peine.
2.5 Fondements empiriques de la polycontexturalisation de l’opinion publique
Dans la dernière section de ce texte, nous allons mobiliser certains éléments tirés de notre corpus empirique afin de montrer, par l’empirie et au-delà de la théorie, l’importance que représente, pour l’avancement des savoirs sur la détermination de la peine, la problématisation des structures internes qui, sous forme de programme, sont susceptibles d’intervenir dans la juridicisation de l’opinion publique. Dans cette optique, considérons d’abord l’effet du programme de la rationalité pénale moderne sur la sélection des contextures privilégiées.
Cet effet s’observe plus clairement lorsque le système entre directement en contact avec des opinions publiques qui ne sont pas favorables à la répression, à l’affliction ou à l’exclusion sociale du condamné. La résistance cognitive du programme est alors plus aigüe. Pour l’illustrer, on peut prendre le cas d’un procureur de la Couronne qui, au cours de l’entrevue, après avoir insisté sur l’importance de se rapprocher du public, surtout des victimes, et de prendre en compte leurs attentes dans la détermination de la peine, a éprouvé certaines difficultés à maintenir son propre point de vue devant les victimes non punitives. Ces difficultés ont émergé alors que ce procureur se remémorait une affaire qu’il considère avoir plus particulièrement marqué sa carrière. L’affaire avait impliqué deux jeunes adultes, deux grands amis d’enfance, ayant un soir pris la voiture après avoir consommé de l’alcool. Un accident est survenu causant la mort du passager. Le conducteur a quant à lui dû faire face à différents chefs d’accusation dont celui de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. Les familles respectives des deux jeunes gens ont accompagné les procédures. Très tôt dans le procès, lorsqu’on a pu saisir le degré de sévérité des peines impliquées, la famille du jeune décédé a demandé au procureur d’arrêter les procédures, d’éviter de faire, à l’issue de cette affaire, ce qu’elle désignait comme « une nouvelle victime ». Évidemment, comme nous sommes dans le domaine du droit public et que le conflit pénal concerne la société prise dans son ensemble et non uniquement les victimes, le procureur a dû décliner. La famille de la victime a alors à tout le moins tenté d’influencer la peine, d’inciter le juge à privilégier la clémence en insistant sur le fait que, pour elle, le deuil familial ne serait qu’alourdi advenant le cas où le meilleur ami de leur enfant, de toute évidence repentant et visiblement très affecté par ce malheur dont il se sait responsable, était condamné à une peine sévère. Nous sommes ici face à une opinion victimaire non répressive, clémente, miséricordieuse, favorable au pardon. Rappelons que nous sommes par ailleurs devant un procureur qui trouvait important de considérer le point de vue des victimes dans la détermination de la peine. Ce qui à cet égard va ressortir des données, notamment du premier extrait cité plus bas, est que les opinions victimaires auxquelles les juges et procureurs se réfèrent lorsqu’ils considèrent important de les prendre en compte sont souvent celles qui sont capables de s’inscrire dans la cohérence interne du programme de la rationalité pénale moderne, donc capables de favoriser des expectatives strictement punitives.
[Procureur # 12] J’avais un dossier de facultés affaiblies causant la mort, un petit gars de 19 ans. La famille de la victime qui venait me dire « je veux que vous retiriez la plainte, parce qu’on a déjà une victime et on n’en veut pas deux ». Les victimes étaient contre nous! [Tout le monde était contre nous] : l’avocat de la défense contre nous, la victime, bien sûr l’accusé… [Tous] contre nous. Même le juge était contre nous… « vous faites un an de prison, that’s it »! C’était ça [la peine]! [ton déconcerté].
Tout se présente alors comme si, au sein du programme répressif de la rationalité pénale moderne, se rapprocher du public et des victimes voulait essentiellement dire se rapprocher du public et des victimes qui appuient le programme et qui lui permettent de se reproduire dans ce qu’il a de plus fondamental : sa répressivité. À l’intérieur de ce programme, une attente de clémence, surtout lorsqu’elle provient des personnes les plus touchées par le crime, devient tout simplement inaudible pour le système, dépourvue de toute capacité de connectivité interne. C’est la situation dans laquelle se retrouve le procureur 12.
Quant au juge qui, dans cette même affaire, semble avoir pour sa part considéré plus positivement la requête de clémence des parents du jeune décédé, il est important de voir que cette réception de l’attente a malgré tout été opérée à l’intérieur du même programme : l’auteur du crime a été puni et l’a été à travers une peine d’exclusion sociale afflictive. La manière dont le procureur mobilise le programme lui permet de discréditer l’attente victimaire, tandis que la manière dont le juge le mobilise entraîne non pas tant l’exclusion de l’attente, mais sa reconversion en attente audible dotée d’une certaine capacité de connectivité minimale à l’intérieur de la cohérence interne du système. Ce qu’il convient de remarquer est que, dans un cas comme dans l’autre, c’est le même programme qui se reproduit, ce sont les mêmes valeurs d’affliction et d’exclusion sociale qui prédominent. Comme le disait pertinemment Luhmann, et on le voit clairement à travers ce cas, si « l’opinion publique [ou ici celle des victimes] suscite l’attention et l’oriente, […] elle ne contrôle pas ce que l’on peut en faire, ni ce que l’on en retire » Footnote 39 . L’opinion publique suscite l’attention; le programme contrôle quant à lui ce que le système peut en faire et en retirer. Le programme de la rationalité pénale moderne, lorsque mobilisé, ne peut que considérer positivement les attentes explicitement répressives (le cas du procureur) ou convertir celles qui ne le sont pas, mais qui, sous son influence, le deviendront (le cas du juge).
Ces opinions publiques non répressives en matière pénale ne sont pas des « anomalies » empiriques, elles ne sont pas aussi rares que les médias et le politique voudraient parfois nous le faire croire. Xavier Footnote 40 montrait récemment que « même si certaines recherches peuvent trouver un public plus punitif, […] il y a une vaste littérature qui va dans le sens contraire » Footnote 41 . Il faut en matière pénale, comme le suggérait ailleurs Luhmann, abandonner « la prémisse d’une unité plus ou moins monolithique de l’opinion publique » Footnote 42 , établir des prémisses innovatrices et des programmes plus complexes capables de reconnaître autre chose que les attentes répressives de ce public que privilégie la rationalité pénale moderne. Se contenter de démontrer la pluralité des opinions publiques et la diversité des attentes ne sera pas suffisant si on garde en place les structures de sélection et d’uniformisation du programme répressif dominant. Ce programme se contentera alors de réduire la complexité de l’environnement pour ne considérer à l’interne qu’une seule et même opinion publique, celle dotée d’une capacité de connectivité interne, c’est-à-dire celle capable de renforcer la forte cohérence interne des théories modernes de la peine en matière d’affliction et d’exclusion sociale.
Le cas précité impliquait une opinion publique concrète, en l’occurrence une famille réelle et directement impliquée dans la procédure, mais le problème peut se présenter de la même manière lorsque des juges ou des procureurs, en l’absence de demandes concrètes et sous l’influence du même programme, se contentent d’évoquer dans l’abstrait, sans support empirique, ce qu’ils croient être les attentes du public en matière de justice pénale. L’effet du programme est alors encore plus pernicieux, car il suffit de déclarer que le public exige des peines sévères et que la légitimité du système dépend de la confiance que ces peines inspirent au sein de ce public pour que cette « réalité » devienne celle du système, celle à partir de laquelle il évolue et ce, indépendamment des nuances ou des indications contraires que pourrait imposer une analyse plus rigoureuse, moins « programmée » de l’environnement. Les deux extraits qui suivent, tirés d’entretiens réalisés auprès des juges, permettent d’illustrer le problème : ces juges présupposent dans l’abstrait une opinion publique répressive et se représentent les peines sévères comme des moyens permettant au système de regagner la confiance du public dans l’administration de la justice.
[JUGE #4] Il faut que la société ait confiance dans le système de la justice et si l’image qui est projetée est celle où le crime est réprimé, le crime est puni, etc., ça donne l’impression qu’on vit dans une société où il y a une dénonciation forte, qu’il y a punition. C’est important que les gens aient confiance dans le système de la justice, qu’ils puissent dire: « Oui, la justice, une sentence sévère a été rendue, c’est donc qu’on promeut certaines valeurs ».
[JUGE #28] Si la société perçoit que les juges, que les tribunaux ne sont pas assez sévères, qu’ils encouragent même la criminalité, ils vont perdre confiance dans cette institution-là. C’est important pour les juges de prendre ça en considération.
Ces énoncés rejoignent ce que Pires avait observé ailleurs, soit le fait que, sous l’influence du programme dominant de la rationalité pénale moderne, « la sévérité de la peine […] joue un rôle central dans la conquête du respect » Footnote 43 . Lorsque le respect souhaité est celui de l’opinion publique, le problème paraît d’autant plus préoccupant que l’opinion publique dont il est ici question est reconnue comme étant chroniquement mal informée en matière de justice pénale, sous-estimant régulièrement la sévérité des peines effectivement ordonnées par les tribunaux Footnote 44 . Comment alors comprendre qu’un système puisse espérer inspirer le respect et la confiance en laissant intervenir dans ses prises de décision un critère aussi douteux que celui se rapportant à ce que « la société perçoit »? Comment regagner ainsi cette confiance sachant que ce que « perçoit » cette société en matière pénale est généralement mal fondé?
Pour contourner ce problème, la grande majorité des juges interviewés vont se rabattre sur une distinction considérée fondamentale pour l’intégrité du système. La seule opinion publique dont on peut légitimement tenir compte dans les prises de décision du système est celle que l’on peut raisonnablement considérer comme bien informée. Mais un problème persiste, car la notion d’« opinion publique bien informée » n’est pas moins polycontexturelle que la notion d’« opinion publique » au sens large. Elle peut elle aussi, comme l’autre, être interprétée et construite de différentes manières et par ailleurs l’être sous l’influence du même programme dominant de la rationalité pénale moderne. Dans ce cas, l’opinion publique bien informée pourra s’avérer, comme ici dans R. c. Deschênes, tout aussi punitive qu’une opinion publique mal informée.
« Le public bien informé souhaite de longues périodes d’incarcération ferme pour ce genre de crime ayant entraîné de si grandes conséquences. Ce public a raison » (R. c. Deschênes, 2012; par. 62) Footnote 45 .
Suivant Luhmann, on est appelé à considérer le fait que la confiance du public dans l’administration de la justice—et il faut en effet insister sur le mot « administration »—ne peut se réduire au degré d’approbation que la décision est susceptible de susciter dans l’environnement du système sans que ne soient en même temps compromises la frontière système/environnement et l’autonomie du système. Dans une société moderne fonctionnellement différenciée, la confiance ou la légitimation du système doit plutôt pouvoir reposer sur le respect des procédures dont la principale fonction est pertinemment celle de mettre les décisions à l’abri des déceptions Footnote 46 . Dans R. c. Curragh Inc., c’est cette dernière interprétation du principe de confiance que défendait la juge en chef de la Cour suprême du Canada lorsqu’elle voulait nous mettre en garde contre les risques associés à certaines formes de rapprochements indues avec l’opinion publique :
Lorsque le ministère public laisse la pression de l’opinion publique influencer ses actions, l’équité et la légitimité essentielles à notre système sont perdues. Et nous nous rabaissons alors au niveau d’une bande de lyncheurs à la recherche d’une branche assez solide Footnote 47 .
Cette mise en garde émise par le plus haut tribunal du pays ne sera toutefois pas suffisante pour éliminer la possibilité que des avis moins tranchés puissent émerger de la jurisprudence canadienne. Les trois prochains extraits, respectivement tirés des arrêts R. c. Gervais, R. c. Beaulieu et R. c. Dedam, montrent en effet que la pression est forte et que la frontière entre le droit et l’opinion publique est parfois plus floue que ce que voudrait le principe de l’indépendance judiciaire :
Loin de moi la pensée que l’indépendance judiciaire puisse être directement ou indirectement à la remorque de l’opinion publique. Mais lorsque le Parlement impose aux juges le devoir de considérer l’intérêt public, c’est à tort, soit dit avec tous les égards possibles, qu’un juge se réfugierait dans une tour d’ivoire Footnote 48 .
It is my belief that the sentence should reflect general public opinion of the abhorrence of this type of conduct and that the sentence should reflect in its totality the seriousness of the matter and the seriousness of the abuse that was inflicted upon young, innocent children Footnote 49 .
I think one must reflect public opinion on these matters and the concern of the public over such acts of violence and, therefore, I have no alternative in handing down sentence but to reflect public opinion and stress general deterrence Footnote 50 .
Que le judiciaire cherche à se rapprocher du public et commence à se soucier de la confiance du public dans l’administration de la justice, c’est une chose, mais qu’il le fasse sous l’influence d’un programme aux prises avec un biais répressif évident, c’en est une autre. Sous l’influence d’un tel programme et si, de fait, comme le suggère Luhmann, un système « does and can only do whatever has connective capability internally » Footnote 51 , nous pouvons nous attendre à ce que seules les attentes répressives, réelles ou construites, puissent influencer les opérations de reproduction interne du système. Tout le reste, exclu ou marginalisé par la sémantique du programme, aura tendance à être considéré comme non pertinent, comme du bruit, comme quelque chose qui dans l’environnement du système, faute de « requisite variety » Footnote 52 à l’interne, ne fait aucune différence pour le système. Les quelques extraits cités dans cette dernière partie de l’article montrent les risques associés à cette tendance émergente, les plus importants concernent la perte d’autonomie du judiciaire et une crispation encore plus aigüe du système autour des valeurs négatives de l’affliction et de l’exclusion sociale. Ce qui s’observe alors n’est pas un rapprochement entre le judiciaire et le public, c’est plutôt le renforcement d’un programme dominant qui au nom des attentes d’un public—qu’il a lui-même construites ou présélectionnées—peut continuer de faire ce qu’il a toujours fait au nom de la dissuasion, de la dénonciation, de la rétribution et de la réhabilitation : punir plus sévèrement, incarcérer plus longtemps, repoussant encore un peu plus le jour d’un rapprochement plus innovateur, favorable à l’émergence d’un nouveau programme et aux contributions que pourrait représenter à cet égard un autre rapport à l’opinion publique, un autre rapport aux victimes et à tout ce qui dans l’environnement du système demeure encore possible.
Ces quelques incursions empiriques sont évidemment trop limitées pour appuyer ou encore invalider les hypothèses soulevées dans le cadre de cet article. Elles nous paraissent par contre suffisantes pour montrer tout l’intérêt que représente la polycontexturalisation de l’opinion publique et l’importance d’étudier, d’analyser et de problématiser non pas l’influence de l’opinion publique dans la détermination de la peine, mais bien l’influence des programmes internes qui, en se référant à l’opinion publique, instituent une nouvelle manière de justifier la même répression que légitimaient déjà les théories modernes de la peine. En ce sens, ces quelques incursions empiriques nous auront permis de poursuivre l’objectif principal de ce texte : montrer l’intérêt que représente une nouvelle conception des rapports qui s’établissent entre l’opinion publique et le judiciaire dans le contexte de la détermination de la peine.
Conclusion
Dans cet article, prenant appui sur la théorie des systèmes et plus spécifiquement sur la notion de polycontexturalité, nous avons voulu introduire une nouvelle manière de concevoir et de problématiser les rapports entre opinion publique et droit criminel. Au lieu de nous inscrire dans la tendance dominante visant à mieux cerner ce que le public pense de l’administration du droit criminel, nous avons proposé un renversement des variables nous permettant de nous interroger sur ce que le droit criminel « pense » que l’opinion publique pense de son administration de la justice. Ce renversement de perspective a comme conséquence un déplacement de l’observation sociologique ou juridique. Il ne s’agit plus en effet d’observer comment l’opinion publique observe le droit, mais de tenter de mieux comprendre comment le droit observe l’opinion publique et quelles attentes il lui attribue à travers ses programmes conditionnels. Nous sommes partis du principe voulant qu’au-delà de l’opinion publique « sondagière » Footnote 53 , chaque système social se référant à la notion polycontexturelle d’opinion publique produit par et pour lui-même, de façon « autopoïétique », ses propres artefacts et le fait au profit de ses propres exigences de cohérence interne.
L’opinion publique n’existe pas en soi, au sens où, en soi, elle n’a pas de forme prédéfinie, ni de substance. En soi, elle se présente plutôt comme une coquille vide qui ne sert qu’à stimuler l’activité cognitive des systèmes parasitaires qui pourront s’y accrocher et la revêtir d’une forme à même de jouer un rôle spécifique dans les opérations internes de ces systèmes. En soi, préalablement à toute mise en forme, l’opinion publique, répressive ou non, ne représente que du bruit dans l’environnement d’un système. Mais lorsque le médium est mis en forme, lorsqu’une contexture lui est conférée, l’opinion publique se met à exister pour le système. Celui-ci peut alors la concevoir comme une source d’information pertinente—et non plus comme du bruit. Le système considère une source d’information comme étant pertinente lorsqu’elle peut faire une différence dans la reproduction des opérations internes du système. Et sous cette forme, à travers cette contexture, l’opinion publique existe et fait une différence.
La notion de programme, empruntée ici à la théorie des systèmes de Niklas Luhmann, nous a permis de mieux comprendre comment le droit criminel, dans la mise en forme du médium « opinion publique », arrive à départager les opinions publiques qui lui paraissent pertinentes de celles qu’il considère devoir être ignorées ou marginalisées. Mobilisant la notion de rationalité pénale moderne pour définir le programme dominant du droit criminel moderne, nous avons pu problématiser les sémantiques susceptibles d’orienter empiriquement la sélection et la mise en forme des opinions publiques pertinentes. En effet, sous l’influence des théories fondatrices du droit criminel moderne, sous l’influence de leur propre hostilité, des traces empiriques font entrevoir les risques que représente pour l’autonomie judiciaire et l’évolution du système la tendance consistant à survaloriser les opinions publiques du programme répressif et à exclure ou marginaliser celles reflétant des contextures plus clémentes, plus favorables au pardon et aux sanctions alternatives non afflictives (réparation, dédommagement, pardon, etc.). Du point de vue de l’évolution identitaire d’un droit pénal foncièrement attaché à l’hostilité de ses modes de résolution de conflit Footnote 54 , la survalorisation de ces opinions publiques risque de contribuer à l’immobilisme du système et à accentuer ainsi le problème de sa « non-évolution » Footnote 55 . Afin d’éviter ce piège, il importe de : (i) rendre plus visibles non pas tant les attentes de l’opinion publique, mais bien les effets du programme dominant de la rationalité pénale moderne dans la sélection et la mise en forme de ces attentes; (ii) mieux informer non pas tant l’opinion publique en matière de justice pénale, mais bien les acteurs quant à l’influence déterminante qu’exerce le programme dominant sur la mise en forme des opinions publiques plus particulièrement répressives; (iii) problématiser, à l’interne, les obstacles cognitifs que ce programme dresse devant la possibilité d’adresser la « crise » de confiance du public dans l’administration de la justice par l’élaboration d’un autre programme capable d’apprentissage et d’autocorrection.
Cet article avait comme objectif principal le développement d’un nouveau créneau de recherche sur le thème de l’opinion publique dans le domaine pénal, mais un tel objectif n’a d’intérêt que si on peut l’inscrire dans la poursuite d’un objectif plus large et encore plus fondamental : rendre plus visible pour les acteurs, comme pour les chercheurs, la possibilité que représente la transformation de ces programmes répressifs à travers lesquels on pense qu’on pense.