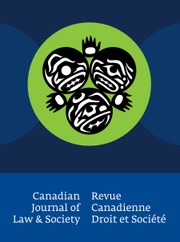Introduction
Les politiques visant l’encadrement de l’exploitation minière artisanale (EMA) ont désormais pris une nouvelle tournure, à savoir sa formalisation en vue de la traçabilité des minerais qui sont produits de façon artisanale. L’État congolais s’est également inscrit dans cette perspective en offrant la possibilité aux exploitants miniers artisanaux (communément appelés creuseurs) de se regrouper en coopératives minières. Il s’agit à la fois de faciliter le contrôle et l’imposition de l’EMA, et de rentabiliser le secteur minier artisanal au profit des creuseurs et de leurs dépendants.
La coopérative minière s’affirme désormais comme un moyen pour l’État de contrôler et d’imposer le secteur minier artisanal Footnote 1 . Il convient de vérifier si cette instrumentalisation de la coopérative minière se fait sans compromettre les valeurs et principes coopératifs classiques qui doivent sous-tendre son régime Footnote 2 . Dans ce sens, avec un regard critique bienveillant, nous essayons d’étudier les représentations que se font au quotidien les exploitants miniers artisanaux à l’égard des différentes mesures qui instituent ce coopératisme.
Le présent article se fonde sur une étude empirique de l’utilisation, voire de l’appropriation du droit coopératif au sein des coopératives minières du Sud-Kivu Footnote 3 . L’analyse de l’effectivité de la norme juridique, qui doit comprendre une véritable évaluation des effets de la norme sur les comportements de ses destinataires, tout comme celle du pluralisme juridique qui tend à s’assurer sur l’état d’un environnement normatif, doit prendre en compte les points de vue de ses usagers Footnote 4 . C’est donc principalement une perspective d’anthropologie du droit que nous avons choisi pour conduire notre analyse.
Les entretiens menés révèlent que les creuseurs et leurs coopératives ne mobilisent pas le droit coopératif dans leurs rapports sociaux, et que ce dernier joue un rôle peu reluisant dans la conduite de leurs activités. En ce sens, ils ont développé d’autres mécanismes un peu plus souples en substitution ou en appui du droit coopératif tel qu’institué par l’État.
Nous avons ainsi répertorié des pratiques utilisées sur le plan normatif et institutionnel aux fins de création et de fonctionnement de « coopératives » qui supplantent souvent le coopératisme imposé par les unités gouvernementales.
Au final, l’article esquisse une analyse des implications de nos constats empiriques sur l’effectivité du droit auprès des acteurs entreprenant des activités économiques de moindre envergure Footnote 5 ou encore sur le pluralisme juridique qui fournit une alternative utile dans l’appréciation du réel impact du droit sur le terrain Footnote 6 . L’article lie ces deux concepts centraux d’effectivité et de pluralisme juridique en envisageant celui-ci comme un « facteur amplificateur » de celle-là Footnote 7 .
La présente étude est structurée autour de quatre postulats. Dans un premier lieu, l’étude tente de faire un constat de l’ineffectivité du droit coopératif ainsi que des éléments de fait qui l’auraient occasionnée (II). Ce bref aperçu de l’ineffectivité est ponctué, dans un deuxième lieu, d’un procès-verbal de l’hybridation normative dans ces coopératives et indique que les coopératives minières évoluent dans un paysage juridique hybride où s’enchevêtrent Footnote 8 un droit coopératif d’essence étatique et des pratiques coopératives locales tant sur le plan normatif que sur le plan institutionnel. Ces pratiques reflètent le coopératisme tel qu’il est vécu par les creuseurs et on peut y voir l’émergence d’un droit vivant, souple, qui se côtoie avec le droit coopératif posé dans les législations minière et coopérative (III). En troisième lieu, nous essayons ainsi de démontrer qu’il règne au sein des coopératives minières une pluralité d’ordres juridiques. L’effectivité et la légitimité dont jouissent ces pratiques locales dans les coopératives minières pourront venir appuyer l’effectivité des règles d’essence étatique (IV).
L’étude propose ainsi en dernier lieu, d’un point de vue pragmatique et sans vouloir ordonner les différents registres normatifs officiels et non officiels, l’aménagement d’un cadre participatif pour l’élaboration et l’application de normes aux coopératives minières. La prochaine réforme serait donc une approche inadéquate si elle se bornait à transposer les concepts du coopératisme dans le secteur minier artisanal sans tenir compte des équivalents fonctionnels dégagés par ces pratiques locales facilement suivies dans les coopératives minières (Conclusion). Mais, en prélude, l’étude rappelle le contexte factuel et juridique qui a vu émerger les coopératives minières (I).
1 Contexture factuelle et juridique de l’émergence des coopératives minières
L’émergence récente des coopératives minières dans le secteur minier artisanal de la RDC est motivée par le souci d’améliorer la gouvernance dans ce secteur.
Dans un premier temps, une vue d’ensemble du contexte factuel indique que le Code minier de 2002 permet à toute personne physique majeure de nationalité congolaise, individuellement ou en groupement avec d’autres, de se livrer à l’exploitation de l’or, du diamant ou de toute autre substance minérale exploitable de façon artisanale dans les Zones déclarées d’Exploitation Artisanale (ZEA) Footnote 9 . Ces ZEA sont des sites non économiquement et techniquement rentables pour une exploitation industrielle ou semi-industrielle. L’artisanat minier se concentre dans les pôles miniers des provinces de l’Est (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema) et du Sud-Est (p. ex. Katanga) de la RDC. Jusqu’au printemps 2015, plus de 3 279 sites miniers artisanaux étaient en activité dans les provinces de l’Est de la RDC. Ces sites produisent principalement de l’or et les minerais dits des 3T (Tin ou étain, Tungstène et Tantale) Footnote 10 . Ainsi, près de 18 % de la population congolaise dépend de cette activité Footnote 11 . Celle-ci mobiliserait plus de deux millions de personnes qui y travaillent Footnote 12 . Cette ruée vers l’EMA se justifie notamment par la rareté des terres arables, l’insécurité ayant causé le déplacement massif des populations hors de leurs villages, le chômage généralisé ainsi que l’enrichissement rapide que procure l’exploitation minière par rapport aux autres activités paysannes Footnote 13 . Toutefois, il s’agit d’une activité menée dans une large mesure dans l’informel et l’illégalité. En réaction à cette informalité, le gouvernement congolais a amorcé, depuis près d’une décennie, un processus de réforme du secteur minier artisanal afin de permettre sa formalisation Footnote 14 . Comme moyen pour y aboutir, il a été décidé notamment de regrouper les creuseurs en coopératives minières Footnote 15 , l’objectif ultime étant de maximiser les recettes de l’État à l’aide d’un processus de traçabilité et d’améliorer le bien-être des creuseurs et de leurs dépendants Footnote 16 .
Dans un second temps, la contexture juridique de ces coopératives s’identifie aux sources suivantes : le Code minier de 2002 qui prévoit la possibilité pour un groupement de creuseurs de se livrer à l’artisanat minier Footnote 17 . L’habit juridique à porter par ce regroupement est déterminé à l’article 234 du Règlement minier de 2003 Footnote 18 . Cette disposition opère par renvoi le choix pour les coopératives. La tendance actuelle est d’ériger ce regroupement en coopératives en une obligation et un préalable à respecter pour exercer l’activité minière artisanale Footnote 19 . Par ailleurs, ce renvoi soumet maladroitement les coopératives minières à la fois au régime des sociétés coopératives prévu dans le Décret du 24 mars 1956 relatif aux coopératives indigènes et à celui de la loi de 2001 sur les ASBL. Nous avons observé qu’en pratique, les coopératives minières se constituent en sociétés suivant les prescrits du Décret du 24 mars 1956. Ce dernier constituait la législation de référence pour les sociétés coopératives œuvrant dans tous les secteurs d’activités à l’exception des coopératives financières Footnote 20 . C’est ce Décret de 1956, structuré autour des principes hérités de la colonisation, qui continuait à régir les coopératives jusqu’à l’entrée en vigueur en droit congolais de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) adopté dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) Footnote 21 . Ce texte moderne a le mérite de se référer aux principes coopératifs et de résoudre les différents problèmes juridiques que posait l’ancien régime, mais paraît complexe et peu adapté au contexte des coopératives minières de la RDC. Cet acte uniforme présente une incertitude quant à son effectivité dans le milieu des coopératives minières et risque de suivre ainsi le sort malheureux des précédentes réformes Footnote 22 . Enfin, il ne prend pas en compte l’état de l’environnement juridique et institutionnel plural dans lequel évoluent les coopératives minières en RDC et ignore les usages développés au sein de ces coopératives Footnote 23 . L’examen de ces usages permet de mettre en évidence l’ineffectivité du droit coopératif au sein des coopératives minières.
2 L’inobservance des principes coopératifs, linéaments d’ineffectivité du droit coopératif ?
Les pratiques observées dénotent une coloration non officielle. Ainsi perçues sous un regard « pathologique », elles révèlent une ineffectivité du droit coopératif au sein des coopératives minières. L’ineffectivité est employée ici dans le sens du défaut d’utilisation des normes par leurs destinataires comme modèle pour orienter leurs usages et pratiques Footnote 24 . Prise dans ce sens, l’effectivité sert, dans le cadre de la présente étude, comme « un instrument conceptuel d’évaluation » Footnote 25 empirique de la façon dont les creuseurs, les coopératives ainsi que les autres acteurs publics et privés impliqués dans la gouvernance minière « agissent et se déterminent » Footnote 26 vis-à-vis des principes coopératifs. Cette étude de l’effectivité ne se limite pas seulement à identifier l’utilisation des principes coopératifs par les acteurs du secteur minier artisanal (1) ; elle intègre en plus un diagnostic des causes de cette situation Footnote 27 (2).
2.1 L’ineffectivité des principes coopératifs
La création et le fonctionnement des coopératives minières devraient se faire en référence aux sept principes qui caractérisent l’identité coopérative. Ces sept principes s’intègrent dans le droit positif congolais par le biais de l’AUSCOOP Footnote 28 . Il s’agit de l’adhésion volontaire et ouverte à tous du pouvoir démocratique exercé par les membres, de la participation économique des membres, de l’autonomie et l’indépendance de la coopérative, de l’éducation, la formation et l’information des membres, de la coopération entre coopératives et de l’engagement envers la communauté Footnote 29 . L’analyse à suivre se focalisera essentiellement sur les traits saillants à retenir de ces principes qui permettent une gouvernance et un fonctionnement particuliers des coopératives. En ce sens, nos constats se limiteront à apprécier l’utilisation, voire la réappropriation, au sein des coopératives minières, des principes constamment mis en avant pour identifier une coopérative, à savoir la gouvernance démocratique et la participation économique des creuseurs.
En premier lieu, la gouvernance démocratique d’une coopérative suppose une participation active des coopérateurs à l’élaboration des politiques et à la prise de décision Footnote 30 . Cette participation active des membres à la gestion de la coopérative se réalise par le biais du droit de vote qui leur est reconnu lors des réunions et assemblées générales (AG) de la coopérative Footnote 31 . Le mode particulier de prise de décision au sein des coopératives, « un coopérateur, une voix, quelle que soit l’importance de sa participation au capital de la coopérative » Footnote 32 constitue la clé de lecture de ce caractère démocratique. Sur le terrain, nous avons remarqué que la grande majorité de coopératives enquêtées ne tiennent pas d’AG. Une coopérative enquêtée ne compte jusqu’ici que sa seule AG constitutive. Elle promettait d’en tenir une deuxième au mois d’août 2015 Footnote 33 . Celles qui font mieux nous disent avoir tenu une AG par an. D’autres encore n’ont jamais tenu d’AG.
Lorsque ces réunions sont tenues, dans l’ensemble, aucun quorum n’est requis Footnote 34 . Par ailleurs, n’y prennent part que certains membres influents de la coopérative. Les creuseurs ordinaires ne sont pas invités aux réunions de la coopérative Footnote 35 . Les responsables des coopératives avancent la fausse raison liée à la difficulté d’identifier tous les creuseurs membres de la coopérative. D’autres responsables accusent l’impossibilité de réunir tous les creuseurs. Ces derniers sont réputés pour leur manque d’éducation et, partant, leur manque d’intérêt à participer à des réunions de la coopérative. Une autre raison est d’ordre économique, car les creuseurs vivent « au taux du jour » et ne sauraient ainsi sacrifier une partie de leur journée de travail à participer à des réunions de la coopérative au lieu de profiter de ce temps pour creuser et espérer trouver quelques produits à revendre à la fin de la journée.
Enfin, les modalités de prise de décision sont loin d’être démocratiques. Les responsables nous disent que les décisions se prennent à l’issue d’un vote de tous les membres Footnote 36 . Par ailleurs, les chefs d’équipe interrogés sur la question donnent un avis contraire et font état d’ordres du jour préalablement fixés par les responsables, sans discussion de leur aménagement, et de décisions communiquées et non discutées entre participants Footnote 37 .
En second lieu, la participation économique des membres suppose que ceux-ci contribuent équitablement et contrôlent démocratiquement le capital de la coopérative Footnote 38 . Cette participation permet d’assurer aux coopérateurs une propriété et une gestion communes de tous les actifs de l’entreprise Footnote 39 . Elle se réalise par les apports des coopérateurs à la constitution du capital social (capital-actions) ainsi que par le contrôle de la situation financière (capital-actif) de la coopérative Footnote 40 .
En guise de participation économique, lors de l’adhésion des creuseurs, la coopérative leur vend des cartes de membres, récolte des apports ainsi que les frais des fiches d’adhésion. Dans la grande majorité des coopératives enquêtées, la fiche d’adhésion coûte 3 $ sauf trois coopératives dont l’une la vend à 10 $, l’autre à 8 $ et une autre encore à 5 $.
Proportionnellement au nombre de creuseurs que compte chaque coopérative, en moyenne 150 creuseurs, voire au-delà Footnote 41 , cette somme à elle seule permettrait à la coopérative de bien réaliser ses activités. En plus, la majorité des coopératives perçoivent 10 % de la production journalière de tout creuseur Footnote 42 . A cela s’ajoutent des cotisations que chaque creuseur verse en argent (2 $/mois) ou en nature (de l’ordre de 2 kg de cassitérite au moins/mois) tantôt sur une base régulière, tantôt en fonction des circonstances liées à la vie de la coopérative Footnote 43 .
Malheureusement, on ne trouve pas de contrepartie financière (dividendes) ou politique (droit de vote) à ces apports, quotes-parts et cotisations ainsi que leurs produits. Les creuseurs se plaignent du manque de transparence dans la gestion de ces fonds. Les questions financières ne sont pas discutées au cours des diverses réunions organisées par les coopératives. Certains responsables allèguent que ces fonds sont affectés pour pourvoir à certains frais administratifs auprès de l’administration minière Footnote 44 . D’autres disent que la quote-part de 10 % perçue sur les productions journalières des creuseurs sert à la rémunération des gérants de la coopérative. Ces coopératives sont ainsi en crise de structure et sont une occasion de spoliation pour leurs fondateurs Footnote 45 .
Deux principales causes sont à mettre au compte de cette ineffectivité des principes coopératifs.
2.2 Causes de l’ineffectivité des principes coopératifs
Nous avons situé ces causes dans les relations de pouvoir qui s’entretiennent au sein et autour de ces coopératives. Ces relations ne sont pas de nature à favoriser le respect des principes coopératifs et entraînent la crise de la structure coopérative. Les autorités coutumières s’emparent de la gestion des coopératives minières (2). Aussi, la double casquette des présidents des coopératives, qui sont en même temps des négociants, les prédispose à la spoliation des creuseurs (1).
2.2.1 La qualité de négociant ou la prédisposition des responsables à la spoliation des creuseurs
Au cours de nos recherches, les creuseurs se plaignaient partout de la diminution du prix des minerais depuis la mise en place de la réforme ayant mené à la création des coopératives minières à partir de 2011. Normalement, la coopérative devrait constituer un cadre d’appui aux creuseurs qui puisse peser sur le prix des minerais et améliorer ainsi leur condition de vie et de travail Footnote 46 . Malheureusement, la fonction de négociant que cumulent les responsables des coopératives les conduit à fixer un prix déjà spoliateur à partir de la coopérative. Seulement trois des neufs présidents des coopératives enquêtées n’exercent pas simultanément la fonction de négociant, c’est-à-dire de commerçant immatriculé et habilité par le Code minier à acheter et revendre les minerais extraits de façon artisanale Footnote 47 . Cette gestion des coopératives par des négociants instaure un monopsone de fait leur donnant la possibilité de négocier un prix très bas avec les creuseurs. Les creuseurs se plaignent alors de la baisse du prix des minerais Footnote 48 . Cette baisse suit la chute du cours mondial des minerais, mais d’une manière anormale. Ce cumul de la fonction de négociant par les responsables des coopératives compte parmi les diverses raisons de cette baisse anormale du prix des minerais Footnote 49 .
Le regroupement des creuseurs en coopératives semble ainsi beaucoup profiter aux responsables des coopératives au détriment des creuseurs.
2.2.2 Immixtion du pouvoir coutumier dans la gestion des coopératives à Walungu
La coopérative minière a servi de structure pour permettre aux autorités coutumières de retracer les revenus des creuseurs et d’y percevoir chacune leur part.
A Walungu les creuseurs doivent payer une redevance coutumière pour avoir accès aux sites miniers. Sur le Site « A » par exemple, au chef de Colline revient 10 % de chaque production et au chef coutumier (Mwami) 20 % de la production à titre de redevance de la chefferie. Sur le Site « D », la redevance coutumière est de 30 % sur chaque production d’or au profit du Mwami. Ces chefs coutumiers s’appuient sur leur mission qui est de veiller à la protection des espaces fonciers qui relèvent des terres des communautés locales Footnote 50 . Il est contestable que cette pratique persiste car la loi sur la décentralisation ne confère au Collège exécutif de chefferie, avec à sa tête le Mwami, aucune compétence fiscale sur le domaine minier, moins encore celle de percevoir des taxes sur les matières premières de production artisanale Footnote 51 . Toute possibilité pour la chefferie de prélever des taxes sur les matières locales imposées par le pouvoir central est d’ailleurs exclue Footnote 52 . La chefferie ne peut percevoir que la taxe sur l’étalage des minerais d’EMA auprès des centres de négoce ou des entités de traitement Footnote 53 . Le domaine minier et les ZEA échappent ainsi aux compétences des chefs coutumiers.
Cette pratique contra legem est confortée par la collaboration passive de l’administration minière avec les autorités coutumières Footnote 54 . Il faut dire que cela permet d’éviter tout risque de concurrence ou de contestation de compétence minière entre ces deux entités qu’on rencontre le plus souvent concernant le domaine foncier Footnote 55 .
La structure coopérative n’aide pas les creuseurs à faire face à cette ingérence. D’ailleurs, on a constaté que, dans les statuts de deux coopératives, les noms des chefs coutumiers étaient repris sur la liste des membres fondateurs ou d’honneur. Ces chefs coutumiers interfèrent même dans la gestion quotidienne de certaines coopératives. En cette qualité, dans une autre coopérative, le Mwami « s’interpose fréquemment pour casser les décisions de l’Assemblée générale » Footnote 56 .
A travers les éléments décrits ci-dessus, la crise de la structure coopérative se révèle notamment par l’étouffement du climat de démocratie, l’anéantissement du bien-être socioéconomique des creuseurs ainsi que d’autres valeurs coopératives comme l’autonomie et l’indépendance de la coopérative par les chefs coutumiers et les fondateurs des creuseurs. De cette façon, dans le contexte de la coopérative minière, la réforme paraît finalement avoir fourni aux élites locales ainsi qu’aux autorités coutumières un instrument de domination et d’exploitation des pauvres creuseurs. Pour autant, loin de cette ineffectivité des valeurs coopératives, on trouve toutefois des pratiques qui peuvent s’analyser comme un droit coopératif vivant.
3 L’émergence d’un environnement normatif et institutionnel hybride
Certaines pratiques souples et originales permettent d’adapter l’identité coopérative au contexte spécifique des coopératives minières. Cela s’observe aussi bien sur le plan normatif que sur le plan institutionnel.
3.1 L’hybridation des normes coopératives
Il convient tout d’abord de constater l’assouplissement de la procédure d’adhésion aux coopératives minières. L’adhésion transite par un chef d’équipe. Dans certaines coopératives, en plus de l’achat de la fiche d’adhésion (3 $), le chef d’équipe souscrit aussi au capital social de la coopérative (apport avoisinant 5 000 $) Footnote 57 . Ces conditions sont onéreuses pour des creuseurs ordinaires en raison de leur incapacité financière de réunir pareil montant. Comme, de par leurs habitudes, les creuseurs travaillent sous la tutelle des chefs d’équipe, c’est chaque chef d’équipe qui achète des cartes de membres pour faire adhérer ses creuseurs à la coopérative de son choix. Ce choix discrétionnaire du chef d’équipe, quoique contraire au principe de l’adhésion volontaire des creuseurs, est également remarquable en ce qu’il facilite l’accès des creuseurs aux coopératives.
De même, nous avons observé une pratique bien originale quant au mode de convocation des AG et d’autres réunions au sein des coopératives minières. Elle s’accommode de l’oralité qui caractérise le milieu des creuseurs. Ces AG et réunions sont généralement convoquées deux ou trois jours avant la date de leur tenue et cela, soit par l’entremise des chefs de collines qui transmettent le message aux autres convoqués soit de bouche à oreille, soit par une invitation au nom de chaque site, soit par des communiqués envoyés dans des églises Footnote 58 . Ne prennent part à ces réunions que les chefs de colline, les chefs de site et les chefs d’équipe. Les creuseurs ordinaires ne prennent pas part à ces réunions pour les raisons exposées plus haut. Une nouvelle fois, c’est par le biais des chefs d’équipe que les décisions sont communiquées aux creuseurs lors de réunions hebdomadaires au sein du cadre restreint des comités des creuseurs Footnote 59 .
3.2 L’hybridation institutionnelle
Sur le plan institutionnel, les creuseurs ont créé des comités de creuseurs composés des chefs d’équipe, des conducteurs des travaux et des creuseurs ordinaires. Il s’agit d’une forme de regroupement informel mais dont la logique de création et de gouvernance puise, dans une large mesure, dans les principes de l’économie sociale et solidaire (ESS) Footnote 60 . Certes, ces structures informelles opèrent dans l’ombre du droit étatique mais, de toute évidence, elles ont été constituées en vue de fournir aux creuseurs un espace de point de vue alternatif à la réforme étatique Footnote 61 prescrivant à tout prix le regroupement en coopératives. Ces comités jouent également un rôle de médiateur pour les litiges interpersonnels entre creuseurs. C’est surtout pour contrarier l’immixtion des chefs coutumiers et la spoliation des coopératives que certains comités ont été créés Footnote 62 . Ainsi, ces comités permettent parfois de s’affranchir du droit étatique et se muent en espaces de résistance aux coopératives et aux autorités coutumières. Ces comités ont fait leurs preuves à Kamituga. Ces comités ont une mission « libératrice » consistant à liguer les creuseurs en vue d’améliorer leurs conditions de travail Footnote 63 et de les libérer ainsi des « hommes de l’oppression des intérêts égoïstes » Footnote 64 que représentent les élites locales et les autorités coutumières. Le comité du Site « C » s’est particulièrement illustré dans la poursuite de cet objectif en s’insurgeant contre la décision de l’administrateur du territoire de Walungu exigeant que chaque site sous sa juridiction lui consacre deux journées d’exploitation.
Le comité présente l’avantage d’être un groupe lié et homogène. Les creuseurs ordinaires sont liés au conducteur des travaux par l’assistance technique qu’il leur apporte au quotidien dans la conduite des travaux : « Le président nous assiste […] dans la conduite des travaux parce qu’il a beaucoup de techniques [de minage] » Footnote 65 . Ces deux catégories d’acteurs sont également liées aux chefs d’équipe par le financement, l’assistance matérielle et la protection qu’ils leur garantissent pendant les périodes de recherche comme pendant les périodes de production. C’est toujours dans le cadre de ces comités que les creuseurs se sentent beaucoup plus soudés, collaborent, s’assistent et partagent le même quotidien. La solidarité et la mutualité entre creuseurs se réalisent ainsi au niveau de ce cadre restreint qu’est le comité.
En quelque sorte, les creuseurs s’approprient (ownership) aisément ces comités car, non seulement ils participent à leur création et tissent des liens étroits avec les membres qui les dirigent, mais surtout ils sont tenus informés hebdomadairement de la gestion des petites contributions que le comité collecte auprès d’eux Footnote 66 . Dans la même perspective, sur tous les sites enquêtés, un seul n’a pas été institué par voie d’élection Footnote 67 . Pour le reste des sites, les creuseurs ont élu par vote les membres dirigeants de leur comité sous l’observation et l’assistance des agents de l’International Tin Research Institute (ITRI) pour le Site « A » Footnote 68 . Ces dirigeants sont élus en raison de leur expérience dans l’EMA mais aussi de leur aptitude à plaider la cause des creuseurs auprès des services étatiques qui interviennent directement sur les sites.
Cependant, ces comités ne sont pas reconnus officiellement. Les coopératives tentent de s’en servir pour légitimer leurs actions. Les creuseurs éprouvent le désir de voir ces comités de creuseurs continuer à fonctionner car, pour certains, « c’est le comité qui dira à la coopérative ce qu’elle doit faire pour nous, une façon de traduire leur attachement au comité qui maîtrise les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien » Footnote 69 . Des observateurs de la société civile voient dans ces comités une opportunité de rendre les coopératives aux creuseurs Footnote 70 .
On peut reconnaître, que faute de moyens suffisants et en l’absence de toute reconnaissance officielle, ces comités se cantonnent le plus souvent dans un syndicalisme au profit des creuseurs Footnote 71 . Les comités ne sont pas non plus prêts à prendre formellement le rôle des coopératives dans la mesure où porter la casquette de coopérative présente le risque d’entacher la confiance dont les creuseurs témoignent envers le comité. A cet égard, « les creuseurs n’aiment pas entendre parler de la coopérative » Footnote 72 ; « le comité travaille bien, la coopérative ne se soucie pas de nous » Footnote 73 . Bien plus, les multiples formalités administratives qui émaillent le processus de création d’une entité juridique (société ou association) ainsi que la corruption qui caractérise l’administration publique en RDC ajoutent à la crainte des comités de se muer en coopératives. En réalité, la tâche serait aussi difficile car, dans certains sites, les présidents des comités sont manipulés par les responsables des coopératives. En ce sens, « le comité ne saurait pas remplacer la coopérative parce qu’il travaille sur la Colline du Mwami » Footnote 74 . Les creuseurs déplorent alors l’absence de toute autonomie du comité qui reste lié à la coopérative car c’est cette dernière qui dispose des collines sur lesquelles miner Footnote 75 .
La prise en compte des perceptions croisées des coopératives à l’égard des comités permet d’entrevoir leur interaction et leur apport dans la restauration des valeurs coopératives à Walungu.
Ainsi, dans certains sites, le comité des creuseurs est perçu comme une unité de résistance aux coopératives et aux unités gouvernementales impliquées dans l’encadrement de l’artisanat minier. Les comités sont alors négligés par ces acteurs Footnote 76 . Dans d’autres coopératives, ces comités servent de mécanisme de relais entre les creuseurs et la coopérative. En ce sens, les cotisations récoltées par certains comités sont utilisées pour acheter des cartes de membres des coopératives : « de l’argent produit par la vente des matières extraites des kifune [portion de main contenant de la poussière à laver pour en extraire l’or], qui avoisine 20 $/jour, nous nous en servons pour acheter au moins 10 cartes chaque mois pour 10 creuseurs » Footnote 77 . D’autres coopératives reconnaissent l’apport important de ces comités dans le déroulement quotidien des activités d’exploitation.
On peut craindre, cependant, une redondance des compétences du comité avec celles de la coopérative. A l’évidence, ces comités de creuseurs font de l’ombre aux coopératives dans beaucoup de sites à l’instar du Site « D » où la coopérative n’est pas effectivement fonctionnelle. Il existe d’ailleurs des précédents entre comité et coopérative, les creuseurs témoignant de la légitimité du comité plus que de celle de la coopérative Footnote 78 .
Des comités, les creuseurs attendent plus un travail de syndicalisme, de lobby, alors que la coopérative, elle, devrait les accompagner dans l’entreprenariat en leur apportant une assistance technique, financière et en termes de formation en vue de leur bien-être. Si la coopérative minière fonctionnait conformément aux principes coopératifs, cela ne produirait pas de conflit de compétences entre elle et les comités. Cependant, ces coopératives ne fonctionnant pas pour le bien-être de tous les creuseurs, mais plutôt pour celui des seuls responsables et autorités coutumières, les comités ont étendu leurs compétences jusqu’à récolter des cotisations régulières, assister les creuseurs en cas d’accidents de travail et pourvoir à leur formation en technique de minage.
De ce fait, ces comités ont pu créer leurs propres normes informelles de fonctionnement. Il a été démontré que pareilles pratiques peuvent « parfois, l’emporte[r] sur le droit étatique et d’autres fois comble[r] la[es] lacune[s] de la réglementation étatique mais opèrent néanmoins de façon autonome » Footnote 79 .
Ainsi, dans leur fonctionnement, ces comités se réunissent une fois par semaine sur les sites. Ils ne disposent pas de bureau mais, dans leur structure, ils sont organisés autour d’un président, deux vice-présidents, un secrétaire et des conseillers Footnote 80 . Tous ces membres sont élus à l’occasion d’une réunion regroupant tous les creuseurs du site. Un comité peut avoir parfois un rayon d’action plus étendu que celui d’une coopérative à l’instar de celui du Site « C » Footnote 81 ou celui du Site « F » Footnote 82 . Par le biais de réunions « inter-collines », ces comités parviennent à rassembler tous les creuseurs pour discuter des grandes questions qui préoccupent la conduite de leurs activités.
Au final, on constate qu’au sein du coopératisme minier à Walungu cohabitent des règles formelles d’émanation étatique qui règlementent le secteur avec d’autres pratiques minières plus souples qui gouvernent les relations des coopérateurs. On ne saurait plus renier ces règles informelles au profit des seules règles écrites. L’approche moderne du mouvement « droit et développement » les conçoit comme des mécanismes de substitution ou alternatives au droit étatique Footnote 83 . Dans le secteur minier artisanal en RD Congo, par la force des choses, ces normes informelles ne sont pas appelées à disparaître. Elles confirment ainsi que le droit n’est pas seulement celui d’essence étatique mais plutôt « ce que les gens considèrent comme du droit » Footnote 84 . De quoi y voir l’hypothèse d’un pluralisme juridique dans les coopératives minières. Le pluralisme juridique revêt ici le sens de l’existence, dans le cadre de l’État congolais, d’entités non étatiques, en particulier à caractère économique, à l’instar des comités des creuseurs et des coopératives Footnote 85 , qui secrètent des règles (issues des usages et pratiques) dont la force obligatoire est comparable/équivalente à celle du droit étatique, que cette équivalence soit reconnue et admise par l’État ou qu’elle soit imposée Footnote 86 . Notre approche consiste à voir en ces usages et pratiques des éléments pouvant contribuer à rendre effectifs les principes coopératifs dans les coopératives minières.
Restera à définir comment ces règles non officielles peuvent coexister avec les règles étatiques en résolvant les problèmes du désordre qu’occasionnerait leur chevauchement, et de la perméabilité du droit étatique à des pratiques d’essence populaire.
4 Vers un pluralisme juridique amplificateur de l’effectivité du droit coopératif ?
Les éléments présentés au point (III) nous servent de clé de lecture du paysage juridique et institutionnel dans lequel évoluent les coopératives minières. Ce paysage oscille entre des règles imposées officiellement et un droit vivant (law in action) secrété par les pratiques des creuseurs, les unités gouvernementales et les différents organes des coopératives. Ces pratiques, au départ spontanées, ont fini par être systématisées, organisées et ont acquis une légitimité dans les milieux des creuseurs.
La force normative de ces pratiques informelles est aujourd’hui reconnue par la Banque Mondiale Footnote 87 . Bien avant, Weber observait déjà qu’il existe beaucoup d’autres formes de coercition effective et d’incitation qui sont exercées par des acteurs non étatiques Footnote 88 . Mieux, du fait du rôle marginal que les règles du droit formel jouent dans les relations d’affaires Footnote 89 , surtout lorsque ces règles du droit formel sont contraires aux normes du monde des affaires en vigueur, elles n’ont souvent peu ou pas d’effet concret Footnote 90 .
C’est pourquoi les institutions informelles sont considérées comme un mode de régulation approprié pour des transactions relativement simples entre un nombre restreint de partenaires Footnote 91 . Les coopératives minières font bien partie de cette catégorie. Le pluralisme constitue l’occasion de reconsidérer ces règles non officielles comme le suggère la majorité de la doctrine Footnote 92 .
Toutes ces règles sont d’émanation non étatique. Elles émergent et persistent en raison de leur capacité d’imposer des sanctions à moindre coût. Ces règles informelles qui s’appliquent au coopératisme minier résultent des relations familiales des « creuseurs », des normes sociales de leurs communautés tribales et ethniques, des règles secrétées par le marché des minerais, des pratiques qui s’érigent dans des sites miniers ou encore des pratiques qui leur ont été imposées par les agents de l’administration minière, des sociétés minières qui cohabitent avec eux dans les mêmes sites, etc. Footnote 93 . Celles-ci sont souvent plus efficaces que celles d’émanation étatique Footnote 94 . Elles résultent des comportements transformés en mécanismes qui s’imposent aux membres de ces collectivités suite à leur adoption, plus ou moins spontanée, par le groupe social tout entier Footnote 95 .
Il faut remarquer d’abord que le droit coopératif destiné aux coopératives minières ignore en grande partie ces pratiques d’essence populaire. En réalité, s’il n’y a point de doute sur la normativité de ces pratiques coopératives, certaines d’entre elles relèvent de ce que le Professeur Jean-Guy Belley qualifie « du social antidroit » Footnote 96 .
Mais il reste qu’en repensant la relation qui doit exister entrer les normes formelles et les règles non étatiques dans les relations d’affaires, la doctrine a envisagé, sous le prisme du pluralisme juridique, la possibilité d’une interaction négociée de ces différents registres normatifs Footnote 97 . On prône ainsi l’internormativité conçue comme « un phénomène de conjonction de deux normativités plutôt que de remplacement de l’une par l’autre ou d’existence simultanée dans des sphères séparées » Footnote 98 . Cette internormativité nous éviterait une superposition des normes non étatiques sur celles émanant de l’État tout comme elle nous éviterait une cohabitation méprisante entre ces normes susceptible d’accroître le danger d’ineffectivité qui guette le droit coopératif au regard de la hiérarchisation à laquelle une pareille cohabitation laisse à penser Footnote 99 .
Au total, il y a lieu de trouver une normativité « dialoguée » entre les normes posées par le droit coopératif et les pratiques et nécessités locales dans les coopératives minières. C’est ainsi que l’on peut atteindre une formalisation adéquate de l’informel dans l’artisanat minier par le regroupement des « creuseurs » au sein des coopératives minières. Il est peut-être temps que la vision du « droit flexible » du doyen Carbonnier transcende nos visions mécaniques des normes Footnote 100 . Pareil droit devrait prendre appui sur ces pratiques locales qui lui permettraient une bonne pénétration auprès de ses destinataires. Mais comment mettre en œuvre cette nouvelle approche normative?
Conclusion : Instrumentalisation du pluralisme juridique au profit de l’effectivité du droit coopératif ?
Nous venons de mettre en lumière des pratiques d’essence locale qui doivent désormais attirer l’attention des décideurs lorsqu’ils veulent adopter des normes devant s’appliquer au niveau local.
Il a été démontré que « la mobilisation des normes dépend de l’engagement de l’individu dans le lien social » Footnote 101 . Ceci revient à dire que la mobilisation des normes est débitrice du processus de son appropriation par l’acteur social Footnote 102 . Ainsi donc, les « creuseurs » adhéreront à des normes soit parce qu’ils les connaissent et qu’ils les acceptent, soit parce qu’ils ont été impliqués en amont du processus de leur adoption. Ce processus se doit d’être ainsi participatif.
1.1 Approche participative dans la production normative sur l’artisanat minier
Il s’agit, par cette approche, d’impliquer les acteurs du secteur concerné afin que la règle à adopter soit comprise et acceptée dans son milieu social d’implémentation. Cette approche est largement suivie et permet d’atteindre une effectivité maximale dans les législations en matière économique où les énoncés des pratiques professionnelles préexistent, subsistent et finissent par être appropriées par l’ordre juridique officiel Footnote 103 . En particulier, on observe une élaboration de plus en plus participative des législations coopératives modernes Footnote 104 . Cela est conforme à la conception globale des coopératives comme des acteurs de développement participatif et local Footnote 105 .
La production participative des normes que nous proposons peut parfaitement s’inscrire dans la vague des changements institutionnels entraînée par le processus de décentralisation en RDC. Ce processus replace désormais les entités locales et leurs habitants au centre des politiques publiques en vue d’une gouvernance locale. Il vise à faire des populations locales des partenaires importants pour le processus de développement de leur contrée Footnote 106 .
Face à l’immensité territoriale de la RD Congo et surtout à l’hétérogénéité de ses populations dans leurs cultures, il serait réaliste de recourir à un mécanisme beaucoup plus participatif et qui présente un niveau élevé de proximité avec les creuseurs pour l’élaboration des règles qui doivent s’appliquer à l’exploitation minière. A titre illustratif, dans le contexte particulier de la RDC, les coopératives fonctionnent dans un environnement hétérogène. Ces coopératives produisent des règles qui dépendent de leurs affiliations régionales et coutumières, et d’autres considérations socioéconomiques. Les pratiques secrétées par les coopératives du Katanga ne sont pas celles des coopératives du Sud-Kivu, du Nord-Kivu ou du Maniema. A un niveau fort inférieur, au Sud-Kivu, les valeurs coopératives sont plus ou moins suivies dans le fonctionnement des coopératives de Misisi Footnote 107 , mieux dans celles de Kalimbi Footnote 108 , moins encore dans celles de Walungu Footnote 109 .
Malheureusement, la législation minière congolaise relève de la compétence exclusive du pouvoir central Footnote 110 . Seuls les droits miniers peuvent être fixés concurremment par une loi nationale et un édit provincial Footnote 111 . Or, l’exploitation minière artisanale n’est pas érigée en un droit minier par notre code Footnote 112 . A vrai dire, plus rien ne justifie que l’exploitation minière artisanale relève de la compétence des pouvoirs centraux. Il s’agit d’une activité conçue en vue de l’accompagnement du processus de développement local. Pour ce faire, les acteurs locaux doivent se sentir concernés par ce processus. Leur implication par le biais d’une gouvernance locale nous paraît appropriée pour sa mise en œuvre. La réforme du Code minier devrait s’inscrire dans la logique de la décentralisation et confier cette activité aux pouvoirs locaux. Ainsi, les organes publics provinciaux seraient dotés de la compétence de créer les ZEA et d’agréer définitivement les coopératives Footnote 113 .
Mais, en dernière analyse, se pose la question de la démarche à entreprendre aux fins d’interpénétration de ces normes informelles avec les normes étatiques. Il sied de recourir à une méthode plus souple fondée sur l’analyse fonctionnelle des résultats des normes informelles qui aiderait à la fois à l’application des normes étatiques et à leur assouplissement par l’adaptation à la conjoncture Footnote 114 .
1.2 Trouver des équivalents fonctionnels dans les pratiques des creuseurs
L’analyse fonctionnelle « permet de déboucher sur une règle d’équivalence qui se veut plus claire pour être plus facilement compréhensible et applicable sur le terrain. Elle vise donc à guider le législateur dans l’élaboration et la formulation de la règle, mais aussi à éclairer les destinataires de la règle dans sa compréhension et dans son application » Footnote 115 . Cette équivalence fonctionnelle constitue un outil juridique capable d’assouplir les mécanismes formels pour que les destinataires se retrouvent dans le résultat de la norme Footnote 116 .
Dans le contexte de Walungu par exemple, par rapport à l’irrespect des formes requises pour la tenue des assemblées générales des coopérateurs, on peut trouver une équivalence fonctionnelle en réintroduisant l’oralité car l’analphabétisme est une donnée globale dans les sites miniers. Aussi, le raccourcissement des délais de convocation aux AG permettrait de tenir compte de la conception polychrone du temps dans cette contrée. Enfin, on pourrait invoquer la présence de tous les membres du comité des creuseurs comme condition à l’atteinte du quorum pour se réunir au sein de la coopérative, ou même leurs votes affirmatifs comme condition à la prise de décisions au sein des coopératives minières afin de renforcer les valeurs démocratiques et une gouvernance participative dans ces coopératives minières de Walungu.
Pareille méthode permettrait d’atteindre une interaction heureuse entre ces normes Footnote 117 . Par le biais de cette interaction, on harmoniserait les règles étatiques avec celles d’essence populaire en rapprochant les unes des autres suivant qu’elles pourraient permettre d’aboutir aux mêmes résultats. Dans l’application du droit coopératif dans les coopératives minières, on pourrait ainsi laisser libre cours aux pratiques associatives des creuseurs à condition que cette application permette d’atteindre le résultat visé au départ par le droit coopératif formel. On considérerait ainsi comme valable le comportement de tout coopérateur fondé sur des pratiques locales, adapté aux besoins des creuseurs mais qui produit les mêmes effets que ceux escomptés par les règles coopératives d’essence étatique, lesquelles auraient du mal à faire la même chose car non internalisées par ces coopérateurs. Nous avons ainsi placé cette étude dans une approche globale de réforme de la politique normative de l’État sur le secteur de l’artisanat minier.