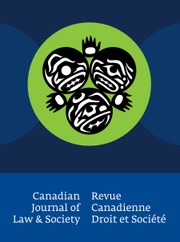Dans le monde occidental, le Québec est la juridiction où les couples non-mariés sont proportionnellement les plus nombreux Footnote 1 et, au Canada, la seule province dont le droit ne reconnaît pas d’obligation économique entre ces conjoints lorsqu’ils se séparent. Depuis 2009 et jusqu’au récent arrêt de la Cour suprême Footnote 2 , l’affaire surnommée “Lola c.Éric” par les médias a mis au débat public cette situation paradoxale. Sociologue de la famille, Hélène Belleau a pris part au volet judiciaire de celle-ci, en tant qu’experte pour ladite Lola auprès du tribunal de première instance. De ce travail de commande, depuis remanié (enrichi d’une perspective juridique et épuré de son volet quantitatif), elle a tiré un ouvrage académique, qui interroge la condition, sociale et juridique, des couples québécois contemporains. Elle y défend la thèse du « mythe du mariage automatique »—expression forgée par des juristes britanniques Footnote 3 pour rendre compte de la croyance, largement répandue selon l’auteure, en l’indifférenciation des droits selon le statut matrimonial. La force argumentative du livre réside dès lors dans l’examen des ressorts de cette croyance—qui articulent droit, politiques publiques et normes sociales—et dans l’établissement empirique de l’ancrage social de ce mythe.
Proposant une synthèse des travaux juridiques et sociologiques sur l’histoire de la conjugalité au Québec, la première partie dresse une fresque historique (complétée, fort à propos, par une chronologie et un lexique en annexes) sur l’encadrement religieux, étatique et professionnel (soulignant en particulier le rôle des notaires) de la vie conjugale depuis les débuts de la Nouvelle France. Son analyse de la période contemporaine est particulièrement éclairante, en ce qu’elle place les transformations du mariage sous le signe d’une privatisation croissante, tant du point de vue de son encadrement légal que des normes sociales qui l’orientent. Cette évolution est à la source du brouillage des frontières entre les différents types de conjugalité—un flou renforcé par l’institutionnalisation partielle de la conjugalité hors mariage. L’expression de « législateur polyglotte » vient judicieusement exprimer la tension entre le droit public (social et fiscal), qui reconnaît maintenant pleinement cette forme d’union, et le droit privé, qui y reste sourd.
La deuxième partie de l’ouvrage s’attache à incarner empiriquement le mythe du mariage automatique à partir d’une enquête par entrevues auprès de couples québécois, mariés ou non. Étayant les conclusions de Diane Vincent Footnote 4 , également experte pour Lola, l’auteure montre que la privatisation du statut matrimonial dans les représentations se manifeste d’abord par les termes d’adresse (chum/blonde, conjoint/conjointe), lesquels ne permettent plus de distinguer les couples selon leur statut. Par ailleurs, il apparaît non seulement que les conjoints interrogés sont le plus souvent ignorants du droit, mais aussi que les motifs d’ordre légal n’entrent généralement pas dans les considérations qui les poussent à se marier ou non, celles-ci étant plutôt d’ordre religieux ou festif ou liées à la tradition. Si ce choix est pour certains époux synonyme d’engagement supplémentaire, les conjoints de fait revendiquent eux aussi l’engagement, dont l’absence d’encadrement institutionnel peut même être proclamée gage d’authenticité. Et qu’ils soient mariés ou non, les couples utilisent tous le « code symbolique de l’amour » (p. 64 et suiv.) pour décrire leur relation : engagement, confiance, fidélité, solidarité conjugale.
On sera gré à l’auteure de questionner la notion de « choix » Footnote 5 , si chère aux partisans du non-encadrement des unions libres. En l’absence d’accord dans le couple, le choix de l’un-e est souvent la résignation de l’autre. Tous les conjoints de fait ne désirent pas se soustraire aux contraintes légales associées au mariage, tandis que ceux qui se marient n’officialisent pas nécessairement leur union pour bénéficier de la protection du droit. Plus fondamentalement, l’ouvrage montre que le droit est un ordre normatif parmi d’autres, qui peine à s’imposer lorsqu’il s’éloigne des normes sociales en vigueur. Il confirme ainsi plusieurs travaux de sociologie du droit, étonnamment non convoqués dans l’ouvrage : en particulier, on ne peut que relever la proximité entre le questionnement de l’auteure et celui des recherches sur la conscience du droit, centrées sur les représentations de la légalité et de la justice chez les « profanes » Footnote 6 .
Le raisonnement à partir des représentations, telles que dévoilées par les discours, paraît cependant quelque peu irénique, dans la mesure où il omet d’articuler celles-ci aux pratiques. Au regard de l’invisibilité sociale de l’inégale répartition des charges domestiques et de ses conséquences sur les carrières féminines, quelle consistance accorder au fait que les couples sont dans leur majorité favorables à un partage égal des biens acquis durant l’union et assurent que les conjoints « bâtissent ensemble le bien commun par un apport variable en argent ou en temps dévolu à la famille » (p. 123) ? À vouloir montrer—à raison—que les motifs légaux ne sont pas les déterminants premiers des formes conjugales, l’auteure nous paraît surestimer la portée effective du « code symbolique de l’amour ». L’ordre affectif de la conjugalité, qui structure, selon l’auteure, le « mythe du mariage automatique », ne serait-il pas aussi à la source du « mythe » de l’égalité entre hommes et femmes, qui empêche les couples de penser la solidarité économique en dépit d’un ordre matériel de la vie commune encore structurellement inégalitaire ?
Par ailleurs, la faible diversification de l’échantillon utilisé, composé de citadins des trois principaux centres urbains du Québec et peu décrit du point de vue socioéconomique, pose une question : jusqu’à quel point les représentations de la conjugalité décrites ne sont-elles pas avant tout celles des couches urbaines salariées issues des classes moyennes ? Si cette limite méthodologique ne remet pas en cause la thèse centrale de l’ouvrage, elle invite à mieux cerner les déterminants socioéconomiques des situations matrimoniales et des usages du droit—en intégrant, si possible, les conjugalités homosexuelles quasiment absentes de l’ouvrage.