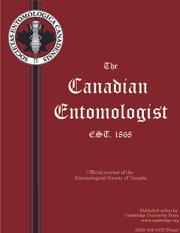Introduction
Macrolophus pygmaeus Rambur (Hemiptera : Miridae) est un hétéroptère omnivore, abondant en zone méditerranéenne dans les cultures maraîchères lorsqu'elles sont peu ou pas traitées par des insecticides (Alomar et al. Reference Alomar, Goula and Albajes2002; Albajes et al. Reference Albajes, Sarasua, Avilla, Arno and Gabarra2003; Castané et al. Reference Castané, Alomar, Goula and Gabarra2004; Gabarra et al. Reference Gabarra, Alomar, Castané, Goula and Albajes2004; Arno et al. Reference Arno, Gabarra, Liu, Simmons and Gerling2010). D'après Arno et al. (Reference Arno, Sorribas, Prat, Matas, Pozo and Rodríguez2009), l'abondance relative de M. pygmaeus représente 74% de l'ensemble des prédateurs que l'on retrouve sur les cultures de tomate sous serres et 59% sur celles de plein champ. Cette abondance varie selon la zone géographique, la saison et le cycle de la culture colonisée. Macrolophus pygmaeus peut se nourrir sur une large gamme d'arthropodes (Albajes et Alomar Reference Albajes and Alomar1999), mais également sur diverses cultures (Perdikis et Lykouressis Reference Perdikis and Lykouressis1999, Reference Perdikis and Lykouressis2000; Lykouressis et al. Reference Lykouressis, Perdikis and Michalaki2001; Perdikis et Lykouressis Reference Perdikis and Lykouressis2004) ou plantes sauvages (Alomar et al. Reference Alomar, Goula and Albajes1994; Perdikis et Lykouressis Reference Perdikis and Lykouressis1997, Reference Perdikis and Lykouressis2004; Tavella et Goula Reference Tavella and Goula2001; Perdikis et al. Reference Perdikis, Margaritopoulos, Stamatis, Mamuris, Lykouressis, Tsitsipis and Pekas2003; Lykouressis et al. Reference Lykouressis, Giatropoulos, Perdikis and Favas2008; Ingegno et al. Reference Ingegno, Pansa and Tavella2011). Plusieurs études se sont intéressées aux avantages et aux limites de la nature d'un régime alimentaire strictement phytophage (Perdikis et Lykouressis Reference Perdikis and Lykouressis1997, Reference Perdikis and Lykouressis2000, Reference Perdikis and Lykouressis2004; Lykouressis et al. Reference Lykouressis, Giatropoulos, Perdikis and Favas2008; Ingegno et al. Reference Ingegno, Pansa and Tavella2011; Portillo et al. Reference Portillo, Alomar and Wackers2012) ou exclusivement zoophage chez les mirides (Iriarte et Castané Reference Iriarte and Castané2001; Castané and Zapata, Reference Castané and Zapata2005; Castané et al. Reference Castané, Arno, Gabarra and Alomar2011). D'autres travaux ont également montré que quel que soit le régime alimentaire, l'eau restait essentielle chez ce type d'insecte (Naranjo et Gibson Reference Naranjo and Gibson1996; Gillespie et McGregor Reference Gillespie and McGregor2000; Sinia et al. Reference Sinia, Roitberg, McGregor and Gillespie2004).
Macrolophus pygmaeus est un zoophytophage qui occupe une place prépondérante dans l'agrosystème tomate car il est largement utilisé comme agent de lutte contre les ravageurs. Il apparaît donc important de caractériser ses besoins nutritionnels ainsi que l'effet de différents régimes trophiques sur sa biologie, car les relations trophiques sont des éléments fondamentaux structurant l’écosystème. Dans ce travail, nous avons fait le choix d’étudier l'influence de différentes sources trophiques, proposées seules ou en association, sur la longévité et la capacité de survie de M. pygmaeus. Ces différentes sources trophiques sont de l'eau libre, une plante et des proies.
Matériel et méthodes
Des plants de tabac (Nicotiana tabacum Linnaeus; Solanaceae), provenant de graines germées et cultivées dans la serre du Centre de Biologie pour la Gestion des Population (CBGP), Montpellier, France, ont été utilisés.
Macrolophus pygmaeus
Les expérimentations ont été réalisées à partir d'adultes néo-émergents. Les individus ont été obtenus à partir de jeunes larves du cinquième stade (L5) directement prélevées de l’élevage de masse du CBGP. Cet élevage a été conduit sur des plants entiers de tabac placés dans des cages en plexiglass (50 × 50 × 50 cm) aérées par le haut et comportant deux ouvertures latérales fermées par des manchons de voilage. L’élevage a été maintenu en conditions contrôlées (température 25 ± 2 °C, humidité relative 60 ± 10%, et photophase de 14 heures). Cinq à six jours avant le début des expériences, les L5 ont été placées individuellement dans des boites de Pétri (Ø : 55 mm; h : 13 mm) contenant un disque de coton imbibé d'eau, sur lequel était disposé un disque de feuille de tabac et une pincée d’œufs d’Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae).
Sources trophiques
Sept modalités (M1 à M7) contenant une ou plusieurs sources trophiques ont été testées : aucune source trophique (M1); œufs d’E. kuehniella uniquement (M2); eau uniquement (abreuvoir) (M3); plante uniquement (disque de feuille placé sur un gel d'agar pour limiter la dessiccation) (M4); eau et œufs d’E. kuehniella (M5); œufs d’E. kuehniella et plante (M6); œufs d’E. kuehniella, plante et eau (M7).
Une fois émergés, les adultes ont été sexés, codés et mis à jeûner pour standardiser leur état de faim dans une boite de Pétri (Ø : 55 mm; h : 13 mm) dont le couvercle ajouré permet d’éviter la condensation. Seule de l'eau, apportée par des abreuvoirs, était disponible. Après 24 heures, les mâles et les femelles ont été transférés individuellement dans de nouvelles des boites de Pétri correspondant à l'une des sept modalités. Les boites ont été placées dans une chambre climatique dans laquelle les conditions étaient contrôlées et maintenues constantes (température de 25 ± 2 °C, humidité relative de 60 ± 10% et photophase de 14 heures).
Les morts ont été recensés chaque jour jusqu’à la mort de tous les adultes. Afin d’éviter tout biais dû à une dégradation des conditions expérimentales initiales, les ressources testées ont été renouvelées deux fois par semaine. Vingt mâles et vingt femelles ont été testés par modalité.
Analyses statistiques
Les longévités ont été comparées avec une ANOVA unifactorielle et les moyennes ont été comparées avec un test de comparaisons multiples de Tukey (α = 0,05). Les données de survies ont été analysées par la méthode de Limite-Produit de Kaplan-Meier. Les courbes ont été comparées avec un test de Wilcoxon généralisé de Gehan (α = 0,05).
Résultats
Longévité
Aucune différence significative n'a été observée (P > 0.05) entre la longévité des mâles et celle des femelles à l'intérieur de chaque modalité à l'exception de M3 (P = 0.009), modalité pour laquelle les femelles vivaient en moyenne trois jours de plus que les mâles (Tableau 1). Indépendamment du sexe, les longévités peuvent être regroupées dans trois catégories statistiquement différentes (P > 0.05) : 1) longévité courte, deux jours environ, correspondant aux modalités sans eau (M1 : rien et M2 : œuf ); 2) longévité moyenne, de 8–14 de jours, correspondant aux modalités avec uniquement de l'eau, libre ou apportée par la plante (M3 : eau et M4 : tabac), et 3) longévité longue, de 44 à 73 jours, correspondant aux modalités avec eau (libre ou apportée par la plante) et œuf (M5, M6 et M7). Ces résultats montrent un effet très positif de l'eau sur l'allongement de la vie des individus qui s'est trouvée multipliée par un facteur huit entre M1-M2 et M3-M4. Cet effet était amplifié lorsqu'une alimentation animale (œufs) était rajoutée. En revanche, les nutriments apportés via la plante n'ont pas eu d'effet significatif sur la longévité puisque aucune différence n'a été observée entre la durée de vie des adultes en présence d'eau libre et celle de ceux élevés sur disque de feuille.
Tableau 1 Longévité en jours (± IC) des Macrolophus pygmaeus mâles et femelles en fonction de la modalité. M1: aucune source trophique; M2: uniquement des œufs d’Ephestia kuehniella; M3: uniquement de l'eau; M4: uniquement la plante de tabac; M5: eau et œufs d’E. kuehniella; M6: œufs d’E. kuehniella et plant de tabac; M7: œufs d’E. kuehniella, plant de tabac et eau. À l'intérieur de chaque colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (ANOVA et Test de Tukey, α = 0,05).

Survie
Comme pour la longévité, le régime trophique sous certaines conditions, a fortement influencé la survie des adultes. Sans aucune ressource (ni eau, ni œuf, ni plante : M1), on a constaté la mort de 64% des mâles après seulement 48 heures. Au 3ème jour d'un tel régime, aucun survivant n'a été retrouvé. Les femelles vivaient sensiblement plus longtemps car 20% étaient encore vivantes après 72 heures. En revanche, aucune femelle n'a survécu au 4ème jour. Les analyses statistiques (Kaplan-Meier et test de Wilcoxon, Tableau 2 et Figs. 1–2) ont montré que l'on ne peut pas classer la survie dans les trois catégories qui ont été définies pour la longévité. Quel que soit le sexe (mâle ou femelle), les courbes de survie étaient les mêmes pour les modalités sans eau (M1 et M2), mais la courbe avec eau seule (M3) était différente de celle avec plante (M4). Enfin en ce qui concerne les trois dernières modalités (M5, M6 et M7), si pour les femelles il n'y avait pas de différence, on a observé pour les mâles que la courbe de survie de la modalité œuf + eau (M5) était différente des modalités œuf + plante (M6) et œuf + eau + plante (M7). En revanche, il n'y avait pas de différence significative entre la modalité œuf + eau + plante (M7) et la modalité œuf + plante (M6) (Tableau 2). Il est difficile d'interpréter biologiquement cette différence constatée car rien ne contre-indique que l'on ne doive pas retrouver ici aussi les mêmes tendances que celles caractérisées pour les femelles. Si nous considérons que pour le traitement M5 la mortalité observée, anormalement élevée, était la résultante d'un artéfact expérimental, les courbes de survies des mâles et des femelles pourraient être classées dans 4 catégories : 1) survie sans eau, 2) survie avec de l'eau libre, 3) survie avec la plante seule et 4) survie avec de l'eau (libre ou/et plante) et des œufs.
Tableau 2 Comparaison deux à deux des courbes de survie des mâles et femelles de Macrolophus pygmaeus soumis à différentes sources trophiques (modalités M1 à M7) (Test de Wilcoxon généralisé de Gehan, α = 0,05). M1: aucune source trophique; M2: uniquement des œufs d’Ephestia kuehniella; M3: uniquement de l'eau; M4: plant de tabac uniquement; M5: eau et œufs d’E. kuehniella; M6: œufs d’E. kuehniella et plant de tabac; M7: œufs d’E. kuehniella, plant de tabac et eau.


Figure 1 Courbes de survie de Macrolophus pygmaeus (mâles et femelles) soumis à sept régimes trophiques différents (modalités M1–M7). M1 (![]() ) : aucune source trophique; M2 (
) : aucune source trophique; M2 (![]() ) : uniquement des œufs d’Ephestia kuehniella; M3 (
) : uniquement des œufs d’Ephestia kuehniella; M3 (![]() ) : uniquement de l'eau; M4 (
) : uniquement de l'eau; M4 (![]() ) : uniquement de la plante de tabac; M5 (
) : uniquement de la plante de tabac; M5 (![]() ) : eau et œufs d’E. kuehniella; M6 (
) : eau et œufs d’E. kuehniella; M6 (![]() ) : œufs d’E. kuehniella et plant de tabac; M7 (
) : œufs d’E. kuehniella et plant de tabac; M7 (![]() ) : œufs d’E. kuehniella, plant de tabac et eau.
) : œufs d’E. kuehniella, plant de tabac et eau.
L’étude de la longévité n'avait pas permis de mettre en évidence une influence de la plante différente de celle de l'eau libre. Ce n'est plus le cas ici où l'on a clairement constaté que la survie journalière en présence de plante est significativement supérieure à celle obtenue avec de l'eau libre uniquement. Par contre, comme pour la longévité, on a constaté un effet positif de la présence simultanée de l'eau et des œufs. Soit cet effet a masqué l'effet plante observé en absence d’œufs, soit cet effet l'a annulé puisque les courbes correspondantes à M5 et M6 et M7 n’étaientpas statistiquement différentes.
Nos résultats ont également montré qu'il existe une grande différence entre les modalités pour lesquelles une seule source trophique était proposée comparativement à celles pour lesquelles plusieurs sources étaient présentes. En effet, l’écart entre ces deux groupes, celui des sources monotrophiques (M1, M2, M3 et M4) et celui des sources multitrophiques (M5, M6 et M) était, en valeur absolue, très élevé aussi bien pour la longévité que pour la survie. La présence simultanée de plusieurs sources trophiques a donc considérablement augmenté la longévité et la survie.
Discussion
La disponibilité des ressources influence l'organisation et la structure d'un grand nombre de communautés animales (Schoener Reference Schoener1989; Pimm et al. Reference Pimm, Lawton and Cohen1991; Reice Reference Reice1994; Paradise Reference Paradise1998). Plusieurs études ont montré que pour les insectes zoophytophages, l'alimentation à base de plante représentait un moyen d'acquérir la plus grande partie de l'eau nécessaire à leur survie et au maintien de leurs fonctions vitales; elles ont également confirmé le rôle primordial joué par l'eau dans la consommation de leurs proies (Cohen et Delbot Reference Cohen and Debolt1983; Gillespie et McGregor Reference Gillespie and McGregor2000; Sinia et al. Reference Sinia, Roitberg, McGregor and Gillespie2004; Hamdi et al. Reference Hamdi, Chadoeuf, Chermiti and Bonato2013). Dans notre étude, aucune différence entre l'effet de l'eau libre ou de l'eau apportée via la plante sur la longévité des adultes (mâles ou femelles) n'a pu être mise en évidence contrairement à Lucas et Alomar (Reference Lucas and Alomar2001) qui notent un effet plante positivement significatif pour Dicyphus tamaninii Wagner (Heteroptera : Miridae), un autre miride partageant les mêmes écosystèmes que M. pygmaeus, ou Margaritopoulos et al. (Reference Margaritopoulos, Tsitsipis and Perdikis2003) pour lesquels la longévité des mâles de M. pygmaeus et de Macrolophus costalis Fieber est supérieure à celle des femelles. En revanche, les adultes que nous avons suivis sur la plante ont une survie significativement plus importante que ceux n'ayant reçus que de l'eau libre. On peut raisonnablement supposer que la plante ne soit pas uniquement une source d'eau mais également une source de nutriments, notamment de carbohydrates essentiels (Gillespie et McGregor Reference Gillespie and McGregor2000). En effet, certains hétéroptères élevés exclusivement sur des plantes présentent un développement plus rapide et une survie plus longue que ceux ne recevant que de l'eau (Naranjo et Gibson Reference Naranjo and Gibson1996; Gillespie et McGregor Reference Gillespie and McGregor2000). Avec un régime trophique phytophage strict de plantes sauvages ou cultivées, M. pygmaeus peut se maintenir en vie et mener à terme son développement (Lykouressis et al. Reference Lykouressis, Perdikis and Michalaki2001; Margaritopoulos et al. Reference Margaritopoulos, Tsitsipis and Perdikis2003; Perdikis et Lykouressis Reference Perdikis and Lykouressis2004), bien que ce type d'alimentation rallonge la durée du développement préimaginal et affecte le taux d’émergence et la taille des adultes (Ingegno et al. Reference Ingegno, Pansa and Tavella2011). Chez les hétéroptères omnivores, le végétal diminue la prédation intraguilde comme l'ont montré Lucas et al. (Reference Lucas, Fréchette and Alomar2009) pour les deux mirides D. tamaninii et Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera : Miridae), mais la présence de la plante seule n'est pas suffisante pour éviter le comportement cannibale de M. pymaeus (Hamdi et al. Reference Hamdi, Chadoeuf, Chermiti and Bonato2013). Inversement, un régime exclusivement à base de proies, mais sans eau, ne suffit pas pour assurer la survie de M. pygmaeus, car l'eau est nécessaire à la digestion extra-orale des proies (Cohen et Delbot Reference Cohen and Debolt1983; Gillespie et McGregor Reference Gillespie and McGregor2000; Sinia et al. Reference Sinia, Roitberg, McGregor and Gillespie2004). Comme le montre la différence que nous avons obtenu entre les deux groupes « sources monotrophiques » et « sources multitrophiques », la consommation de proies et l'ingestion d'eau sont liées et M. pygmaeus doit trouver le bon équilibre entre ces deux ressources pour se maintenir en vie, se reproduire et faire face aux aléas environnementaux (compétition, manque de ressources, températures basses ou élevées, sécheresse, etc.). Le régime zoophytophage de M. pygmaeus est une forme d'adaptation essentielle à son maintien.
Remerciements
Cette étude a été rendue possible grâce au support financier du département Soutien Formation de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).