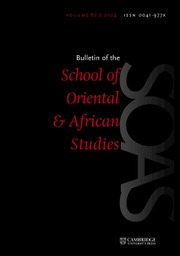1. IntroductionFootnote 1
Sous la perspective de la linguistique historique, les termes de couleurs sont objet de discussion premièrement pour leurs étymologies. Mais bien évidemment, cela n'est pas leur seul intérêt, car les noms de couleurs sont souvent des noms de substances colorantes spécifiques, lesquelles sont, elles-mêmes, fréquemment des marchandises coûteuses. L’étude de leur histoire peut donc relever des données intéressantes sur le contact des langues. Ainsi, je propose d'appliquer ici la méthode de l’« étymologie – histoire des mots »Footnote 2 et de combiner les données fournies par la linguistique historique avec d'autres données.
Au centre de cette étude sera un groupe de mots désignant la couleur rouge. Il s'agit du mot arménien « karmir », du mot sogdien « karmīr » et de l'hébreu « karmīl ».
2. Le moyen perse et le grec
2.1. Le moyen perse « karmīr »
Avant d’étudier les mots mentionnés, il faut discuter quelques autres mots pour lesquels on a proposé qu'ils y soient liés. À la première place figure un mot moyen perse karmīr « rouge » que l'on trouve par exemple comme « karmīr <klmyr> » dans le dictionnaire de MacKenzie (Reference MacKenzie1986 : 50).Footnote 3 Le moyen perse étant une source bien possible pour fournir des mots à l'arménien, au sogdien, etc., on a proposé que ces langues auraient emprunté le mot au moyen perse.Footnote 4
En cherchant des attestations de ce mot moyen perse, cependant, on n'en trouve pas ni dans les textes manichéens, ni dans les inscriptions. Dans la littérature zoroastrienne, je n'ai trouvé qu'un seul texte où ce mot figure.Footnote 5 Ce texte est le Zand ī Wahman Yasn, un texte apocalyptique sur lequel l’éditeur Cereti (Reference Cereti1995 : 13 f.) dit : “the greatest part of this text should be ascribed to the late Sasanian or early Islamic period. Even more important, the redaction of the text as we know it, as well as the elaboration of apocalyptic speculation as found in the Pahlavi texts, does not seem to be pre-Sasanian”. À deux reprises, le texte dépeint comment, à la fin des temps, des peuples étrangers règneront sur l'Iran, mentionnant parmi ceux-ci les karmīr(-hyōn) et les turcs :
• Zand ī Wahman Yasn, chap. 4, 48 :Footnote 6
⁂ cygwn hywn twlk W htwl W twpyt ′ cygwn +hndwk W kwpyʾl W cynʾyh W kʾpwlyh W swptyk W hlwmʾyk W +klmyl hywn W spyt hywn
‣ čiyōn Hyōn, Turk u Xadur u Tōbīd, čiyōn Hindūg u Kōfyār u Čīnī u Kābūlī u Subdī u Hrōmāyī u Karmīr Hyōn u Spēd Hyōn
“(foreign forces) such as the Hyōn, the Turk, the Xadur, the Tōbīd, such as the Hindūg, the Kōfyār, the Čīnīg, the Kābūlīg, the Subdīg, the Hrōmāyīg, the Karmīr Hyōn and the Spēd Hyōn”
• Zand ī Wahman Yasn, chap. 6, 6 :
⁂ dwšmyn twlk W klmyl
‣ dušmen Turk u Karmīr
“the Turk and Karmīr enemies”
Ces passages, discutés par Bailey (Reference Bailey1932 et 1954 : 13 ff.), seraient donc l'origine du mot karmīr chez MacKenzie (Reference MacKenzie1986) et ailleurs.
La version pâzand de ce même texte semble être encore la seule place où figure le mot karmīr dans sa forme pâzand : « xarmə̄ra hayūn u spit̰ hayūn » pour le premier passage ci-dessus et « turk u xarmə̄r hayūn » pour le deuxième.Footnote 7
Par conséquent, dans la mesure où un mot moyen perse karmīr existe, celui-ci semble désigner un peuple étranger. Vu l'absence d'autres attestations de karmīr, il semble donc qu'il s'agit ici d'un ethnonyme d'origine étrangère. Bien qu'il soit possible que l'auteur du Zand ī Wahman Yasn ait compris que karmīr, figurant à côté de spēd « blanc », désigne une couleur, il n'y a pas de raison plausible pour proposer un lexème karmīr « rouge » pour le moyen perse.Footnote 8
2.2. Le grec « ϰεϱμι(ϱ)- »Footnote 9
On a aussi proposé qu'il existe un mot grec « ϰεϱμι(ϱ) » qui serait emprunté à l'iranien.Footnote 10 Mais celui-ci figure, encore, seulement dans le nom Κεϱμιχίωνες qui ne se trouve qu'une seule fois, chez Théophane de Byzance (6e s. ad), désignant également un peuple étranger :
• Théophane de Byzance, chez Photius, Bibliotheca (64, 2) :Footnote 11
⁂ Ὅτι τὰ πϱὸς Εὖϱον ἄνεμον τοῦ Τανάϊδος Τοῦϱϰοι νέμονται, οἱ πάλαι Μασσαγέται ϰαλούμενοι, οὓς Πέϱσαι οἰϰείᾳ γλώσσῃ Κεϱμιχίωνάς φασι. Καὶ αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ τότε δῶϱα ϰαὶ πϱέσβεις πϱὸς βασιλέα Ἰουστῖνον ἔστειλαν…
« A l'Est du Tanaïs habitent les Turcs autrefois dénommés Massagètes et que les Perses appellent dans leur langue « Kermichions ». Ces tribus, elles aussi, à cette époque, envoyèrent cadeaux et ambassadeurs à l'empereur Justin (…) »
Il y a aussi une attestation parallèle de la forme Ἑϱμηχίονες chez Théophane le ConfesseurFootnote 12 traitant les mêmes événements du 6e siècle que Théophane de Byzance décrit.
• Théophane le Confesseur, Chronographia : Footnote 13
⁂ τῷ δ’ αὐτῷ μηνὶ ἦλθον <εἰς Κωνσταντινούπολιν> πϱέσβεις Ἀσϰήλ, τοῦ ῥηγὸς Ἑϱμηχιόνων, τοῦ ἔσωθεν ϰειμένου τοῦ τῶν βαϱβάϱων ἔθνους πλησίον τοῦ ὠϰεανοῦ.
“In the same month [July 563 ad] envoys arrived <in Constantinople> from Askel, king of the Hermichiones, who dwell inland of the barbarian nation near the Ocean.”
C'est à ces passages que se réfère Tomaschek Reference Tomaschek and Wissowa1899 s.v. Chionitae : « les turcs de l'Altaï et de la Mésopotamie sont nommés Κεϱμι-χίωνες par les Persans (Theophan. frg. […]), ou Ἑϱμη-χίονες (Theophan. Chron. […]) ».Footnote 14
Alors ici aussi, le prétendu terme pour le rouge est en effet un nom propre (un ethnonyme), et il est probable qu'il s'agisse du même peuple mentionné dans le texte moyen perse. Pour cette raison, il n'y a pas non plus de mot grec ϰεϱμι(ϱ)- qui ait été emprunté à l'iranien pour désigner la couleur rouge.
3. L’étymologie et les réalités
Selon l'opinion généralement acceptée, l’étymologie des mots pour le rouge serait le mot indo-européen pour le ver ou l'asticot, *ku̯ṛ́mi- (cf. par exemple persan kirm,Footnote 15 lithuanien kirmìs, sanskrit kṛ́mi-, irlandais cruim).Footnote 16 Alors arménien karmir et sogdien krmʾyr contiendraient le mot pour « ver » avec un suffixe qui en dérive le nom de la couleur. Il s'agit ici d'une appellation pour le vermeil vu aussi ailleurs : on a le français « vermeil », dérivé de ver,Footnote 17 mais aussi l'arménien ordan (de ordn « ver », voir 4. ci-dessous) et l'expression hébraïque תּוֹלַעַת שָׁנִי tōlaʿat šānī (composé de תּוֹלֵעָה tōlēʿā, תּוֹלָע tōlāʿ « ver, asticot » et שָׁנִי šānī « vermeil, écarlate », voir 5.).
La réalité à laquelle ces mots se réfèrent sont des insectes de la famille des cochenilles ou coccidés qu'on a utilisés comme source de colorants rouges dès l’ère néolithique jusqu’à l’époque moderne.Footnote 18 Dans ce qui suit, nous en discuterons quelques espèces.Footnote 19
3.1. Le sanskritFootnote 20
Vu que beaucoup de substances et marchandises coûteuses proviennent de l'Inde, par exemple les épices,Footnote 21 on peut se demander si le mot viendrait du sanskrit ou du moyen-indien.
Cependant, cette dérivation pose un problème de phonologie historique. Le mot sanskrit est kṛ́mi-, remplacé par la forme moyen-indienne krimi- déjà à l’époque védique.Footnote 22 De ces formes, on n'attendrait pas -ar- pour la première syllabe, donc ces termes ne constituent pas de bons modèles pour l'arménien karmir ou l'hébreu karmīl.
Il y a une autre objection à formuler sur le plan réel. L'espèce de cochenille de l'Inde, Kerria lacca, vit en colonies formant une croûte sur les branches des arbres-hôtes.Footnote 23 Afin de les utiliser comme colorant, on casse les branches, les craque en petites pièces, et les met dans l'eau pour séparer le colorant des autres substances. Ces détails ont souvent empêché de reconnaître qu'il s'agit en réalité d'insectes.Footnote 24 Par exemple, dans la littérature médicale indienne extrêmement vaste, les cochenilles sont traitées comme une substance minérale, similaire aux métaux.Footnote 25 De plus, le terme pour la cochenille indienne est, déjà à l’époque védique,Footnote 26lākṣā-,Footnote 27 et le fil teint avec cette substance est nommé sūtram lākṣāraktam.Footnote 28
Par contre, le mot kṛmi-, assez fréquent dans la littérature médicale, signifie « parasite » (se référant par exemple à des asticots, des vers ou des poux).Footnote 29 Des composés comme kṛmija- « généré par le ver » ou kṛmiroga- « maladie du ver » ainsi signifient des maladies qu'on croyait être causées par des parasites, et kṛmighna- « tueur du ver » ou kṛmiśatru- « ennemi du ver » se réfèrent à des substances ou des plantes utilisées contre ces maladies.
Au delà du kṛmija- signifiant « généré par le ver », on a proposé qu'il existe aussi un kṛmija- se référant au colorant de la cochenille qui serait l'origine du mot persan qirmiz (voir 6. ci-dessous). Il y en aurait une attestation dans l’Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā de Vāgbhaṭa (7e s. ad?)Footnote 30 où (VI. 40, 48) « Coccus lacca » (i.e. Kerria lacca) est noté comme médicine pour la poitrine selon la traduction de Hilgenberg / Kirfel (Reference Hilgenberg and Kirfel1941 : 732) ; en outre, le mot est également repéré par les lexicographes indiens du sanskrit. Il s'agit probablement d'une acception tardive du mot.
D'autres mots qui sembleraient intéressants pour l’étymologie de l'arménien karmir etc. parce qu'ils contiennent un suffixe avec -r ou -l n'ont pas non plus la forme requise par les lois de la phonétique historique. Ce sont kirmira- (VS 30.21, “speckled” ou “spotty” selon les traductions de ce passage, v. Griffith Reference Griffith1899 : 258) ; kirmīra- (MB, nom des démons) ; kṛmilikā- « étoffe vermeille » chez des lexicographes et kṛmila- une fois dans l’Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā de Vāgbhaṭa dans un nom d'une maladie de l'oreille.
Par conséquent, même s'il y a des attestations isolées de mots comme kṛmija-, ceux-ci ne semblent pas fournir une base plausible pour le karmir arménien etc. On constate qu'en général, la cochenille indienne n'est pas nommé kṛ́mi-, mais lākṣā-, tandis que kṛ́mi- signifie « ver, parasite ». D'après Mayrhofer (Reference Mayrhofer1956 : 261 f.), les attestations déficientes dans les sources indiennes font qu'une origine indienne du mot pour le colorant de la cochenille ne puisse pas être établie avec certitude.
3.2. L'arménienFootnote 31
Tandis que la cochenille de l'Inde pose des difficultés pour établir l’étymologie des mots discutés, l'espèce de l'Arménie semble convenir tout à fait bien à ce propos. La cochenille qui se trouve dans cette région est la Porphyrophora hamelii, et les femelles ont une longueur de presqu'un centimètre, donc bien susceptibles d’être reconnues comme des insectes.Footnote 32 L'insecte vit sur les racines des herbes et graminées, et en sort au début de l’été pour aller chercher un partenaire.
Effectivement, les sources arméniennes classiques notent la présence de ces cochenilles dans la vallée de l'Ararat à plusieurs reprises. La description la plus détaillée est celle de la Géographie attribué à Anania de Shirak (610–685) :Footnote 33
• Anania Širakacʿi, Géographie (version courte, V : xv) :Footnote 34
⁂ Եւ ունի Արարատ լերինս, և դաշտս՝ և զամ՟ պարարտռւթի՟ (…) Եւ որդն սիզաբերեալ յարմատոյ, առ ՛ի զարդ կարմրութե՟ գունոյ.
‣ Ew owni Ararat lerins, ew dašts, ew zamenayn parartowtʿiwn (…). Ew ordn sizabereal yarmatoy, aṙ ‘i zard karmrowtʿean gownoy.
« La province d'Ararad a des montagnes, des plaines avec toute sorte de productions (…) : on y trouve aussi un ver qui naît de la racine d'une plante et qui fournit la couleur rouge ».
Le célèbre historien Lazare de Pharbe du 5e siècle fait également mention de cet insecte :
• Łazar Pʿarpecʿi, Histoire de l'Arménie: Footnote 35
⁂ Նաև զարմատս եղէգնասեր բուսոցն ոչ ընդունայն սնուցանէ յինքեան ամենաբաղձ դաշտն Այրարատոյ, այլ և ի նմանէ ծնեալ որդունս, ի զարդ կարմրատեսիլ գունոց, ընծայէ օգտասիրացն շահս և շքեղութիւնս ։
‣ na-ew zarmats ełēgnaser bowsocʿn očʿ ǝndownayn snowcʿanē yinkʿean amenabałj daštn Ayraratoy, ayl ew i nmanē cneal ordowns, i zard karmratesil gownocʿ, ǝncayē ōgtasiracʿn šahs ew škʿełowtʿiwns.
« De même la gracieuse plaine d'Ararat produit, non pas inutilement, des cannes à sucre et des cochenilles pour la fabrication des couleurs vermeilles qui donnent du profit et du luxe aux gens intéressés. »
Ces « gens intéressés » se trouvaient bien au délà de l'Arménie selon les informations fournies par Dioscoride (1e siècle ad) dans son livre portant sur les plantes médicinales :
• Dioscoride, Materia medica (IV : 48) :Footnote 36
⁂ ϰόϰϰος βαφιϰή θάμνος ἐστὶ φϱυγανώδης, ᾧ πϱόσϰεινται οἱονεὶ φαϰοί, οἷτινες ἐϰλεγόμενοι συντίθενται. ἀϱίστη δέ ἐστιν ἡ Γαλατιϰὴ ϰαὶ Ἀϱμενιαϰή, ἔπειτα ἡ Ἀσιανὴ ϰαὶ Κιλίϰιος, ἐσχάτη δὲ πασῶν ἡ Σπάνη.
“Coccum tinctile is a little shrub full of sprigs, to which cling grains like lentils which are taken out and stored. The best is from Galatia and Armenia, then that from Asia and that from Cilicia, and last of all that from Spain.”
Les renseignements fournis par Dioscoride sont évidemment assez confus ; c'est bien probable qu'il n'ait jamais vu la cochenille arménienne. Ce qu'il décrit ici se réfère à la cochenille méditerranéenne, une espèce complètement différente. Il s'agit du Kermes vermilio ou Kermes ilicis, qui vit sur les branches des chênes, notamment de l'espèce Quercus coccifera. Pendant toute l'Antiquité grecque et romaine, on prenait ces cochenilles pour une sorte de fruit de l'arbre.Footnote 37
Je n'ai cité ici que les sources les plus anciennes et les plus claires portant sur l'importance du colorant arménien. Parmi les autres sources mentionnées dans la littérature,Footnote 38 il y a par exemple le rapport que le roi d'Assyrie Sargon II fait mention de « matériaux rouges d'Ararat et de Khurkhi » pris comme butin à Urartu en 714 av. J.-C.,Footnote 39 et la note chez Strabo (11.14.9) : “In Armenia there is also a mine of Sandyx, to which the name of the Armenian colour is given”.Footnote 40
Il convient de noter aussi que les lexicographes arabes expliquent le mot arabe qirmiz (un dérivé de l'iranien kirm) comme se référant à la teinture rouge de la vallée de l'Ararat.Footnote 41 De même, les historiens et géographes arabes notent le rouge arménien comme qirmiz, comme le fait par exemple Ibn Ḥawqal (10e siècle) : “Deinel is (…) the chief town of Armenia (…). Here they manufacture fine hangings, and carpets, and make the beautiful colour called قرمز kermez. I have heard that this kermez is a certain worm”.Footnote 42 De même, des voyageurs européens ont remarqué la présence de la cochenille arménienne aux pieds du mont Ararat, comme le fait par exemple Clavijo, chambellan du roi Henri III de Castille et León, dans le récit de son ambassade à Samarcande 1403–06 : “In the valleys of the mountain the Kirmiz worm is found, with which they dye the silk crimson”.Footnote 43
Le point principal dérivant de ces données est bien clair : la teinture de la cochenille arménienne était connue pour sa qualité au moins dès le premier siècle de notre ère, et cette célébrité ferait aisément de ce colorant une marchandise appréciée et exportée. Effectivement, quelques tissus historiques teints au rouge arménien sont préservés, par exemple un caftan sassanide tout en rouge préservé au Musée des Tissus de Lyon et des gants en soie tricotés pour un évêque de France au 15/16e siècle.Footnote 44
4. Le sogdien /karmīr/
Retournant des réalités du monde physique à l’étymologie, on se demande alors si l'arménien pourrait être la source du mot karmir. Cependant, cela ne semble pas être le cas, car, comme l'ont montré les passages de Lazare de Pharbe et d'Anania de Shirak, le mot arménien pour le ver est ordn. Ici aussi, on en dérive la désignation de couleur ordan « vermeil », ce qui est alors le terme indigène pour cette couleur.Footnote 45
Il n'y a donc pas de forme héritée comme †karm en arménien. Alors on a proposé que l'arménien karmir ferait partie du groupe très large des emprunts à l'iranien.Footnote 46 Comme un mot avec la forme requise se trouve effectivement en sogdien, le mot arménien pourrait être emprunté au sogdien.Footnote 47
En effet, et contrairement au prétendu mot moyen perse (voir 2.1), le mot sogdien krmʾyr est assez bien attesté. Il convient de noter, cependant, qu'il n'y a apparemment pas d'attestations dans les textes anciens (comme les « lettres anciennes ») ni dans ceux de la Sogdiane proprement dite (par exemple ceux du mont Mugh). Évidemment, étant donné l'attestation fragmentaire du sogdien de la Sogdiane, il serait problématique de saisir des conclusions de cette absence, mais il est vrai quand même que toutes les attestations de ce mot, bien fréquentes, se trouvent dans les textes du Turkestan oriental, c'est à dire, du Xinjiang actuel.
L'orthographe du mot sogdien est dans la très grande majorité des cas krmʾyr (écriture sogdienne) et qrmyr (écriture manichéenne), conduisant Gauthiot (Reference Gauthiot1914 : 143) à en déduire la prononciation /karmīr/. Cependant, il y a aussi une attestation de la forme qyrmyr en sogdien chrétien.Footnote 48 Aussi, le yaghnobi, une langue iranienne orientale moderne dont l'ancêtre est une langue proche du sogdien, a un mot kimīr « rouge ».Footnote 49 Peut-être cette forme s'expliquerait par une assimilation de voyelles ; une telle assimilation aurait pu être motivée par une association au sogdien kyrm- (C qyrm-) /kirm/ à travers de l’étymologie populaire. Ce mot correspond au kirm « ver » du persan, mais signifie « serpent ». Cette association semble être au fond d'une erreur dans le texte nommé Sūtra of the Causes and Effects of Actions, un texte bouddhique qui, dans la section en question, décrit comme ceux qui font du mal auront une réincarnation sous une forme désagréable.
• Sūtra of the Causes and Effects of Actions, ligne 87 :Footnote 50
⁂ (…) rty krmʾyr ʾʾzʾyt
« (Celui qui par ses vêtements offense l'image du Buddha,) naît rouge. »
Mais un autre passage du même texte donne :
• Sūtra of the Causes and Effects of Actions, ligne 145 :
⁂ (…) rty zʾrβrʾk kyrmʾ ʾʾzʾyt
« (Celui qui aime à calomnier,) naît serpent venimeux. »
À la base de ce passage ainsi que de la version chinoise de la ligne 87, les éditeurs ont proposé de lire kyrmʾ « serpent » au lieu du krmʾyr attesté aussi dans la ligne 87.Footnote 51
Évidemment, si le mot sogdien était /kirmīr/, il ne serait pas un bon candidat en tant que source pour l'arménien karmir. S'il est /karmīr/ (ou /kǝrmīr/), on se demande quand même la raison pour la voyelle de la seconde syllabe : d'une forme indo-européenne *ku̯ṛmi-ro-, par exemple, on n'attendrait pas un ī long.Footnote 52 Nous reviendrons aux possibles protoformes dans 6.2.
La proposition d'une origine sogdienne présente aussi des difficultés sur le plan géographique et historique : il est difficile d'imaginer un contact direct de locuteurs du sogdien et de l'arménien ; aussi, la vaste majorité des emprunts iraniens est évidemment d'une langue iranienne occidentale (notamment du parthe et du moyen perse). Afin de médier la distance, on a dû proposer que des éléments sogdiens pourraient dériver d'un component iranien oriental présent en parthe nommé « parnien ». Le parnien serait ainsi la source de mots arméniens dont les correspondances ne sont connues que dans les langues iraniennes orientaux.Footnote 53 Évidemment cette logique dépend de l'absence en iranien occidental de ces mots. Or, on a entretemps trouvé un bon nombre des candidats en iranien oriental, et l’étymologie iranienne orientale est devenu improbable aussi pour d'autres raisons.Footnote 54 L'hypothèse sogdienne est donc affaiblie par des nouvelles données.
5. L'hébreu karmīl Footnote 55
L'origine de l'arménien karmir devrait être aussi celle du mot hébreu כַּרְמִיל karmīl qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a trois occurrences de karmīl dans la Bible, toutes les trois dans le livre II Chroniques dans des passages décrivant la construction du temple à Jérusalem (II Chron. 2 : 6, 2 : 13 ;Footnote 56 3 : 14). Un de ces passages nous dit :
• II Chroniques 3 : 14 :Footnote 57
⁂ וַיַעּשׂ אֶת־הַפָּרֺכֶת תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְכַרְמִיל וּבוּץ וַיעַּל עָלָיו כְּרוּבִים׃
‣ wayaʿas et-hapāroḵet tǝḵēlet wǝʼargāmān wǝḵarmīl ouvuẓ wayaʿal ʿālāw kǝrouvīm.
« Il [Salomon] fit le voile [du temple] bleu, pourpre et cramoisi, et de byssus, et il représenta des chérubins. »
La combinaison de « bleu », « pourpre » et « vermeil » se trouve aussi dans d'autres livres de la bible. Elle se réfère toujours à des vêtements ou à des tissus de grande importance religieuse ou liturgique, comme les vêtements du Grand prêtre.Footnote 58 Évidemment on a affaire à des teintures très précieuses, bien que l'identification des colorants a posé certains problèmes. Pour le bleu, תְּכֵלֶת tǝḵǝlet, et le pourpre, אַרְגָּמָן argāmān, la solution plus probable c'est qu'ils soient des couleurs produites des limaces de mer du genre Murex, des mollusques donnant une gamme de couleurs bleues et pourpres, et connus dès l'Antiquité.Footnote 59
En dehors du livre II Chroniques, la série de « bleu », « pourpre » et « vermeil » n'a pas כַּרְמִיל karmīl pour le vermeil mais תּוֹלַעַת שָׁנִי tōlaʿat šānī.Footnote 60 Cette expression se compose de תּוֹלֵעָה tōlēʿā, תּוֹלָע tōlāʿ « ver, asticot » (un mot aussi utilisé dans un sens métaphorique) et שָׁנִי šānī « vermeil, écarlate (dit sur un tissu ou un fil) ». Cette phrase est toujours utilisée pour des vêtements religieux tandis que שָׁנִי šānī seul s'utilise dans des contextes séculaires.Footnote 61
L’évaluation de l'emploi de karmīl dépend évidemment de la question si les attestations de II Chroniques sont les seules à exister. Or, on a proposé de voir une autre attestation de כַּרְמִיל karmīl dans le Cantique des cantiques 7 : 6, où on pourrait altérer le texte Massorète כַּכַּרְמֶל ka-karmel « comme (le mont) Carmel » en כְּכַרְמִל kǝ-ḵarmil Footnote 62 ou כַּכַּרְמִיל ka-karmīl Footnote 63 « comme vermeil », ce qui serait parallèle à « comme pourpre » (כָּאַרְגָּמָן kā-argāmān) dans la comparaison qui suit.Footnote 64
D'autres commentateurs ont rejeté cette émendation,Footnote 65 notant qu'une comparaison de la tête (sic, pas du visage ou des cheveux) de la bien-aimée avec le vermeil ne serait pas plausible ; de plus, la comparaison au mont Carmel s'arrangerait bien avec les comparaisons géographiques du vers précédent (Damasque, mont Liban, etc.). Une vue intermédiaire propose qu'une émendation du texte ne serait pas nécessaire, mais que כַּכַּרְמֶל ka-karmel « comme Carmel » évoquerait karmīl « pourpre » à cause de la comparaison qui suit.Footnote 66 Cette proposition, elle aussi, semble assez ad hoc et pas très motivée.
On a aussi proposé l'existence d'un adjectif כַּרְמִלִי karmilī « de couleur vermeille ».Footnote 67 Les attestations données par Levy (une dans la Tosefta Nidda et une dans la Mishna, les deux traitant la même question) comparent les couleurs de deux sortes de vin. Selon Levy, le texte dirait “the Saronic wine is considered (by its colour) equal to the unmixed carmesine-coloured wine”. Il semble plus probable, cependant, que la comparaison porte sur le vin de deux régions : “Sharon wine [vin de la vallée Sharon, AK] (mixed) which resembles in color the Carmel wine pure but not mixed, new” (Jastrow Reference Jastrow1926 : 671b s.v. כַּרְמְלִי). Alors les deux passages contiendraient l'adjectif כַּרְמְלִי karməlī « du mont Carmel ».Footnote 68
Vu, alors, que karmīl est assuré seulement dans le livre II Chroniques, la différence entre l'emploi de karmīl en II Chroniques et tōlaʿat šānī dans le reste de la bible s'accorderait avec l'observation que II Chroniques montre des influences de l'araméen,Footnote 69 et alors karmīl aurait entré l'hébreu par la voie araméenne.Footnote 70 D'ailleurs, II Chroniques 2 : 6 contient aussi la seule attestation de אַרְגְּוָן argǝwān (variante araménne de אַרְגָּמָן argāmān « pourpre »Footnote 71) dans un contexte hébreu tandis que les autres attestations d’argəwān se trouvent dans des passages araméens (toutes dans Daniel 5).Footnote 72
On a décrit כַּרְמִיל karmīl figurant dans II Chroniques comme un terme « tardif » pour « la même couleur »Footnote 73 que celle désignée par l'expression tōlaʿat šānī ou au moins « très similaire » à celle-ci,Footnote 74 c'est à dire “a rare post-exilic synonym”.Footnote 75 En tout cas, karmīl montre que le mot figurait dans le vocabulaire araméen de l'auteur (ou des auteurs) des passages de II Chroniques 2–3. Cela nous fournit aussi un terminus ante quem pour la période où le mot, et probablement le colorant, seraient arrivés en Palestine, ce qui devrait être le début de la période moyen-iranienne. Pour cette période, une origine sogdienne semblerait moins probable même pour des raisons chronologiques.
En dépit d'un nombre assez large de publications sur les termes de couleur dans la bible hébraïque,Footnote 76 les détails qu'ils donnent sur l’étymologie sont vagues ou contradictoires. Les dictionnaires de l'hébreu et les commentaires sur II ChroniquesFootnote 77 constatent que כַּרְמִיל karmīl est « persan » (soit verbatim ou dans le sens de « iranien »), et on le compare au persan qirmiz « rouge »Footnote 78 et/ou kirm « ver », parfois aussi au sanskrit kṛ́mi- « ver », mais évidemment ces formes ne se prêtent pas à être l'origine de karmīl. Toutefois, Delitzsch a noté déjà en 1898 qu'un mot « vieux-perse » (ce qui, à l’époque, voulait dire « vieux-iranien ») jusque-là inattesté devrait être à l'origine du mot hébreu karmīl.Footnote 79 Ce mot est entretemps trouvé en sogdien, mais, comme nous l'avons vu en 4., cette langue n'est probablement pas l'origine du mot hébreu.
6. L'origine iranienne de karmīl
6.1. Une langue qui donne l’ar de karmir
Les sources principales des emprunts iraniens en arménien sont d'abord le parthe, puis le moyen perse, correspondant aux périodes arsacides et sassanides.Footnote 80 Dans ces deux langues, l'i.-e. *ṛ donne ur (dans la proximité des consonnes labiales) et ir (ailleurs),Footnote 81 et ce résultat est confirmé par des emprunts en arménien, par ex. vzurk « grand » (persan buzurg).Footnote 82 Comme les voyelles i et u sont syncopés en position prétonique (c.-à-d. préfinale) en arménien,Footnote 83 à ces examples s'ajoutent Vrkan (persan Gurgān < *wṛkān-), Krman (persan Kirmān) etc., qui ne laissent pas voir s'il s'agissait de ir ou ur, mais exclurent ar, la syncope ne concernant pas l’a.Footnote 84
Le moyen iranien oriental attesté ne peut donc pas être la source de l'arménien karmir. Mais, comme l'ont souligné un bon nombre de spécialistes du sujet, l'arménien a emprunté des mots aussi à d'autres langues iraniennes, comme l'a souligné Bolognesi (Reference Bolognesi1966 : 578) « La situazione e i rapporti dei dialetti iranici risultano in un realtà ben più complessi di quanto non appaia nella tradizionale classificazione dialettale iranica troppo rigorosamente schematicha. »
En ce qui concerne l'i.-e. *ṛ, il y a par exemple marg « oiseau » que l'on peut comparer au mṛgá- en sanskrit et dont la source ne peut pas être ni le parthe (murγ), ni le moyen-perse (murw).Footnote 85 Ce mot, ainsi que d'autres lexèmes avec arménien ar pour i.-e. *ṛ, posant la nécessité de postuler une langue montrant i.-e. *ṛ. > ar, cette langue pourrait être la source qui a aussi fourni karmir.Footnote 86
Pour la plupart des langues iraniennes modernes, il n'y a pas encore de recherche sur la question du résultat de l'i.-e. *ṛ. Toutefois, le Zazaki, langue voisine du kurde parlé en Anatolie orientale, semble donner ar : on y trouve /kard/ « fait », /barz/ « haut », /varg/ « loup », et, en effet, /karm/ « chenille, larve », montrant la phonologie historique requise.Footnote 87 Le Zazaki n'est d'ailleurs pas loin de la vallée de l'Ararat, l'habitat de la cochenille arménienne. Il semble donc bien possible qu'une langue de cette région puisse être la source du karmir arménien.
6.2. La protoforme
En ce qui concerne la seconde syllabe de l'arménien karmir, il convient de noter la différence au pendant persan qirmiz (avec q- causé par le passage par l'arabe). On peut, cependant, constater une absence intéressante du mot qirmiz dans les textes persans des périodes prémodernes, qui ont surx pour le rouge, et, si qirmiz y figure du tout, c'est le nom du colorant, pas de la couleur. qirmiz est absent, par exemple, du Shâh Nâmeh Footnote 88 et des Rubâiyât de Omar Khayyâm (lequel a lāl et arġawān pour la couleur du vin).Footnote 89 Le dictionnaire encyclopédique Dehxodā, qui d'habitude donne des citations littéraires illustrant l'usage des mots, n'en a rien pour qirmiz (ni pour qirmizī) et cite des dictionnaires arabes à titre de définition. Le grand dictionnaire du tadjik publié à Moscou en 1969 cite un vers contenant qirmizī de Nizâmi,Footnote 90 poète du 12e siècle de Ganja (Azerbaïdjan), donc assez proche de la région d'origine du rouge arménien. Il semble donc que le mot qirmiz soit rentré dans le vocabulaire du persan par la voie de l'arabe dans une époque relativement tardive, et avec la sémantique « colorant rouge d'origine arménienne » (voir 3.2 ci-dessus).
A) Néanmoins, il y a évidemment un mot iranien *kirmiz à l'origine de persan qirmiz, montrant un résultat ir de l'i.-e. *ṛ, ce qui serait le résultat typique pour le moyen perse et le parthe. Une forme *kirmiz pourrait être issue de *kṛmi-za/ā- « généré par le ver », le pendant iranien de l'indien kṛmi-ja- du même sens (discuté en 3.1 ci-dessus).
Pour l'arménien karmir, on pourrait donc envisager le même *kṛmi-za/ā- « généré par le ver », donnant *karmiz dans le dialecte iranien proposé ci-dessus, qui par assimilation consonantique aurait changé en karmir.Footnote 91
En vue de l'importance du colorant rouge de l'Arménie (voir 3.2), on attendrait effectivement que les autres langues aient emprunté le mot à l'arménien. Dans ce cas, cependant, il faudrait admettre que la quantité de la voyelle ī en sogdien et en hébreu résulte du procès de l'emprunt : peut-être la prononciation de l’i en arménien (qui ne fait pas de distinction de quantités vocaliques hormis dans l’e) était plus proche à l’ī que à l’i des langues ayant emprunté ce mot.
B) Une solution alternative serait un composé de formation parallèle *kṛmi-dā- « donné par le ver », également assez plausible du point de vue sémantique. Dans le dialecte proposé, cela donnerait moyen-iranien *karmiδ. Comme le moyen-iranien *δ est rendu régulièrement par r en arménien, par exemple Mar-kʿ « Mèdes » (< moyen-iranien *Māδ < viel-iranien Māda-), aroir « cuivre » (< *rōδ, cf. baloutchi rōd).Footnote 92 On aurait donc karmir sans être obligé de proposer une assimilation. Ici aussi, on pourrait attribuer l’ī long des mots sogdiens et hébreux au procès de l'emprunt.
C) Alternativement que de postuler un allongement de l’i causé par le procès d'emprunt, on pourrait aussi songer à une forme iranienne *karmīr que le sogdien et l'hébreu auraient empruntée directement.
En tant que parallèle pour l’ī long, on peut comparer l'allongement de i et u qui s'effectue en persan devant les occlusives en fin de mot, produisant par exemple Nahīd « vénus » du viel-iranien Anāhitā et le suffixe -īd du thème du passé de *-ita-.Footnote 93 L'allongement en persan, cependant, semble être lié à la sonorisation des occlusives sourdes (vieil-iranien *t etc. > d etc. en position post-vocalique) par un procès parallèle à la loi de Lachmann en latin. Il est possible que la langue qui a donné karmi/īr ait connu un procès d'allongement parallèle à celui du persan, qui s'aurait aussi produit devant les occlusives sonores et aurait donné *karmīδ.Footnote 94 Pour arriver aux formes attestées, on pourrait songer à un changement δ > l/r. Un tel changement est bien connu en iranienFootnote 95 et ailleurs, et on a en effet discuté un changement δ > sogdien l,Footnote 96 mais pas un changement δ > sogdien †r. Cette solution paraît donc poser trop de difficultés pour être probable ; une origine sogdienne entraîne aussi les problèmes indiqués en 4. et 5.
Une alternative possible, cependant, serait une protoforme *kṛmiH-dā-, une hypostase avec l'instrumental du nom du ver comme premier membre.Footnote 97 Cette formation serait parallèle à d'autres périphrases avec l'instrumental,Footnote 98 dont un groupe contient la racine *dheh 1 « mettre » (par exemple latin rubefacere « faire rouge », Balles Reference Balles2006 : 203 ff., 290 f.), qui en iranien est devenue homonyme à la racine *deh 3 « donner » et a abouti dans une racine dā « donner, établir, etc. ».
D'une façon analogue, on pourrait postuler une protoforme *kṛmiH-zā- pour l’étymologie A, mais une forme donnant *-īz est en conflit avec le persan qirmiz.
D) Il y a encore la possibilité d'une protoforme *kṛmīra- dont la fonction du suffixe n'est pas tout à fait claire, mais au moins l'existence de cette forme est confirmée par le sanskrit (voir 3.1) et donnerait karmīr dans la langue iranienne postulée ci-dessus.Footnote 99
Bien évidemment, les inconnus concernant la phonologie historique de la langue dont l'arménien karmir provient, les voies de transmission de ce Wanderwort (« mot errant ») etc. ne permettent pas de décider la question de l’étymologie de manière définitive. Toutefois, on note des différences quant au nombre des hypothèses nécessaires pour arriver aux données à expliquer. Les solutions qui semblent les plus nettes sont :
•une protoforme *kṛmīra- « dérivé (?) du ver », identique à une des formes effectivement trouvées en sanskrit, donnant le *karmīr requis dans la langue postulée en 6.1 ;
•une protoforme *kṛmi-zā- « généré par le ver », requise pour fournir le persan qirmiz, donnant *karmiz dans la langue postulée, et *karmir par assimilation, dont l'arménien karmir, emprunté par le sogdien et l'hébreu, qui auraient interpreté l’i arménien comme équivalent à leur ī long ;
•si on admet l'interprétation de l'arménien donnant un ī long en hébreu et en sogdien, la protoforme ayant donné l'arménien karmir n'a pas d'importance ; alors *kṛmi-dā- « donné par le ver » serait aussi bien possible et ne nécessiterait pas la postulation d'une assimilation. Une protoforme *kṛmiH-dā- rendrait superflues encore d'autres postulations de changements phonétiques. Cependant, ces protoformes ne sont pas directement assurées autrement.
7. Conclusion
Il convient de résumer que l'arménien karmir est un mot iranien, comme on a toujours proposé. Cependant, il n'est pas trop probable que le sogdien krmʾyr ou bien un mot indien soient l'origine de ce mot.
Il faut plutôt chercher l'origine dans une langue où la phonologie historique donne régulièrement karmīr ; cela peut bien être la même langue qui a aussi donné l'arménien marg « oiseau » et d'autres mots avec ar provenant de i.-e. *ṛ, phénomène important pour la dialectologie des emprunts iraniens en arménien.
Il convient de signaler en passant que karmir se range dans le lexique arménien d'origine iranienne relatif à la technologie, aux vêtements et à la joaillerie recueilli par Schmitt (Reference Schmitt1983 : 91 f.), parmi lesquels figurent goyn et erang « couleur », nkar « image, peinture », patker « image », patmowčan, paregawt-kʿ « vêtement », dipak « brocart », etc.
La région d'origine du mot pourrait être l'Anatolie orientale, région multiculturelle et multilingue depuis des millénaires, où la plaine de l'Ararat a fourni des cochenilles fameuses déjà dans l'Antiquité. Le colorant de cette cochenille était exporté dans d'autres pays, et les vêtements d'origine iranienne sont parvenus jusqu'en Égypte, en Syrie, etc. La grande popularité de ce colorant serait aussi la raison pour laquelle il y a dans le livre II Chroniques de l'Ancien Testament, et ici exclusivement, trois attestations d'un mot karmīl, qui a entré l'hébreu par la voie araméene, comme établi déjà depuis longtemps.Footnote 100
Il y a donc ici un exemple d'un colorant qui nous fournit aussi des informations sur les contacts des peuples, des locuteurs de parlers iraniens, de l'arménien, et de l'hébreu. L’étude des mots se lie alors à la recherche sur l'histoire réelle, voire économique.